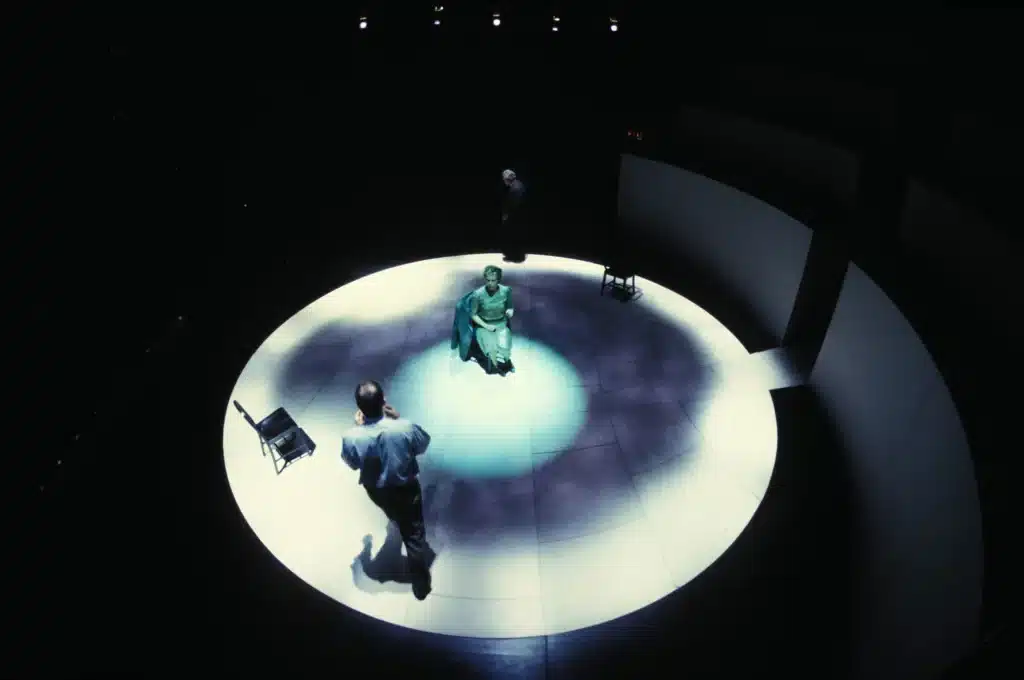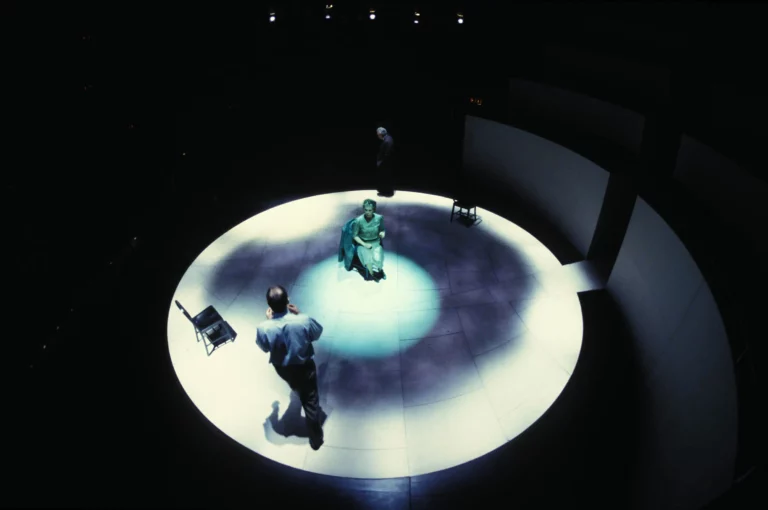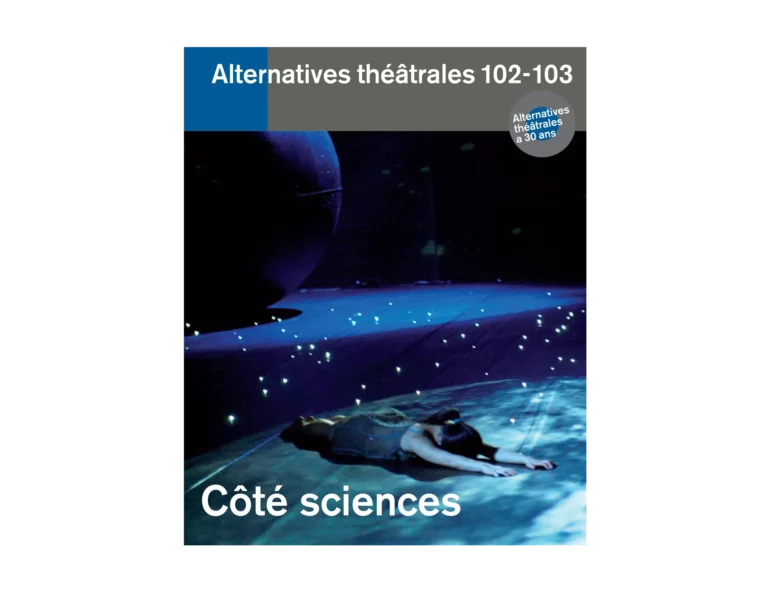LE TRAVAIL de Michael Frayn me fascine depuis fort longtemps. Aussi, lorsque la coordinatrice m’a demandé de lui faire part de mes impressions de spécialiste de la physique quantique sur sa pièce COPENHAGEN, j’ai aussitôt accepté. Ma vision de la pièce se fonde sur le texte et sa première mise en scène au National Theatre en 1998, ainsi que sur ma lecture de CONSTRUCTIONS (1974) et de THE HUMAN TOUCH (2006), deux ouvrages métaphysiques étonnants dans lesquels Michael Frayn explore en détail certaines des questions soulevées dans la pièce et portant sur les récits, le savoir, les motivations des hommes et leurs liens éventuels avec la physique fondamentale.
On s’est beaucoup interrogé pour savoir si COPENHAGEN respectait les faits historiques. N’étant pas compétent pour en juger, mon appréciation de la pièce repose sur des critères moins stricts : est-ce que les personnages de Frayn, leurs dialogues et les motivations qu’on leur prête établissent des corrélations intéressantes — un adepte de la physique quantique parlerait de produit interne significatif — avec la réalité historique et psychologique. De ce point de vue, la pièce est une parfaite réussite. Frayn ne se trompe jamais sur les détails techniques, il reproduit à merveille la façon de penser et de parler des physiciens et nous présente des versions tout à fait crédibles de Heisenberg et de Niels et Margrethe Bohr.
Frayn nous raconte son histoire comme une série d’«ébauches », de récits hypothétiques et apparemment incompatibles. Au cœur et autour de ces ébauches, évoluent de nombreuses images et métaphores tirées de la physique quantique – en particulier le principe de complémentarité de Bohr et le principe d’incertitude de Heisenberg. Il s’agit là d’analogies ludiques, qui font allusion à des spéculations sur des connexions plus profondes, et certains pourraient même y voir un message de la science nous enseignant que les particules élémentaires comme les êtres humains résistent nécessairement à toute analyse plus poussée.
Mais je pense qu’il faut résister à cette dernière lecture. Les postmodernistes et les relativistes historiques ont, il est vrai, souvent fait appel aux théories quantiques pour étayer leur discours. Car il ne faut pas oublier que l’une des formulations les plus belles et les plus profondes de la physique quantique consiste à décrire l’évolution des états dans le temps comme le résultat collectif d’une somme sur toutes les histoires possibles. Il faut rappeler également que la définition et la justification du concept de passé non ambigu reste un problème profond non résolu dans la cosmologie quantique moderne. Pourtant, les physiciens se demandent comment on peut raisonnablement utiliser — et certains diront même extrapoler sauvagement — les principes d’une théorie scientifique pour défendre une vision du monde radicalement anti-scientifique.