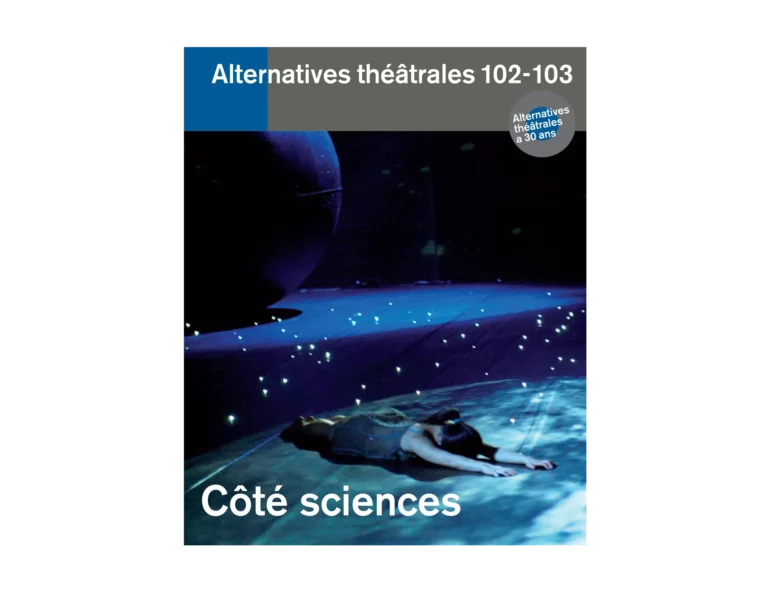GEORGES BANU : Nous pouvons engager cet entretien à partir de ce spectacle de référence qui reste LA NATURE DES CHOSES, à partir du texte de Lucrèce. Il me semble qu’à ce moment-là s’engage, alors encore en compagnie de Jean Jourdheuil, le défi de passage du « côté des sciences » et de leur confrontation avec le plateau et, implicitement, la représentation…
Jean-François Peyret : En sortant de TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE, tu m’as dit que ce spectacle te rappelait le LUCRÈCE 1, et qu’il était récapitulatif, testamentaire, autant dire. Je pouvais en rester là et donc mourir tranquille. J’y ai sérieusement pensé. De fait, que ces deux spectacles qu’une vingtaine d’années séparent aient un air de famille, au fond, je l’espère bien. J’aimerais penser qu’un fil plus ou moins visible lie tous ces travaux, même si les modes de fabrication ont changé : je travaille seul et mon problème n’est plus de porter au théâtre des textes non dramatiques, comme dans les années quatre-vingts. Mais il est vrai que, ne montant pas des textes déjà écrits, ne sautant pas d’un auteur à l’autre, ou passant du théâtre à l’opéra et retour, la cohérence éventuelle du travail ne peut tenir à la pertinence d’un répertoire ; je suis mon petit bonhomme de chemin. Commencer à faire du théâtre, c’était une façon de me mettre en marche, en route, en chemin, après mes foirades littéraires de la décennie d’avant où je faisais du surplace, hamlétisant sur la question écrire ou ne pas écrire, m’adonnant pendant ce temps à différents petits métiers littéraires : université, édition, journalisme. Maintenant si ce chemin fait itinéraire qui se tient un peu, tant mieux. Un critique doté d’un GPS dramaturgique devrait pouvoir décrire l’itinéraire qui va de Lucrèce à Galilée. Pour le dire autrement, chaque spectacle est gros du suivant, et c’est vrai depuis le premier, LE ROCHER LA LANDE LA LIBRAIRIE, d’après les ESSAIS de Montaigne 2, spectacle matriciel (le LUCRÈCE est aussi contenu dans le MONTAIGNE, de même que les ESSAIS sont bourrés du DE RERUM NATURA) dont le TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE est un palimpseste, la présence d’Oliver Perrier dans les deux spectacles en témoignant. Mais on pourrait aussi bien dire que ce dernier spectacle contient tous les précédents, Montaigne, Lucrèce, – il fait même allusion à Müller –, sans parler bien sûr des plus récents. J’ajouterai seulement que le chemin n’existait pas et qu’il a fallu passer à travers champs, c’est le cas de le dire. Pas un sentier de grande randonnée, dûment balisé ; j’ai souvent cru me perdre. Trêve de métaphore : ce que ces spectacles ont en commun, c’est leur refus du mimétique, le rejet d’un théâtre d’imitation de la vie, avec fable et personnages, leur tentative, comme chez Lucrèce, toutes choses égales d’ailleurs, de confronter et de conjuguer la connaissance et la littérature, l’effort de penser et le désir de poésie. Barthes aurait pu parler d’un théâtre de la mathesis plutôt que de la mimèsis. Un théâtre libéré du fardeau de la représentation des hommes en train d’agir (les marquises qui sortent à cinq heures, les ventes pathétiques de cerisaies), et qui est plutôt attentif, oui, à la « nature des choses », donc aussi aux choses de la nature (cela nous conduira à parler de la science), un théâtre qui est intrigué par l’aventure de la pensée… Et c’est une aventure tragique, ou c’est celle du tragique, mais non le tragique d’un héros particulier, mais celui de l’espèce humaine, avec ce pilote fou à bord, le cerveau, ce cerveau trop gros dont nous avons essayé de parler dans LES VARIATIONS DARWIN et qui est peut-être le personnage principal de mon théâtre.
G. B.: Ce que tu dis sur l’itinéraire, plutôt sur la poursuite d’un chemin propre marqué par l’attrait pour ce qui se développe d’un spectacle à l’autre, me rend mélancolique, moi, déplore mes égarements et l’impossibilité de choisir. Chez toi, la concentration dont tu parles m’invite tout de même à t’interroger sur le fait de faire ou de ne pas faire une différence entre le théâtre de la pensée et le théâtre des idées ?
J.-F. P.: Que tu fasses référence au théâtre des idées ne me surprend pas… J’avoue n’avoir jamais très bien cherché à comprendre ce que Vitez entendait par le théâtre des idées, ni les conséquences que ce mot d’ordre a eues sur le théâtre qu’il faisait. Évidemment, je sais bien que le théâtre des idées n’est pas un théâtre à idées, celui qui servirait des idées sur son plateau pour les illustrer ou les vulgariser, des idées préalablement mûries dans le cerveau des philosophes ou des curés. Je sais surtout que le théâtre, parce qu’il est vivant, spectacle vivant, comme on dit, ne travaille pas sur ou avec des idées mais sur ou avec des mots et des corps, des mots qui passent par les corps, qui entrent dans des corps et en ressortent, et que cette opération, input/output, n’est pas innocente. Surtout, je me méfie des idées parce qu’elles font écran à la réalité quand elles ne servent pas de drogues de substitution à cette réalité. J’ai eu des idées pendant une période de ma vie, disons, du milieu des années soixante à la fin des années soixante-dix, des idées marxistes, tendance Brecht. Je ne les renie pas, contrairement à d’autres, mais c’était des idées, rien que des idées ; mon cerveau était commandé par un ou plusieurs algorithmes et manipulait ces idées comme une machine ferait, mais je, moi, ne les pensais pas (je souligne), je les « computais ». Toutes les machines ne pensent pas. Brecht, au contraire, on ne peut pas dire qu’il ne pensait pas ; c’était quand même un grand dialecticien.
Peu importe aujourd’hui ; il en résulte que je me méfie des idées : elles ont une tendance à devenir fixes. Elles ont une valeur d’échange (on échange des idées, l’horreur!), alors qu’on peut parler d’usage de la pensée. De fait, le théâtre m’a aidé à me débarrasser des idées, à me désintoxiquer, à faire le vide (c’est mon côté oriental), comme si la scène permettait d’éprouver, j’aime ce mot, la pensée, par une sorte d’ascèse, un exercice, dirait un stoïcien. Est-ce parce que les corps résistent aux mots ? Qu’un corps et même, contrairement à ce qu’on pourrait croire, un corps de comédien, ne peut pas n’importe quel mot. Que peut un corps ? Question de philosophe, mais aussi d’homme de théâtre… On y comprend, au théâtre (en tout cas dans un certain théâtre, – je ne vais pas jouer lou ravi du plateau –), que penser, ce n’est pas avoir des idées. Des idées, tout le monde peut s’en faire, peut en vendre (souvenons-nous des tuis de Brecht, ils pullulent aujourd’hui sur les plateaux de télévision), des idées sur le progrès, la lutte des classes, Dieu, le réchauffement de la planète, la fraternité (ça se vend bien et puis ce n’est pas bien méchant), la sauvegarde de la nature, la défense de l’humain, que sais-je ? Oui, que sais-je?… Mais penser, c’est un mouvement, souvent un mouvement contre les idées, un mouvement vivant, si je puis me permettre ce quasi-pléonasme, un mouvement toujours au présent, comme est toujours au présent ce qui se passe au théâtre, c’est toujours aussi en train de commencer. On se met à penser, on est en train de penser ; les idées, on les a eues ou on se fait avoir par elles. Un mouvement inchoatif ? Peut-être. Penser avec ou par le théâtre, pour moi, ce n’est pas me faire une opinion (souvent, hélas ! synonyme de l’idée);j’ai l’impression de penser par le théâtre, quand, dans mon métier, j’ai de la matière vivante devant moi, sur laquelle je peux expérimenter, de la matière vivante, c’est-à-dire des corps et qui parlent. Quand je fais du théâtre, je sens que mon cerveau pense (je dis ça modestement, je n’ai que trop conscience des performances limitées dudit organe) et pour autant je n’ai pas la moindre idée, je ne sais pas comment dire ça. Au théâtre, on fait corps avec la pensée ; si on y réfléchit, c’est le contraire de l’incarnation. Le corps qui se fait pensée ? Ce n’est pas le verbe qui s’incarne, c’est la bidoche qui pense. Ça me plaît assez.
G. B.: Comment interpréterais-tu l’écartèlement entre ces axes de recherche qui porte surtout sur le processus de la pensée, sur sa dynamique, et le fait que dans ton théâtre il y a toujours ou presque des figures précises, telles que Turing, Darwin, Galilée… Elles cristallisent plutôt…
J.-F. P.: Axe, le mot me va, parce qu’on tourne autour d’un axe. Il est peut-être meilleur que ceux de problème ou de matière à penser que j’aurais plutôt employés. Mais je ne parlerais pas d’écartèlement parce que, par hasard, par chance, diraient les Anglais, il arrive que ces axes de recherche, ces questions qui m’agitent et que j’essaie d’agiter, sans doute pour m’en débarrasser, arrivent à moi par ce que tu appelles justement des figures. Plutôt : je tombe sur elles, une sorte de séduction.