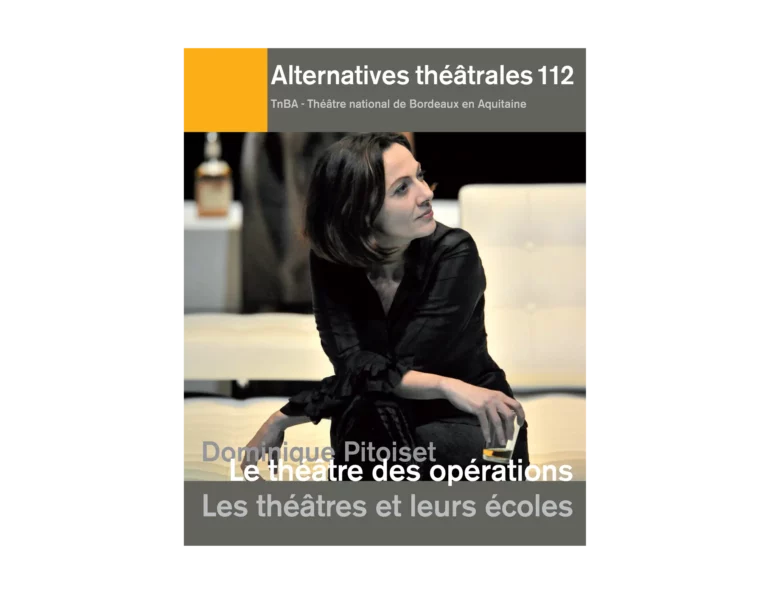LE PRINCIPE d’une école de comédiens au sein du Théâtre des Amandiers a fait partie intégrante du projet de Patrice Chéreau et Catherine Tasca, où je fus administrateur, puis directeur adjoint. Ceci fut inscrit dans le document liminaire « Projet pour une nouvelle entreprise à Nanterre » qui fut remis au Ministère de la Culture début 82. Plutôt qu’une école, y est-il précisé, c’est à un atelier qu’il faut penser et dont l’activité serait l’approche et la réalisation de spectacles.
À la demande de Patrice Chéreau, Pierre Romans concevait et ensuite, tout naturellement, il dirigea cette école.
Nous voulions une école ouverte qui, à la différence des conservatoires, n’exclurait aucun profil, aucune personnalité. Aucun diplôme – même le baccalauréat – n’était exigé ni même aucune formation particulière et surtout pas des individus formatés par des formations précédentes. La gratuité s’imposait ainsi que la prise en charge des transports et des repas. Grâce au soutien de l’Université Paris X de Nanterre, une dérogation fut assurée afin de donner le statut d’étudiant aux élèves.
Le recrutement de la première promotion se fit avant que la première programmation du théâtre ne débute. Après une annonce parue dans différentes publications, nous fûmes surpris par le nombre de postulants supérieur à nos prévisions et comme nous nous étions engagés à procéder à un recrutement attentif (entretien individuel, audition puis stage pour cinquante finalistes) cela dura plus longtemps que prévu et je revois avec humour Pierre harassé par ces entretiens et auditions marathon qui se demandait s’il pourrait en venir à bout. Il fallait non seulement découvrir des personnalités mais aussi imaginer un groupe qui allait devoir travailler longtemps ensemble. Il s’agissait de constituer une véritable troupe ! Je me souviens qu’une fois, le jury ne retint pas une candidate excellente qui se présentait également au conservatoire National de Paris. Ses qualités évidentes firent qu’elle ne fut pas retenue. Elle est aujourd’hui une actrice connue. Je retiens également des scènes de désespoir pour certains et d’enthousiasme pour d’autres, lors de l’annonce, dans le hall du théâtre, de la sélection définitive.
L’école était, comme je l’ai dit plus haut, une troupe à l’intérieur du théâtre, qui avait son propre fonctionnement et qui, en même temps, faisait partie intégrante du théâtre. Elle était une part importante de notre « Ruche ». Elle n’avait pas d’administration propre, juste un directeur, son adjointe Cécile Prost et une assistante Véronique Saavedra, installés dans deux bureaux. Les enseignants étaient des proches ou participaient par ailleurs aux activités du théâtre. Il n’y avait pas de moule particulier, l’école gardait un côté laboratoire à tel point que les deux promotions ont eu des cursus très différents, même si les finalités ont été identiques. C’était aussi une école à plein temps, huit heures par jour, six jours par semaine, le temps de deux saisons. Les pièces étaient travaillées dans leur totalité, les personnages habités de bout en bout, mais il n’y avait pas d’obligation de résultat et beaucoup de travaux achevés ne furent jamais montrés.
La formation se voulait éclectique. Le principe était de ne pas dissocier la formation théorique de la formation pratique. Aborder les questions théoriques directement à travers la pratique, telle était la méthode. Outre la réalisation de spectacles les élèves avaient comme partout des cours réguliers de danse, musique et chant ainsi que des stages théoriques.
La durée de l’école fut courte, de 82 à 87, le temps de deux promotions. Les deux groupes ont eu la chance de participer à un échange avec des écoles américaines et s’essayer à la comédie musicale. Pour Pierre Romans, il s’agissait plus de jouer en anglais car il pensait que les acteurs pouvaient faire une carrière internationale. L’idée aussi était de confronter la fantaisie française à la rigueur américaine, à se trouver face à d’autres mentalités et de manières de travailler.
Si le théâtre fut prépondérant tout au long du cursus, les élèves apprirent à se trouver face à la caméra. Pas moins de trois films furent réalisés et eurent un destin commercial.
La première promotion, formée de vingt-quatre élèves qui eurent la chance d’avoir comme enseignants Daniel Emilfork, Roland Bertin, Didier Sandre, Jean-Hugues Anglade et beaucoup d’autres, aujourd’hui reconnus. Ils tournèrent un film avec André Téchiné et, comme mentionné plus haut, ils firent un séjour aux États-Unis. Ils eurent la chance de répéter quatre pièces de Shakespeare avec Patrice Chéreau et, bien sûr, travaillèrent beaucoup avec Pierre Romans. Pendant plus de deux semaines, à la fin du cursus se déroula la présentation de ce qu’ils avaient pu faire pendant deux ans.
Le recrutement de la seconde promotion a été différent de la première dans la mesure où, tirant la leçon de la première, nous avons pris moins de débutants. La confrontation entre débutants et des gens déjà formés a créé un déséquilibre enrichissant, aidant à progresser. Le groupe fut réduit à dix-neuf membres car nous savions déjà que des projets de film allaient avoir lieu. Patrice Chéreau tourna HÔTEL DE FRANCE inspiré de PLATONOV et Jacques Doillon dirigea L’AMOUREUSE dont le scénario était inspiré d’histoires que certaines élèves comédiennes avaient écrites.
Bien sûr il y eut encore, comme pour la promotion précédente, de la danse avec Peter Goss, du chant avec Bernadette Val et de la musique avec Anne Marie Fijal. Madeleine Marion fit un travail autour de Racine. Claude Stratz anima un atelier, tout en participant à la réflexion globale sur l’école. Et toujours, Pierre au cœur du cursus avec deux pièces de Kleist qui furent programmées à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, lors du Festival en 87 ! Ajoutons PLATONOV mis en scène par Patrice, qui tint lieu de spectacle de fin d’école, qui fut également présenté au Festival d’Avignon la même année, avant Nanterre et une tournée.
Tout était prêt pour le recrutement d’une troisième promotion. De nouveaux candidats, mais aussi des malchanceux voulaient retenter cette aventure mais le destin en a décidé autrement. Patrice Chéreau choisissait de ne pas renouveler son contrat à Nanterre pour des raisons qui lui étaient propres. J’ai rencontré certains d’entre eux qui regrettent encore cette aventure qu’ils n’ont pas pu tenter.
Aujourd’hui, avec du recul – près de vingt-cinq ans – je réalise que cette école fut très éphémère. En cinq ans, elle aura formé une quarantaine d’acteurs dont les itinéraires professionnels et individuels, dans un marché du travail des acteurs très irrationnel, ont fait la réputation de cette aventure, devenue presque mythique. Quelle meilleure intégration au monde professionnel que de participer à des spectacles présentés intégralement et aussi d’être distribués dans des films diffusés dans les réseaux commerciaux ! Je revois fréquemment nombre d’élèves, au théâtre, au cinéma et même dans des téléfilms et je me rends compte alors combien Nanterre Amandiers aura été une pépinière de talents.
Aujourd’hui, beaucoup d’écoles de comédiens se sont créées au sein de théâtres, comme si cela était devenu une évidence. Je pense ici aux écoles qui sont au sein du Théâtre National de Bretagne à Rennes, du Centre Dramatique de Limoges, du Théâtre du Nord de Lille ou encore du Théâtre National de Chaillot. C’est vrai que la présence de jeunes comédiens bouscule agréablement les équipes de théâtres, les poussent à se remettre en permanence en question et à ne pas tomber dans des habitudes mécaniques. J’ai le sentiment que Nanterre Amandiers a été précurseur. Merci à Patrice Chéreau et à Pierre Romans qui lui, hélas, aujourd’hui n’est plus.
PLUS LA SCÈNE est nue, plus l’action y fait naître de prestiges. Plus elle est austère et rigide, plus l’imagination…