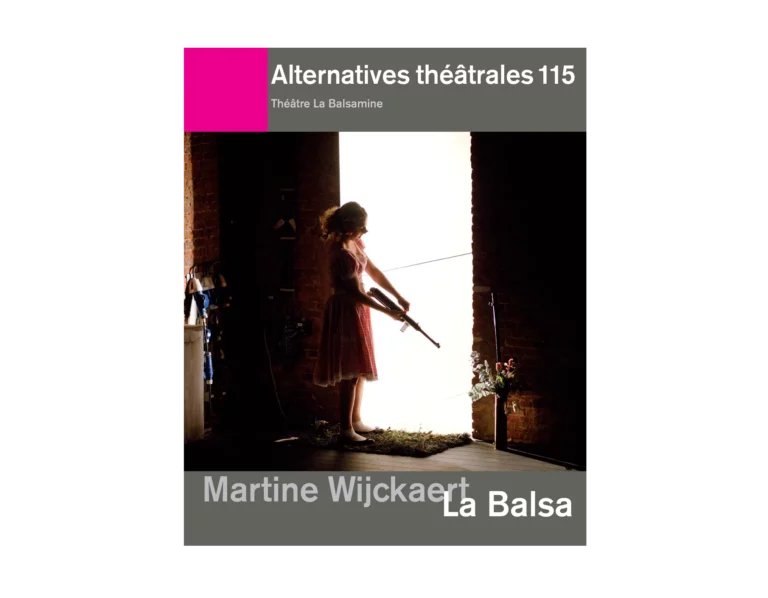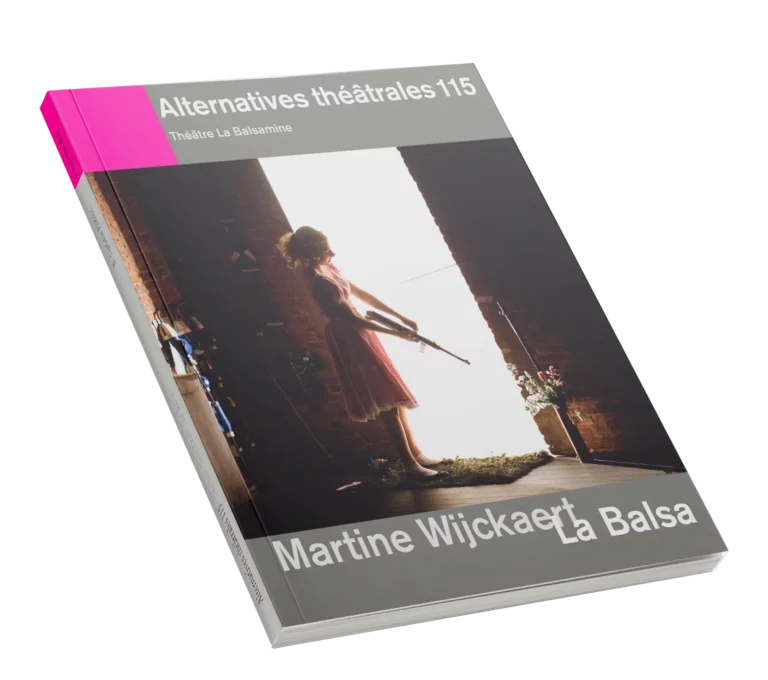ISABELLE DUMONT : Comment a démarré votre collaboration avec Martine Wijckaert ?
Stéphanie Daniel : En 1989, Martine avait travaillé sur LE PLUS HEUREUX DES TROIS de Labiche avec un éclairagiste qui s’appelait Hervé Audibert. Elle lui avait également proposé de créer les lumières de son spectacle suivant, LES CHUTES DU NIAGARA, en 1992, mais au dernier moment, Hervé a eu un empêchement et a pensé à moi (je venais juste de terminer un spectacle sur lequel j’avais été son assistante, spectacle dans lequel jouait également le frère de Valérie Jung, la scénographe de Martine). Hervé a parlé de moi à Martine, relayé par les propos bienveillants de Mathias, le frère de Valérie. À quinze jours de la première, Martine me contactait et me proposait la conception lumière de son spectacle !
C’était la première fois que quelqu’un m’appelait en tant qu’éclairagiste sans même me connaître, j’étais donc flattée et… quelque peu stressée. Martine est venue me chercher à la gare et, pendant une heure trente environ, elle m’a raconté le spectacle, son concept, ses envies. Ceux qui la connaissent savent qu’elle a une façon bien particulière de s’exprimer et comprendront mon désarroi : je restais stoïque et j’acquiesçais, mais j’étais terrorisée car je ne comprenais rien à ce qu’elle me racontait !
J’ai, par la suite, assisté à un filage et j’ai raccordé les fils. Le travail a pu commencer : dix jours et dix nuits non-stop ! On en rigole encore maintenant…
I. D.: Écrivant sur les débuts de son parcours (entre 1974 et 1980), Martine livre ceci sur son site internet : « La matière, la consistance de la matière ont fondé ma façon de faire, à mon corps défendant, de même que l’incidence directe de la lumière naturelle sur le cours de la représentation. Cette préoccupation ne me quittera plus jamais. » Je me souviens ainsi d’avoir vu en 1986 sa version de ROMÉO ET JULIETTE de nuit, le spectacle finissant au moment où la lumière du jour envahissait le plateau…
S. D.: Les spectacles sur lesquels j’ai travaillé avec Martine ont toujours été créés dans une « boîte noire », sans aucun lien avec la temporalité naturelle. Dans NATURE MORTE, toutefois tout le travail a été de chercher à reproduire une lumière naturelle qui évolue avec le jour. Je pense que c’est la seule création où la conscience à reproduire quelque chose de réel était forte. C’est la première fois où j’ai cherché vraiment à restituer une « vérité » lumineuse. Dans les autres spectacles, ce sont plutôt des sensations, des impressions que je cherche à reproduire même si elles font toujours référence à une certaine temporalité.
Le seul spectacle avec un lien extérieur a été MADEMOISELLE JULIE : les fenêtres étaient ouvertes, en relation directe avec la vraie nuit extérieure ; mais une fausse lune apparaissait et tout était imagé, sans reproduction réelle… Le vrai avait été volontairement transformé en faux alors que dans NATURE MORTE, tout le travail a été de chercher à reproduire une lumière, on essayait de transformer le faux en vrai.
I. D.: Martine a donc des souhaits très concrets au niveau de la lumière ?
S. D.: Oui, avant de commencer elle a déjà des images et des envies précises, autant sur la scénographie que sur la lumière. La construction de ses spectacles est vraiment liée aux mouvements de la lumière naturelle, celle du soleil, de la lune, sans compter les éclipses, les éclairs et autres phénomènes météorologiques lumineux… C’est un cadeau pour un concepteur lumière. Tout mon travail consiste à comprendre et à interpréter ses désirs et à les prendre à ma charge, en y apportant quelque chose de plus ou de différent selon les problèmes techniques, ma propre sensation ou selon l’avancée du projet. Cela peut paraître frustrant à la première lecture du scénario de constater : « Tout est déjà écrit, je n’ai plus rien à faire ». Un technicien pourrait peut-être reproduire ce qu’elle a mis sur papier mais j’ai compris qu’elle attendait de moi une autre vision des choses, qui aille dans son sens et à laquelle elle n’aurait pas pensé.
I. D.: Pouvez-vous me donner un exemple ?
S. D.: L’aurore boréale, par exemple. Martine avait vu des aurores boréales en Islande et en voulait une sur scène dans LE TERRITOIRE. Je pense qu’il y a dix façons de faire une aurore boréale, comme il y a dix façons de faire une éclipse. Comment, avec les données techniques, les contraintes, les atouts des lieux, le budget et la scénographie, arriver à obtenir le résultat souhaité ? Ce qui est vraiment bien avec Martine c’est que, même si elle a des idées très claires sur ce qu’elle veut, elle est à l’écoute et elle est tout à fait disposée à ce que son projet soit un peu modifié, tant que ça va dans son sens. Elle n’est pas figée sur ses visions.
I. D.: Vous avez aussi conçu les lumières de ET DE TOUTES MES TERRES, à partir des rois de Shakespeare, ensuite la trilogie CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE, TABLE DES MATIÈRES, LE TERRITOIRE, ainsi que WIJCKAERT, UN INTERLUDE. Avez-vous perçu une évolution dans la relation de Martine à la lumière ? Ou des variations ? Ou des constantes ?
S. D.: C’est très variable d’un projet à l’autre, mais avec des lignes de force constantes. Je crois que dans tous les spectacles, il y a un zénith ! La relation à la lumière est toujours très importante et légitimée par les interprètes, les situations, le texte ; la lumière n’est jamais un effet gratuit, elle est un partenaire à part entière.