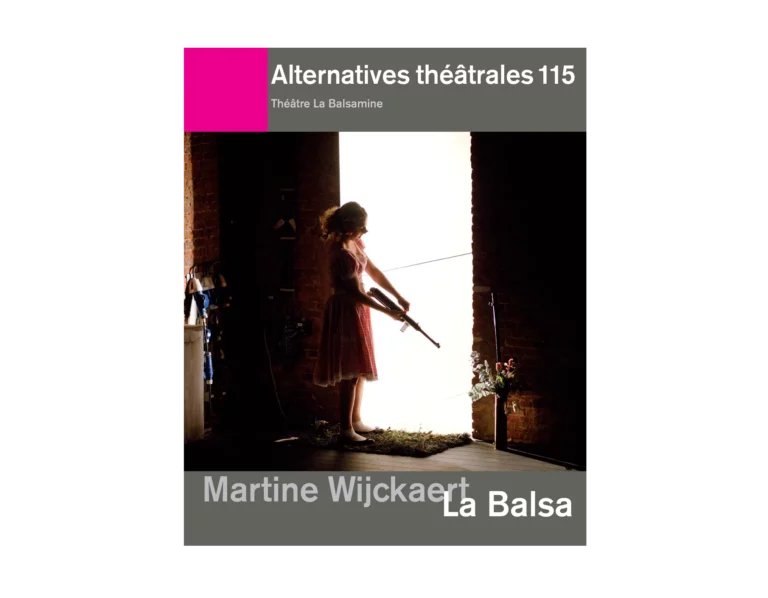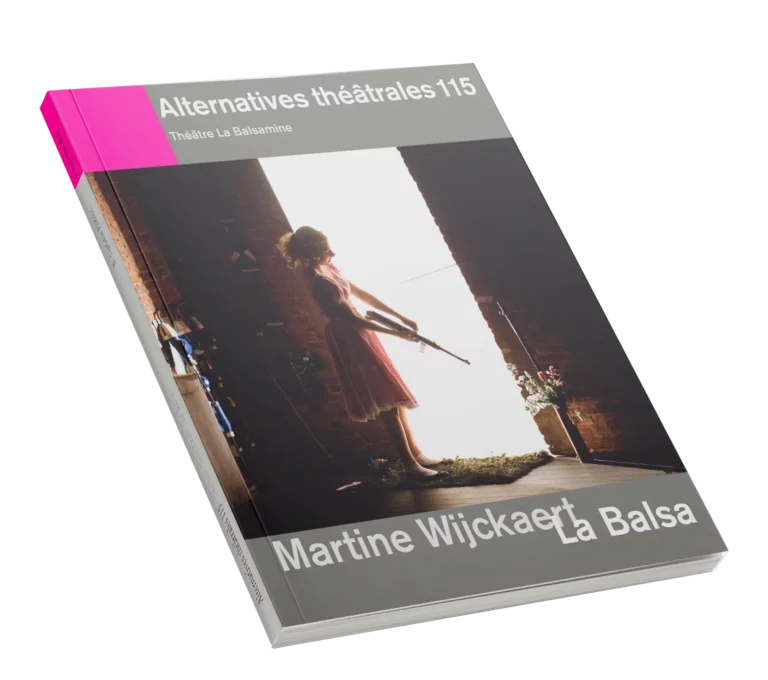AU SOL, sur le vaste plateau du Théâtre de la Balsamine, une forêt de verres à pied usagés : certains plus opaques, maculés de traces de doigts, comme le révèle ici et là un éclairage blafard et ingrat, « à l’allemande », si proche parfois des lumières de service ; d’autres lestés en leur fond d’un reste asséché de liquide violacé – du vin probablement. 1265 verres selon la brochure, 1440 selon la presse, soit, de la volonté de l’auteur et metteur en scène : le nombre de jours de sevrage et d’abstinence qui se sont « écoulés » depuis le début de sa cure de désintoxication. Des verres dépareillés, tous différents, comme on en récupère à l’abandon et d’abondance dans les braderies et vide-greniers. Comme sont uniques et singulières, selon l’humeur ambivalente, les journées sereines ou agitées, inquiètes ou apaisées, euphoriques ou angoissées de l’abstinent-pénitent. Comme sont uniques et singuliers aussi les cas et les sujets, les histoires de vie, les expériences et les imaginaires, les résistances et leurs (re)chutes.
Installation
Pour un peu, le verre se ferait presque objet anthropomorphe. Toute une population de verres… Certes à la différence de la bouteille, il n’a pas de goulot – de gueule, de bouche, de gosier… Mais il a un ventre, tout comme le destinataire de son contenu. Et puis surtout il a un pied : unijambiste de naissance, son équilibre est fragile, aussi fragile que le verre – la matière cette fois – dont il est soufflé. Tel Œdipe et ses aïeux, symptôme probable du tragique dont il est investi, le verre au pied unique boîte, claudique, s’efforce de tenir debout malgré son handicap, lutte pour sa verticalité, défend sa frêle stabilité contre une assise précaire, toujours menacé de chute, de bris et d’éclats.
Autour de ce qu’il faut bien appeler une « installation » d’un genre bien particulier, de celles qui relèvent du principe de la « collection » – façon Boltanski, Annette Messager, Arte Povera voire Macha Makeieff elle-même un temps très encline à l’accumulation primitive des verres de cantine de la marque Duralex –, le théâtre offre sa cage de scène dans sa nudité la plus dépouillée, métaphore du personnage lui-même exposé et mis à nu : murs gris foncé, banquette de béton de même couleur le long des dégagements latéraux, issue de secours obturée par un rideau noir dont la cachette semble dissimuler un coin toilettes, si l’on en juge par le bruit de l’urine se fracassant sur la paroi d’un vase de nuit lors de la sortie momentanée de l’actrice, et, toujours dans l’ordre du flux et l’écoulement, les deux radiateurs en fonte du chauffage central dont l’un, celui de gauche, verra s’écraser en éclats le cadavre d’une bouteille vide, dérisoire baptême d’une épave échouée ou naufragée, puis la lance d’incendie, enfin, détournée de sa fonction pour étancher la soif du personnage anonyme, comme les alcooliques du même nom, dans un moment frénétique d’égarement et de manque intense.
Virtuosité
L’espace ainsi planté, reste à pasticher Vitez : l’actrice entre en scène, on va savoir… Grande échassière perchée sur les talons de ses escarpins, héron ou pélican bientôt propulsé dans un magasin de porcelaine– une « ménagerie de verre » peut-être ? –, Dominique Grosjean apparaît en fond de scène, immenses lunettes panoramiques de star ou de diva déchue, pullover mauve demi-deuil aux formes amples, comme pour mieux dissimuler le buste d’un corps mal assumé ou déformé par les excès, minijupe noire sur une paire de jambes longues, bien plantées, recouvertes d’un léger nylon également noir, deuil entier cette fois, le tout surmonté d’un visage rond et plein ainsi que d’une longue et abondante chevelure rousse – couleur de feu, celle du diable et de l’enfer – une tignasse saine, drue, et donc en contraste radical, aussi paradoxal que la solidité des jambes, avec le mal être et la douleur de la crise existentielle très vite révélée par les mots émis depuis ce corps sain.
Avec l’irruption de l’humain à l’orée de cette futaie de calices abandonnés, l’espace devient soudain labyrinthique, dédale mythologique appelant l’exploit, ou dérisoire palais des glaces de fête foraine « à tromper les gens du bout de la semaine » disait Céline.
Pour tracer des diagonales et trouver son chemin, l’actrice va devoir slalomer comme le plus virtuose des skieurs alpins ou des champions de gymkhana. Si elle semble tituber, jusqu’à parfois chanceler ou se tordre la cheville, ce ne sera dû qu’à la contrainte scénographique, pas au naturalisme de la situation. Et le miracle a lieu puisqu’aucun verre n’est bousculé ni renversé. Dans l’espace matériel de son ébriété, l’alcoolique se révèle virtuose, il est transfiguré, touché par la grâce.
Pourtant, la honte subsiste : la comédienne jouera souvent dos au public. De cette tare, dans l’abstinence comme dans la rechute, il faut publiquement se cacher – maladie honteuse, intime, inavouable. Là se joue le titre de l’œuvre : comme au zoo, celle qui descend du singe est en cage, une cage invisible, mentale, imaginaire et symbolique, celle de son aliénation, voire de son addiction à l’enfer éthylique. Prisonnière du besoin qui la dévore et la consume, elle se croit observée à chaque instant par une société panoptique dont la morale universelle est synonyme de modération, de tempérance et de sobriété, une société qui la condamne, du moins le croit-elle, qui la guette et la traque, du moins le croit-elle, et resserre en elle à tout jamais l’étau de la culpabilité. Des sursauts de hargne et de dépit embraseront sa colère et ses accès de fièvre, mais ne parviendront jamais à faire oublier ce large sourire éphémère de plénitude et de joie, presque béat.
Manque ?
De ce spectacle, je retiendrai personnellement une image, pour moi la plus forte : la séquence au cours de laquelle, privée de tire-bouchon, le personnage sans nom, actrice ou auteur, Dominique-Martine, décide de déboucher sa bouteille de vin rouge avec les moyens du bord – encore une belle métaphore, une de plus, de la créativité artistique et de ses contraintes ! Avec la méticulosité artisanale d’un bricoleur très débrouillard voire d’un inventeur du concours Lépine, poussée par l’urgence et le sauve-qui-peut, l’actrice se dépouille de son vaste pull, laissant par ailleurs apparaitre un corsage satiné de couleur fauve aussi féminin qu’appareillé à la couleur de sa chevelure, puis cloue le pull au mur du lointain, presque comme si c’était sa propre peau de chagrin, entre parchemin et trophée de chasse transformé en descente de lit. Ce qui va suivre sort du commun. À coups répétés, le cul de la bouteille frappé avec force contre l’amorti du lainage, le mur, sous la pression, aura finalement raison du bouchon, libérant l’éjaculation mousseuse d’un liquide violacé, perdu pour la saveur et pour le goût, et dont le reste ne sera avidement consommé que pour l’obtention assommante et brutale d’une ébriété foudroyante.
Pour l’alcoolique confronté à son manque ou à son besoin, rien n’est impossible. L’urgence exalte sa ruse et son ingéniosité. Et ce n’est pas l’absence d’un banal ustensile, même s’il semble indispensable, qui entravera l’irrésistible inventivité de sa dépendance. Dans un tout autre genre, sur un mode comique, voire farcesque, des FRÈRES ZÉNITH aux PENSIONNAIRES, Jérôme Deschamps et Macha Makeieff ont aussi exprimé à ce sujet quelques belles fulgurances burlesques.
Martine Wijckaert, ce n’est un secret pour personne, est obsédée par les visions de l’enfer et de l’alcool. Elle a donné là, avec l’indispensable complicité de Dominique Grosjean, l’un des textes et l’une des mises en scène les plus sincères, les plus exigeantes, les plus perturbantes, et les plus dénuées de concessions et de complaisance qu’on puisse imaginer sur le sujet. N’est-ce-pas là, et peut-être d’abord, l’une des définitions les plus pertinentes que l’on puisse donner de l’artiste ? Citons encore une fois Céline à qui l’on demandait ce qui le distinguait des autres artistes : « Eh ben, c’est que moi je mets ma peau à table…»