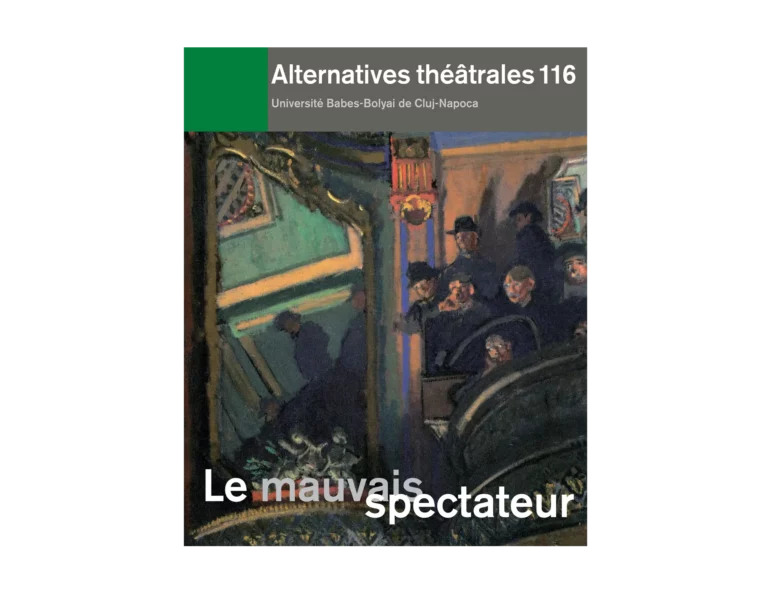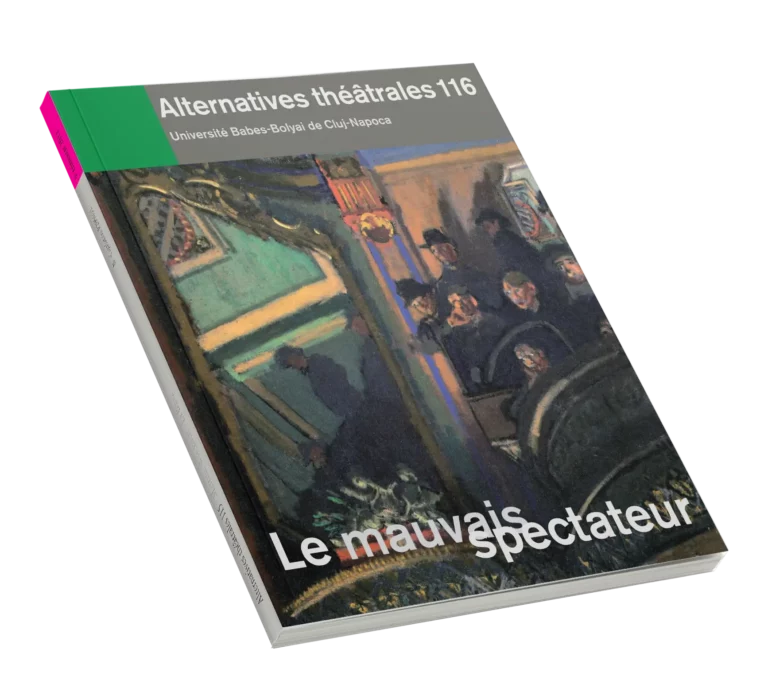ÉCRIVAIN REDOUTABLE à la plume redoutée, Witold Grombrowicz continue d’interroger les publics sur sa forme. On le qualifie de marginal, il se qualifie d’incompris. Difficile de le classer dans un genre littéraire, de le ranger dans une classe sociale, politique ou religieuse ; en marge, de la société.
Auteur de trois pièces de théâtre, cinq romans, un recueil de nouvelles, un journal de trois tomes d’environ mille pages, et des chroniques, on ne sait où situer l’écrivain dans le champ littéraire, ni à quel genre le rattacher ou dans quelle période l’intégrer. Son mode d’écriture reste le jeu, ses règles, c’est lui qui les pose mais elles se modifient à mesure qu’il y joue. Gombrowicz brouille les cartes, il travestit, farde, arrange et s’arrange.
Et parce que son écriture rejoint le plus souvent l’intime, on la rattache souvent à l’autobiographie. Le temps de son apogée est aussi celui de la modernité, où le sujet laisse place à l’objet, où l’écriture n’est plus tournée vers Dieu mais vers l’homme, où la structure devient insensée. C’est une nouvelle ère qui repose la question du genre autobiographique et la place du sujet dans la littérature.
L’autobiographie prend alors des significations autres. Elle signe un pacte différent de celui, classique, que proposait Lejeune, un pacte qui reposait sur la confiance et n’accordait pas de place à la duplicité des actes ou des paroles. Mais les autobiographes se laissant séduire par la fiction et ce qu’elle autorise, permettant une valorisation de soi, de raconter ce qu’est le personnage sans être directement ce « moi », une fiction à travers laquelle ils peuvent se surprendre, se découvrir, se redécouvrir, ils ont progressivement brisé le pacte jusqu’à privilégier une mise en jeu réelle du « moi ».
De l’autobiographie en découle un nouveau terme, un terme contemporain, le terme « d’autofiction » qui est rattaché à « l’autobiographie moderne » ou encore à la « Nouvelle Autobiographie », des termes qui finissent par se perdre dans un « espace autobiographique ».
Ce néologisme, inventé par Serge Doubrovsky en 1977, est la réplique parfaite à l’autobiographie pour la sortir des impasses dans lesquelles elle s’était engouffrée. Dès lors, l’autofiction devient une mode, portant un regard à la fois sur l’être intime et sur l’universel. Elle devient un usage courant, un prétexte pour masquer au mieux un « moi » qui ne saurait en dire trop à son sujet.
Avec l’autofiction, la part d’inventivité et de fiction dépasse l’entière vérité et l’authenticité de l’auteur que le lecteur est censée lire à travers la prose ; l’autobiographie évolue ainsi peu à peu vers l’autofiction jusqu’à se perdre dans la confusion. L’autofiction devient ce mélange entre le « moi » et la fiction où l’écrivain se reflète nécessairement dans le miroir de la fiction afin d’y interroger un autre visage que le sien. Un genre qui évolue sur le mode des souvenirs d’enfance, des fragments de vie mis en action sous le joug de l’art, ses libertés, ses limites. Un « moi » transcendé par l’art, transformé par l’écriture, la création.
Dans ces années où le Nouveau Roman est en pleine apogée et la littérature une héroïne, où les nouveaux romanciers tels que Sarraute, Simon ou encore Robbe- Grillet, écrivent pour la passion d’écrire, Gombrowicz poursuit sa quête existentielle du « moi », questionné aux côtés du héros, le meilleur soutien d’autrefois. Usant des formes de l’intime, faisant de lui le sujet principal de son journal ou encore de ses mémoires (SOUVENIRS DE POLOGNE) et de son testament, il reste un « moi » au-deçà, un « moi » qui n’est pas là pour se raconter mais pour combattre (l’autre et lui-même en même temps), son double, son diable.
Gombrowicz est l’écrivain du « moi », du masque et de la « gueule », questionnant l’identité, la sienne comme celle d’autrui, et parce qu’il écrit à partir de lui comme source originelle tout en restant en lien avec l’Histoire, il semble être l’incarnation même de ce genre nouveau et même plus.
Évoluant vers un modernisme certain, il continue de mettre l’individu sur les devants de la scène, et plus encore de placer l’auteur au centre de la littérature, faisant de son « moi » le principal enjeu. En transgressant le genre, il le dépasse, puisant dans les formes anciennes (style de la gaweda, baroque sarmate, influence Shakespearienne) et les modernisant, écrivant non pas pour le plaisir des mots, mais pour défier l’individu, tout comme il se défie.
En cela, il est le praticien d’une théorie annoncée, le précurseur d’un genre dans ce qu’il a de plus novateur, de plus intéressant, dans cette manière d’engager le corps du sujet écrivant, dans l’inséparable duo du « vivre/écrire ».