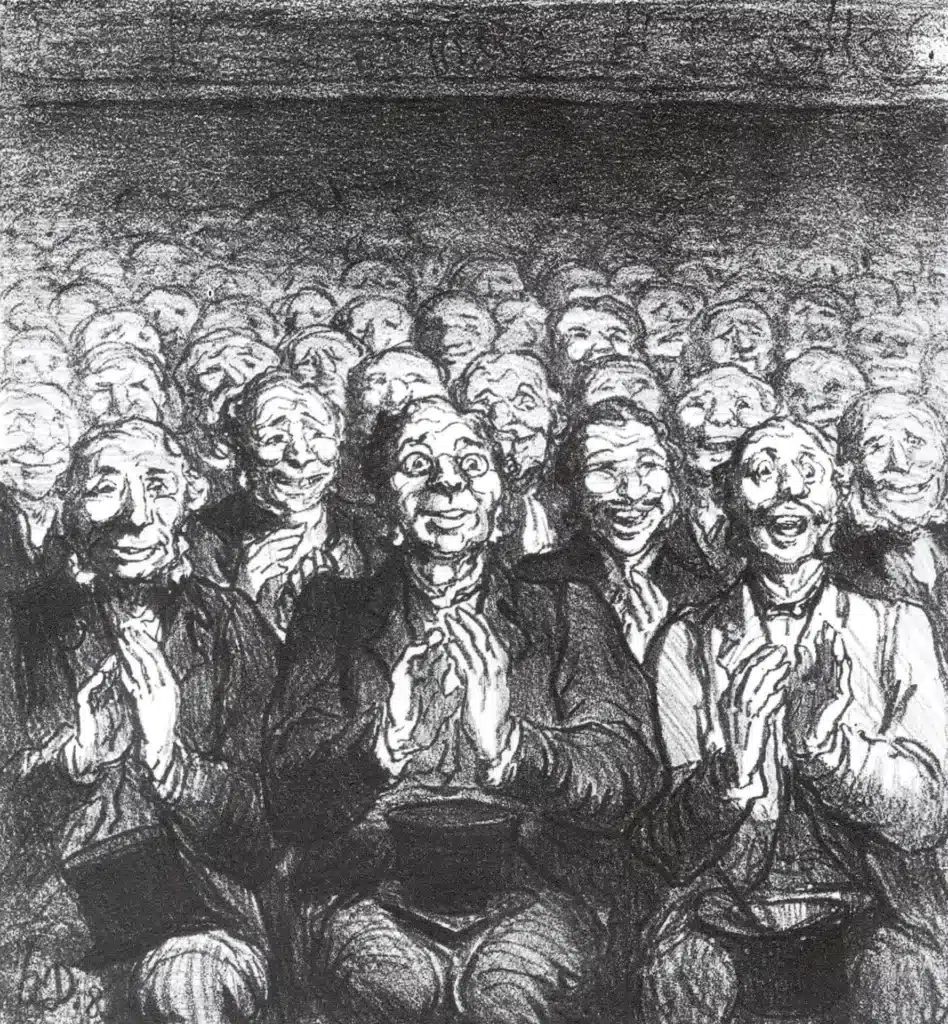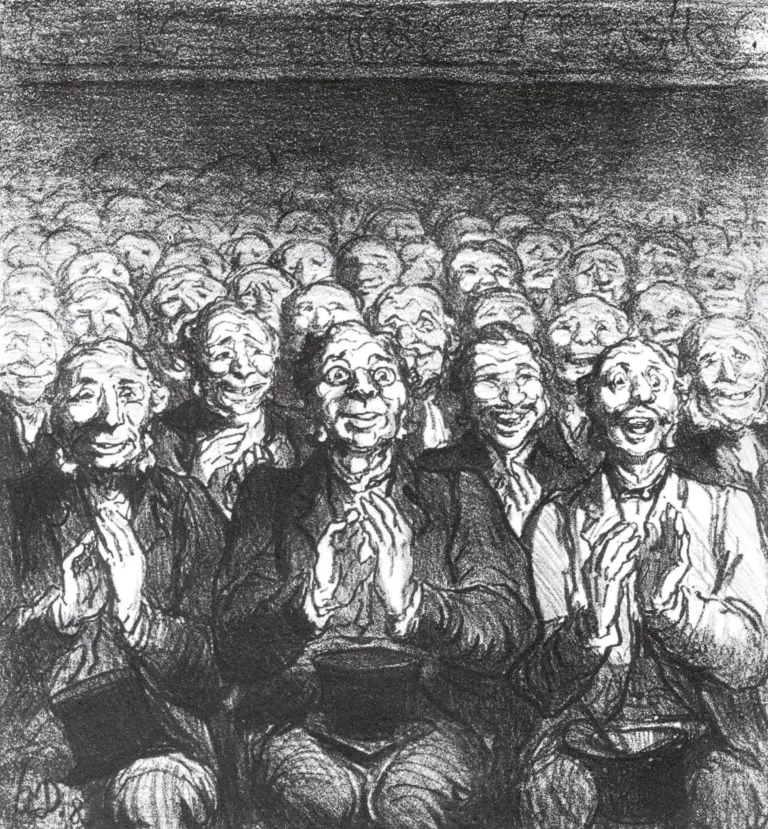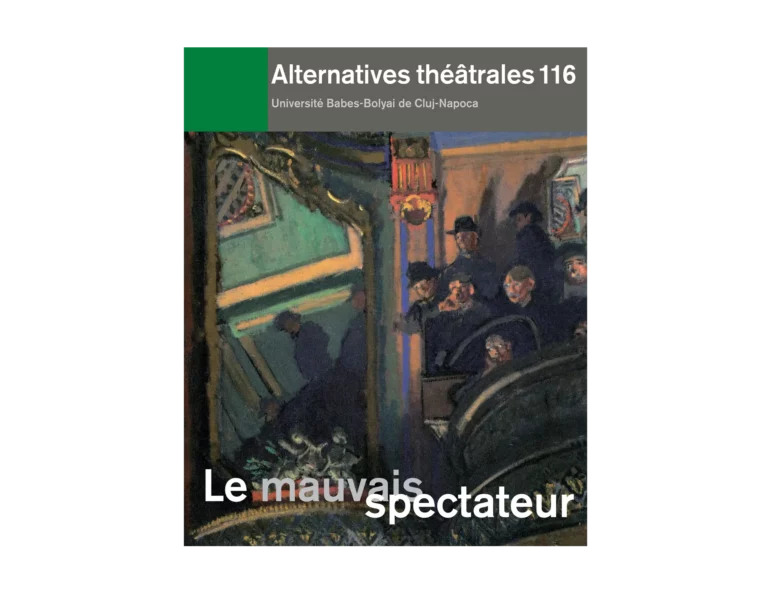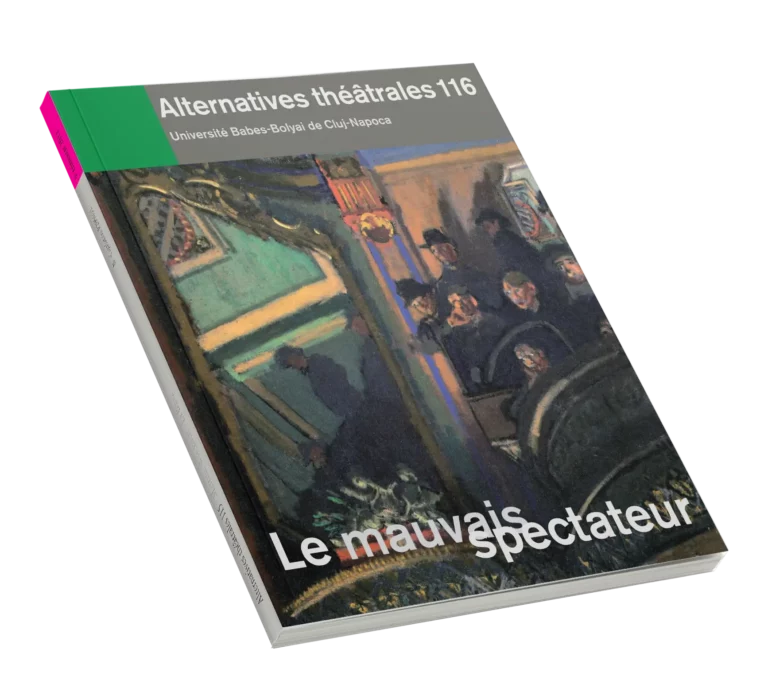JE NE SAIS PAS ce qu’est un « mauvais spectateur ». Peut-être que l’acception la plus évidente, à laquelle Stefana Pop-Curseu, qui avait lancé autrefois ce thème de réflexion, aura pensé, c’est celle du « névrotique », à savoir, comme le suggère d’ailleurs Octave Mannoni, quelqu’un d’aussi transfiguré par le spectacle de théâtre qu’il devient incapable de faire encore la distinction entre fiction et réalité. Quelqu’un qui oublie que l’art est une illusion consentie, ou bien, dans les termes de Coleridge, « une suspension voulue de l’incroyance », c’est-à-dire l’adoption consciente d’une deuxième naïveté, supérieure.
L’association formelle avec l’expression de Sartre, « mauvaise foi », s’impose d’emblée, tout naturellement. L’accepter signifie désigner quelqu’un qui s’implique, de même, d’une manière amendable. Les deux expressions renvoient à ce qui se passe quand on se ment à soi-même. L’acception sartrienne de l’« auto-illusion » est bien connue. La « mauvaise foi » n’est autre chose qu’une défense psychique à laquelle on recourt afin de faire face à l’angoisse qui découle de la liberté. C’est, en des termes spécifiques, l’attitude d’auto-illusion de l’être humain qui, sous la pression des forces sociales, adopte des valeurs inauthentiques et en vient à s’auto-aliéner par rapport à sa liberté innée d’agir de manière authentique. Ce type de perception retournée conduit à l’auto-réification. L’expression de la « mauvaise foi », c’est justement la paradoxale décision libre de l’être humain (mobilisé contre sa liberté même, constitutive, inévitable) de nier sa propre liberté, de se défaire, dit Sartre, de la liberté à laquelle il a été condamné.
Est-ce donc moins clair que la manière dont le spectateur de théâtre peut s’abuser lui-même ? Que veut dire « se mentir à soi-même » dans le cas de l’art, qui reste foncièrement ambigu, symbolique, et ce d’autant plus aujourd’hui, quand la perspective traditionnelle de la découverte du sens « correct » de l’œuvre est mise en crise ? Le « mauvais spectateur » serait-il celui qui transfère une manière inauthentique d’être sur le spectacle, en l’interprétant de manière désynchronisée par rapport aux intentions et présuppositions du metteur en scène ?
Si oui, alors cela veut dire qu’il y a des sens multiples dans lesquels on peut devenir « mauvais spectateur ».
Tout d’abord, le mauvais spectateur peut être celui qui se concentre sur la mise chimérique du décèlement de l’intention de l’auteur empirique – tendance qui peut mener au biographisme vulgaire –, en oubliant que l’« auteur idéal » (désirable pour sa complexité) est une augmentation, aussi par le réservoir de ses « intentions inconscientes », du premier. On est, en d’autres termes, « mauvais spectateur » quand on accentue des éléments insignifiants, superficiels, du spectacle. Une des manières de miner la réception est, donc, de ne pas se mettre entre parenthèses en tant que spectateur empirique. À cela correspond un déficit de concentration, une impossibilité (provisoire) d’adoption de l’attitude esthétique.
La surinterprétation représente le défaut de sens contraire. Si le spectacle est l’«œuvre collective » d’un metteur en scène et de son équipe, le mauvais spectateur falsifie les présuppositions et le contexte organique de l’œuvre (cette intentio operis dont parlait Umberto Eco). Il impose sa propre hégémonie, en essayant de coloniser le spectacle avec ses propres interprétations et associations beaucoup trop libres, qui ne sont pas limitées par les données de l’œuvre. Sa dérive herméneutique ne peut, cependant, se confondre avec la lecture insoumise et explosive du metteur en scène, qui renverse et incendie souvent les sens consacrés de l’œuvre, la retourne et la soulève contre elle-même, en en repérant – éventuellement – les tensions fertiles. Au contraire, le « mauvais spectateur » est celui qui se leurre lui-même sans le savoir, en plaçant le spectacle dans le spectre de certaines attentes distordues par une idéologie quelconque (pas forcément politique) impropre à l’œuvre.
Si l’on prête attention à un tel danger, on va identifier le « mauvais spectateur » dans le spectateur unidimensionnel, conventionnel : quelqu’un qui se montrerait incapable de filtrer le spectacle à travers sa propre sensibilité, en l’interprétant exclusivement à travers des standards imposés idéologiquement. Les prisonniers de cette orthodoxie particulière, qui réduit la création artistique plurielle à une dimension unilatérale, sont, probablement, les plus proches du sens sartrien. Ils adoptent honnêtement une interprétation tendancieuse ou distordue de l’œuvre, en ignorant le fait même qu’ils ont des intérêts idéologiques d’opter pour cette interprétation-là. Leur blocage idéologique est un moyen de franchir le pas vers l’inauthenticité.
D’autre part, chaque spectateur qui devient captif de la consommation capitaliste semble se conduire de manière similaire (l’idéologie du totalitarisme communiste a, on le sait, ses propres victimes.) Il rate les champs authentiques de sens de l’œuvre par incapacité à s’approprier le cadre mental qu’elle propose. Je pense à ces catégories de spectateurs inaptes à réaliser une commutation sur la perspective que le spectacle veut promouvoir, puisqu’ils ont été formés par une culture du divertissement, des spectateurs qui – en se confrontant aux œuvres classiques de la dramaturgie européenne et/ou aux œuvres d’avant-garde – les découpent mentalement au format du divertissement. Ces spectateurs préformés ne peuvent pas opérer une adéquation de leur grille perceptive et culturelle aux exigences d’œuvres qui instituent une véritable rupture de niveau par rapport au système du divertissement et du show business.

La pensée néo-marxiste soutient que la structure même du théâtre traditionnel européen, la manière dont les représentations théâtrales sont conçues et dont la convention théâtrale est structurée, impose un tel spectateur. Il s’agirait, donc, de l’interaction de certains couples dialectiques : le théâtre européen (institutionnalisé) est celui qui pousse le spectateur dans l’inauthenticité, en le contraignant à se complaire dans des rêveries compensatoires.
Je me demande, cependant, quelle est la légitimité d’une telle typologie aujourd’hui, en pleine époque post-postmoderne ? N’y a‑t-il pas le risque qu’elle soit lue comme le rudiment d’une pensée autoritariste périmée, spécifique à la tradition moderniste, qui favorisait le centre unique et l’hégémonie de la raison ? Bien entendu, l’opposition entre modernisme et postmodernisme n’est pas aussi tranchante, le modernisme lui-même ayant assimilé, dès le début du siècle passé, la pluralité des voix romanesques et des autres formes de décentrement narratif. Je me demande, toutefois, si l’allusion de la formule « mauvais spectateur » à une hiérarchie axiologique des spectateurs de théâtre correspond encore à l’«habitus » culturel, où la « haute » culture patrimoniale égale la pop culture, la culture populaire urbaine. Peut-être que non, si l’on adopte la position des critiques de cette tendance d’abolition des hiérarchies axiologiques, qui ne l’interprètent pas comme un moyen de conférer du prestige à la culture populaire mais, au contraire, comme une forme impardonnable de nivellement, comme un attentat (réussi) à l’encontre de la haute culture.
D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de formuler cette interrogation à la lumière des exégèses postmodernes. On peut le faire même à partir de positions épistémologiques élémentaires. Il y a, en effet, le risque d’employer incorrectement l’expression « mauvais spectateur », qui, par ses connotations péjoratives, incorpore des jugements défavorables. La révision qui s’impose, dans de telles situations, où l’on fait appel à des mots à forte charge affective, alors qu’on semble désirer seulement décrire de manière neutre certains phénomènes, doit être faite en constatant que la valorisation en dit long sur les préférences et les idiosyncrasies de celui qui construit le jugement de valeur.
En ce qui me concerne, je proposerai de reformuler le syntagme « mauvais spectateur » à partir d’un autre, emprunté à Baudelaire. Je l’appellerais donc autrement, en résonance avec le fameux vers des FLEURS DU MAL : « hypocrite spectateur, mon semblable, mon frère ». Il faut préciser tout de suite que je préfère cette formule grâce à son ambiguïté. Elle vise, très probablement, un défaut qui ne peut pas être entièrement dépassé, mais seulement de manière provisoire, par une crise de conscience (auto)induite. Le vers en soi contient une invitation à la modération, un avertissement implicite, une relativisation de l’acte même de la condamnation et une solidarisation humaine avec la victime, geste qui dénote la conscience que l’accusateur lui-même pourrait glisser, insensiblement, dans le rôle de la victime.
Quant au « mauvais spectateur », le danger qui nous guette de commettre les gestes dont, à notre tour, on l’accuse est réel et toujours menaçant. Comme on le sait, le spectateur modèle n’existe pas. Il est purement et simplement approximé de manière asymptotique par la multitude virtuellement infinie de spectateurs empiriques, par les contextes différents de la réception. Beaucoup d’excès, au contraire, sont possibles.
Deux excès, de signe opposé, ont retenu mon attention : le vécu névrotique du spectacle et, aux antipodes, l’impossibilité de s’identifier de manière substitutive avec l’action vicariante de ceux qui se trouvent sur la scène. Je rappelle qu’il existe une doctrine de la réception théâtrale concurrente de celle de l’identification affective : celle de la distanciation, défaut inversement proportionnel à celui de la trop grande implication. Pas forcément de la distanciation brechtienne mais, plutôt, d’une distanciation qui a pour effet la perte de la dimension hédoniste de l’expérience du spectateur, dans le sens que Barthes invoquait à propos du « plaisir du texte ». C’est un danger qui guette en premier lieu le « bon » spectateur, l’hyper-spécialiste intéressé à démonter le spectacle d’un regard froid, presque clinique. Plus un tel professionnel du théâtre se croit à l’abri, plus il pourrait être exposé au risque d’illustrer lui-même le prototype hypothétique du mauvais spectateur.
Si le récepteur excessivement impliqué pouvait être jugé digne de désapprobation, parce qu’il sortait de la convention de l’art ou parce que la réception n’était pas conforme aux buts de l’artiste, pour le « spectateur expert » l’avertissement serait le suivant : lui-même peut incarner, dans certaines conditions, une des hypostases spécifiques du « mauvais spectateur ». Car, en dernière analyse, comment faut-il distinguer la conduite légitime du spectateur recommandable et distancé (manifestant une attitude critique du point de vue idéologique et artistique), de celle d’un détachement complètement non-adhérant, d’une non-collaboration avec l’oeuvre ? Comment éviter le risque de ne pas se laisser immerger, de rater les voies optimales d’accès ?
Puisque les certitudes manquent, peut-être que la seule manière prudente et modeste dont on puisse parler d’un « mauvais spectateur », c’est : « Ô, mauvais spectateur, mon semblable, mon frère…» L’ambiguïté de cette formule me détermine à lire le thème de réflexion proposé par Stefana Pop-Curseu et l’équipe de recherche ITIA (Histoire du Théâtre, Iconographie et Anthropologie Théâtrale), de la Faculté de Théâtre et Télévision de L’Université Babes-Bolyai de Cluj, non comme un verdict qu’il faut illustrer mais comme une interrogation sous-entendue.