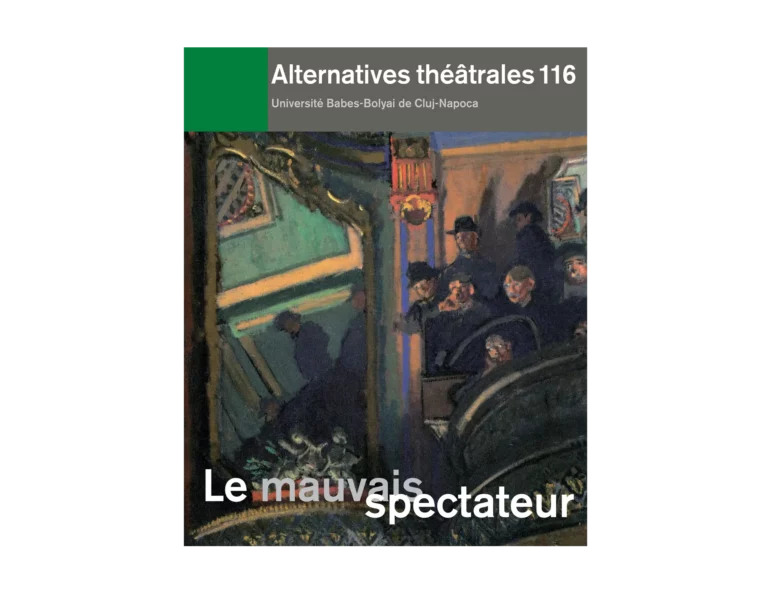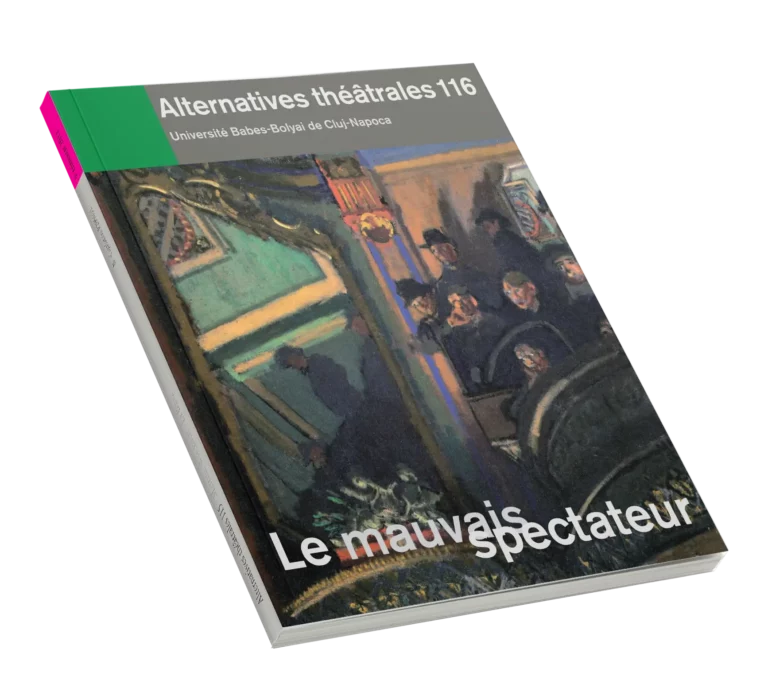N 1976, Brian O’Doherty entame une réflexion sur l’espace moderniste du White Cube, plaçant au cœur de sa démarche la question de la place offerte au spectateur par l’art contemporain. Dans un article intitulé « L’œil et le spectateur », il écrit :
« Tandis que nous déambulons dans cet espace en regardant les murs et en slalomant entre les choses posées au sol, nous prenons conscience que la galerie abrite aussi un fantôme errant dont il est souvent question dans les dépêches de l’avant-garde : le Spectateur. Qui est-il ce Spectateur, qu’on nomme aussi le Regardeur, ou l’Observateur, ou encore, à l’occasion, le sujet percevant (Perceiver) ? Il n’a pas de visage ; c’est avant tout un dos. Il se penche et scrute, avec un peu de gaucherie. Son attitude est toute d’interrogation, sa perplexité discrète. […] À la longue, le Spectateur se prend les pieds dans des rôles déroutants ; il est une pelote de réflexes moteurs, un errant adapté à la pénombre, le vivant d’un tableau vivant, un acteur manqué, voire un déclencheur de son et de lumière dans un espace truffé de mines artistiques. Il lui arrive même de s’entendre dire qu’il est un artiste et de se laisser convaincre que sa participation à ce qu’il observe, ou à ce qui le fait trébucher, est son authentique signature. »
À travers cette savoureuse description, O’Doherty montre bien la lourde tâche incombée à un visiteur dont on attend qu’il soit toujours plus « actif » face à une œuvre qui ne peut plus se passer de sa présence. En 1967, soit une dizaine d’années avant l’article de O’Doherty, le jeune critique d’art américain Michael Fried déclare dans la revue Artforum une guerre ouverte entre le théâtre et « l’art lui-même ». Que dit Fried dans cet article désormais célèbre qu’est « Art and Objecthood » ? Alors que la peinture américaine semble illustrer un certain triomphe de la pensée moderniste – c’est-à-dire une pratique s’inscrivant dans une « histoire ordonnée du processus d’autopurification des arts » –, des artistes nommés Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt ou Tony Smith bouleversent les formes en vigueur en tentant de libérer l’œuvre de la surface de la toile ou du socle. Le minimalisme est né, qui tendra à faire de l’art non une forme close, organisée de façon optique, mais bien une expérience. À ce mouvement artistique qui « a d’emblée représenté plus qu’un simple épisode dans l’histoire du goût », Fried adresse une réponse cinglante.
Le premier point concerne l’importance accordée par le courant minimaliste à la forme. What you see is what you see s’impose comme le mot d’ordre prôné par Stella, précurseur du mouvement : l’œuvre n’est rien d’autre que ce qu’elle est. Dès lors cette œuvre – cet objet – n’est plus une entité autosuffisante comme le requiert le modernisme. Sa littéralité (et c’est d’ailleurs comme littéraliste que Fried désigne le courant minimaliste) permet de décentrer l’intérêt sur ce que le critique appelle la situation, c’est-à-dire son inscription dans un contexte spatio-temporel dont le spectateur fait partie intégrante, soit, dit Fried, la théâtralité :
« La sensibilité littéraliste est théâtrale, tout d’abord parce qu’elle s’attache aux circonstances réelles de la rencontre entre l’œuvre littéraliste et le spectateur. […] L’art littéraliste s’éprouve comme un objet placé dans une situation qui, par définition presque, inclut le spectateur. […] La théâtralité qui caractérise ce mode d’appréhension “impersonnel, public” semble évidente : le format de l’œuvre, associé à son caractère non relationnel, unitaire, tient le spectateur à distance, non seulement physiquement mais aussi psychiquement. C’est même, pourrait-on dire, cette mise à distance qui fait du spectateur un sujet et de l’œuvre… un objet. »
C’est à partir de cette conception de l’objet littéraliste comme forme et présence que Fried va développer sa critique en trois affirmations désormais fameuses :