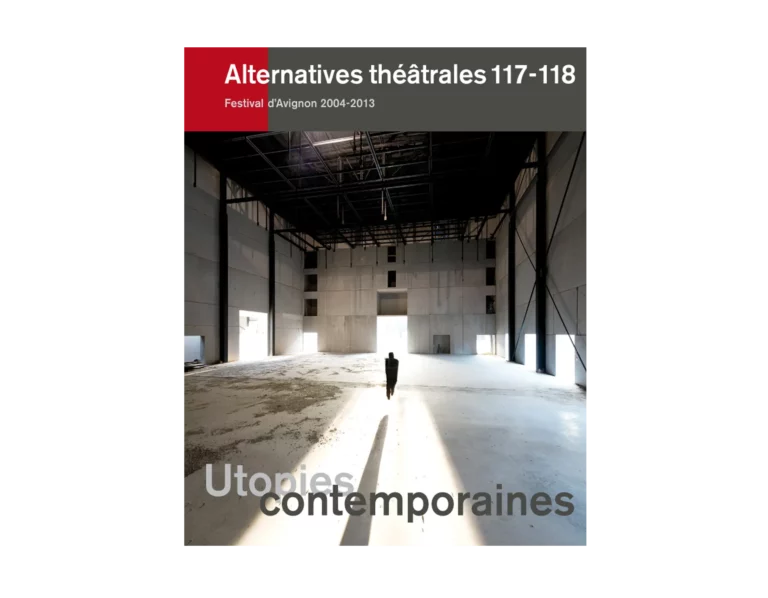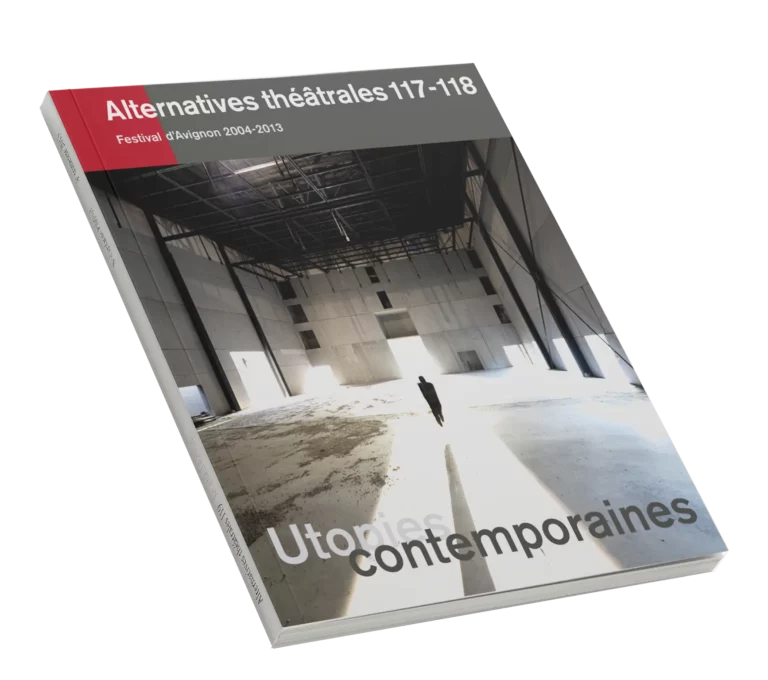DÈS LES PREMIÈRES ÉDITIONS du Festival d’Avignon, Jean Vilar affirmait avec force la participation du spectateur au processus de création : « Je vous l’ai dit : à chaque fois que vous êtes spectateurs – j’allais dire participants – d’un spectacle à Avignon, l’œuvre représentée prend un sens plus profond et plus vif. Car lorsque le comédien accomplit valablement sa tâche, quand l’auteur a fait la sienne, il reste encore, à l’heure des clarines, ce troisième bonhomme dont tout depuis toujours dépend : le public1 ».
« Participant », « fidèle » et/ou « assidu », voire « expert » : ces qualificatifs, récemment utilisés par
les sociologues des publics pour tenter de définir la spécificité du festivalier d’Avignon, continuent à mettre en exergue son engagement 2. Dans les pas de Vilar, Hortense Archambault et Vincent Baudriller ont d’emblée placé le spectateur et la communauté spectatorielle au cœur de leur projet pour le Festival d’Avignon. L’originalité de leur démarche consiste, depuis 2004, à réinventer le Festival en misant sur la curiosité du spectateur comme moteur de son engagement. Ainsi, le contrat avec le festivalier se fonde sur la confiance dans sa capacité à s’étonner, à s’interroger, à repousser les frontières du connu pour explorer
de nouveaux territoires, à confronter son point de vue singulier à ceux, pluriels, de la communauté qui l’englobe, bref, à prendre le risque d’être bousculé, déstabilisé. En retour, il bénéficie d’une série de dispositifs conçus pour l’accompagner tout au long de ce qu’Archambault et Baudriller nomment sa « traversée ». Cette expérience à la fois singulière et collective conduit le spectateur toujours engagé, parfois « décentré3 », à construire un regard et un discours critiques, à inventer de nouvelles façons de s’approprier le Festival, à s’émanciper, enfin, au sens où l’entend Jacques Rancière4.
La structure complexe qu’Archambault et Baudriller ont imaginée pour le Festival invite à l’exploration. Plutôt qu’une juxtaposition de spectacles, qui induirait pour le festivalier un parcours linéaire, les co-directeurs proposent une programmation qui s‘organise, telle une constellation, autour d’un, voire deux artistes associés qui ouvrent leur laboratoire de création au public. Il s’agit donc pour le spectateur de « traverser » le Festival, selon un parcours oblique, indirect, comme l’étymologie l’indique, de mettre au jour échos et résonances au sein d’une même édition et d’une édition à l’autre, de construire son propre réseau de correspondances. Cette configuration structurelle en réseau, faite de connexions, de liens actifs et d’espaces de partage, est probablement à rapprocher de la révolution numérique et du développement d’internet à la fin des années 1990, qui redéfinissent le rapport au voir et au savoir, et, pour Baudriller, inaugurent une nouvelle étape dans l’histoire du Festival d’Avignon. Au tournant du XXIe siècle, les deux co-directeurs réaffirment avec force la vocation
expérimentale du Festival, laboratoire tout autant que vitrine de la création contemporaine.