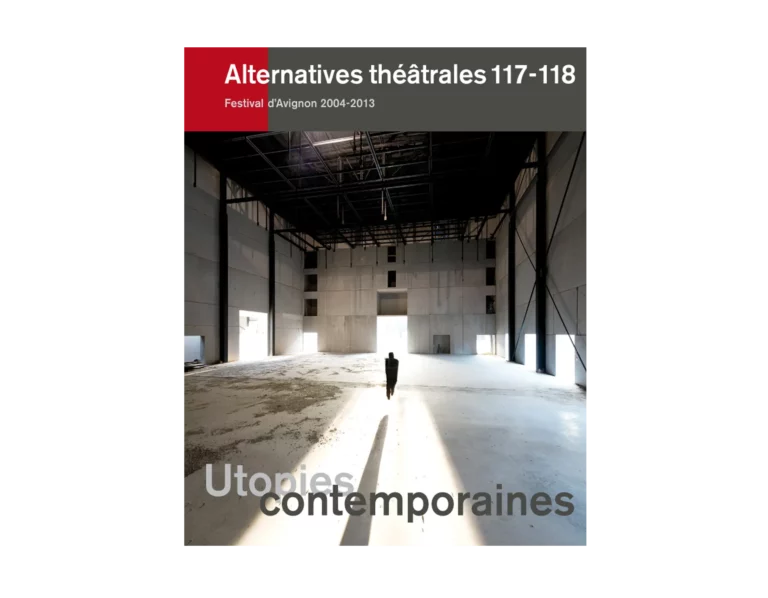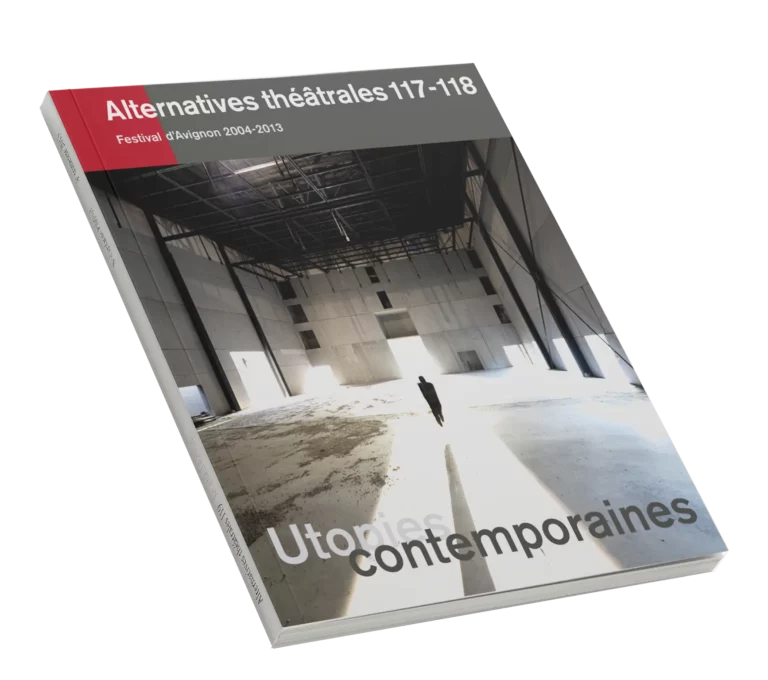CHANTAL HURAULT : Vous qui voyagez à travers le monde avec votre compagnie, Complicite, que retenez-vous de cette « étape » à Avignon en 2012 ? Comment avez-vous appréhendé cette expérience d‘artiste associé ?
Simon McBurney : Le choix des spectacles et des artistes s’est fait à partir d’un long et intense échange avec Archambault et Vincent Baudriller autour du théâtre et de l’engagement philosophique, durant les deux ans précédant cette édition. Ce qui est formidable dans ce projet d’artiste associé est qu’il instaure un dialogue géographique, une ouverture vers tous les coins du globe. La programmation ne se construit pas à partir d’un noyau central qui serait seul à être en mouvement. C’est l’Allemagne avec Thomas Ostermeier, l’Angleterre avec moi, c’est l’Afrique qui est là aujourd’hui avec Dieudonné Niangouna. Cela contribue à rassembler
un grand nombre de personnes qui viennent avec le désir de participer à un voyage.
Le public que j’ai rencontré a une grande disponibilité à la découverte. Ce n’est pas un simple consommateur d’art, il a un œil critique tout en étant ouvert à la discussion. Il s’est depuis dix ans familiarisé avec cette volonté de concevoir chaque édition comme un voyage, d’embarquer dans un bateau en ayant acheté un billet sans destination connue… Il y a bien sûr eu des chocs tout au long de l’histoire du Festival, mais ce qu’Hortense Archambault et Vincent Baudriller ont initié, et dont je parle, invite à un voyage collectif.
Je dirais qu’en un sens ma situation a été privilégiée, je suis venu après Castellucci, après Jan Fabre ou Marthaler. Si au début peut-être il y a eu des résistances de la part de certains critiques, d’une partie du public, on ressent aujourd’hui une véritable envie de découvrir des formes nouvelles. Cette situation m’a été bénéfique et a permis une concentration sur le texte qu’on a proposé au lieu de s’éparpiller sur des questions de formes. Je suis avant tout un raconteur d’histoires. Il a été fondamental de pouvoir confronter des pensées, des formes d’expression, non pas dans le but de provoquer mais d’engager ensemble une réflexion sur la société et sur l’art théâtral – qui change beaucoup, et qui doit changer.
Le théâtre est un art de pie, un art de charlatan qui vole les voix, les styles des autres pour mieux raconter une histoire. S’il faut des soutanes pour raconter, on en prend, s’il faut des masques, on en prend, s’il faut du feu, des silhouettes ou des marionnettes, on en prend. De la musique, de la danse, du mime, de la lumière électrique ou de la vidéo, on en prend… Ce sont juste des moyens pour s’exprimer avec un public – pas devant lui, avec lui. L’acte théâtral n’appartient pas à l’imaginaire d’une seule personne. Quand on rit au théâtre, c’est un rire commun. Dans ces moments-là, notre conscience s’ouvre à la vie intérieure des autres, démentant l’idée reçue que nous serions des îles. C’est un mensonge, nous ne sommes pas seuls. Les plus grands artistes que l’on a découverts ces derniers temps sont selon moi ceux de la grotte Chauvet, ils nous rappellent que nous faisons partie de la nature. Dans leur manière de peindre les animaux, on saisit une dimension que le langage ne parvient pas à traduire.
On comprend pourquoi le théâtre ne fait pas seulement appel au texte, mais à quelque chose de beaucoup plus lointain. Le théâtre n’est pas un argument intellectuel, c’est un événement instinctif et collectif.
C. H. : Av ec LE MAÎTRE ET MARGUERITE vous avez choisi une œuvre qui, comme l’ensemble de vos spectacles, entreprend de raconter une histoire dans un entrecroisement de plusieurs autres. C’est ce qui fascine chez Boulgakov, c’est ce qui fascine également dans chacune de vos pièces. En adaptant ce roman qui parle de la religion et de la politique, quelles étaient vos intentions ? Est-ce que la Cour d’honneur, en tant que lieu historique, a été un élément déterminant dans la création ?
S. McB. : Je dois d’abord dire qu’en tant qu’étranger, on est un peu protégé par rapport au symbolisme que la Cour d’honneur a dans l’histoire du théâtre français et de l’attente qu’on peut en avoir. Cela ne veut pas dire que j’étais intact de tout. Monter LE MAÎTRE ET MARGUERITE dans la Cour d’honneur revenait à se confronter à ce qu’il y a de plus lointain dans ce lieu. Cependant, c’est avant tout un choix politique. L’histoire de la chrétienté a modelé notre société ; je ne parle pas ici de la croyance proprement dite, je parle de son influence. Même en République, les notions de devoir et de culpabilité sont dominantes, les lois économiques reposent toujours sur une conception de la rédemption – basée sur la culpabilité et le devoir. Boulgakov nous met face à des questions essentielles : à qui appartiennent les histoires qui dirigent nos actes ? Peut-on les changer ?
Le regard que Boulgakov porte sur la corruption de son époque dépasse le seul contexte de la tyrannie stalinienne pour dénoncer plus spécifiquement une société matérialiste. Le sujet n’est pas la perte de la foi, mais le fait que le matérialisme mène l’homme à une perte de la compassion. Nous sommes dans un tel fanatisme de la consommation que nous nous coupons de ce qui nous constitue intimement. La fiction du monde capitaliste semble être aujourd’hui la seule réalité possible. Or je crois que les hommes sont capables
de construire une autre histoire.
Les questions politiques, sociales et humaines dont je viens de parler concernent aussi le rôle du théâtre. Jean Vilar n’a cessé de l’interroger, notamment au sein de ce festival qu’il a créé dans l’après-guerre, dans un contexte de scission sociale très forte en France, entre collaboration et résistance. Dans l’acte même de monter RICHARD II dans la Cour d’honneur en 1947, pour le premier festival, Vilar a voulu que la vie culturelle puisse guérir des fêlures. C’est un désir touchant, presque naïf, et pourtant tellement vrai et indispensable. Il a obligé l’artiste à se positionner dans la société. Que fait l’artiste si ce n’est tenter de couper ce rideau de la fiction qui existe autour de nous et nous faire regarder le monde d’une nouvelle façon ? Voilà pourquoi je trouvais à propos de faire entendre ce texte dans la cour du Palais des papes.
Ce qui était important, et dont je n’étais vraiment pas certain, était de savoir si les gens allaient comprendre pour quelles raisons moi, cet Anglais un peu excentrique, avait décidé de présenter un texte russe pour exprimer cela dans ce lieu historique de la religion et du théâtre français.
C. H. : Vous avez évoqué la dimension historique de la Cour d’honneur. Votre spectacle a marqué l’histoire du Festival par une utilisation totale du lieu, le mur et la voûte étoilée. Comment avez-vous pris en compte cette configuration exceptionnelle dans votre mise en scène ?
S. McB. : Mes mises en scène évoluent toujours au fur et à mesure des représentations, d’un théâtre à un autre. Pour LE MAÎTRE ET MARGUERITE, j’avais visé directement la Cour d’honneur. Avignon a été une étape capitale car nous y avons réalisé les rêves que nous avions faits pour cette pièce : intégrer totalement l’architecture du lieu dans l’univers de Boulgakov. Je voulais que les deux se mêlent d’une façon absolument essentielle pour le public. Je ne voulais pas utiliser uniquement une partie du mur, je voulais que l’ensemble des murs soit en jeu. Nous avons donc cherché jusqu’au dernier moment comment créer techniquement cette sensation et qu’elle soit immédiate. Il ne s’agissait pas de provoquer un choc superficiel, mais en quelque sorte de pénétrer l’imaginaire des spectateurs, de le bouleverser intimement, dans la durée.
C. H. : Avant de parler de Complicite, je voulais évoquer la venue au Festival d’un autre Anglais, l’auteur John Berger. Cette édition lui a offert une place de premier plan, comme si vous étiez venu « accompagné », que vous aviez voulu initier dès le départ un dialogue au sein même de votre propre statut d’artiste associé.
S. McB. : Le désir et la pratique de la collaboration sont au cœur de Complicite. Inviter John Berger a permis d’ouvrir une autre voie, de faire entendre une autre voix anglaise. Et puis il était aussi fondamental de montrer que mon théâtre est à la fois dans l’épique et dans l’intime. À côté du MAÎTRE ET MARGUERITE, la plus grosse production que nous ayons réalisée avec Complicite, j’ai montré des formes plus confidentielles, comme EST-CE QUE TU DORS ? à la Chapelle des Pénitents blancs où j’ai travaillé avec des gens qui n’étaient pas comédiens – John Berger et sa fille –, et où je me suis caché en tant que metteur en scène. Ce spectacle a nourri une réflexion autour du texte non théâtral qui peut avoir une théâtralité propre. Cette réflexion s’est prolongée dans les nombreuses lectures de ses textes, celle de DE A À X par exemple, et tous les débats qui ont eu lieu autour de sa pensée, et avec lui.
Il faut redire que le langage premier du théâtre a été la poésie. La différence entre la poésie et la prose tient principalement à ce que la prose va vers une fin, comme dans une bataille où tout vise la fin, que ce soit la défaite ou la victoire. La poésie – ce ne sont pas mes mots mais ceux de John Berger – traverse les champs de bataille en écoutant les chants des victorieux ou des blessés. Elle engendre une forme de paix et, sans construire de monuments aux morts, nous assure que cette expérience humaine ne peut pas disparaître comme si cela n’avait jamais été.
Je pense que le théâtre peut offrir une forme similaire de permanence. Il donne abri à une expérience intérieure, une expérience pour laquelle nous n’avons pas de mots, qui doit être vécue pour être pleinement ressentie et à travers laquelle nous essayons de faire bouger quelque chose en nous – qui reste disponible à ce mouvement.
C. H. : Une exposition autour de vos créations avec votre compagnie Complicite a été organisée durant cette édition du Festival. Ce type d’événement, insolite pour un metteur en scène, prenait pourtant place avec vous comme une évidence. Quel était l’angle de vue de ce projet ? Comment « rassembler » en quelques salles l’histoire d’une compagnie qui fête en 2013 ses trente ans ?
S. McB. : Dès le départ, il était impensable d’envisager une rétrospective classique de ce que nous avions fait. Il s’agissait plutôt d’évoquer des sensations, de présenter des couches, des résidus.
Il y avait des photos de spectacles et de répétitions, mais aussi des objets qui sont la mémoire de nos créations. Comme la fameuse chaise qui marchait dans MNEMONIC. C’est un objet émouvant parce que c’est un prolongement, une trace de corps humains qui ne sont plus là. Les traces humaines sont très importantes pour moi. C’est pour ça que j’ai imaginé cette exposition comme une espèce de fouille archéologique – mon père était archéologue préhistorien.
Ce n’était pas une exposition d’accessoires. Ces objets nous rappellent que nous sommes plus que nos corps : la présence du passé et la possibilité du futur est toujours là, avec nous, dans le présent. Les morts entourent les vivants et les vivants sont au milieu des morts. Ces objets nous déportent vers un espace sans temps. Un égotisme moderne a coupé les liens fondamentaux qui existaient depuis toujours entre les morts et les vivants, avec des conséquences épouvantables pour les vivants qui croient que les morts sont des éliminés. L’acte théâtral, qui est un art du présent, rapporte le passé et le futur à un instant proche de ce temps sans temps. J’essaye dans mes spectacles de saisir ces moments rares, qui touchent l’imagination des morts, comme dans un moment d’extase ou dans un rituel. C’est pour cela aussi que je fais du théâtre.