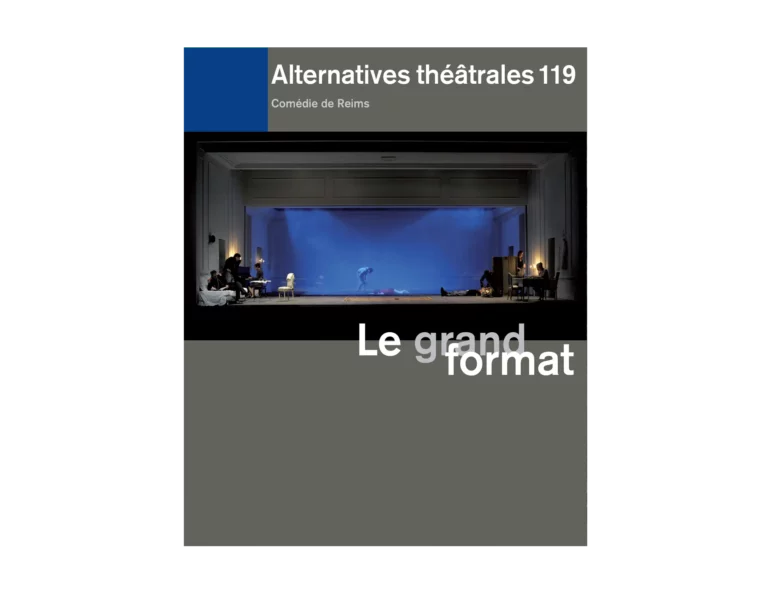Josette Féral : Tu as créé à la SAT (Société des Arts Technologiques) à Montréal, au printemps 2012 un spectacle, BABEL ORKESTRA, d’une heure trente environ, présenté sous un immense dôme appelé la satosphère et conçu à partir d’une vaste collection d’enregistrements des langues. Quand as-tu entrepris cet immense projet ?
Jean-Jacques Lemêtre : L’idée est née il y a vingt cinq ans, en 1987 pour être précis. Au Théâtre du Soleil, on finissait de jouer LES ATRIDES (1985, 1986 et 1987). Une fois le spectacle terminé, je me suis demandé ce que je pouvais faire après avoir utilisé toutes ces musiques sur scène : comment pousser encore plus loin l’art du choreute, un choreute qui ne chantait pas ? Or, l’une des comédiennes, Catherine Schaub, avait cette fameuse voix qui précède juste le chant. Sa voix était très aigüe et d’une tessiture très courte sans grande amplitude. Quand elle était accompagnée par la musique, on aurait dit de l’opéra. Elle n’essayait pas de faire sens ou de jouer le sens ; elle le chantait, le parlait : c’était comme le chanté-parlé (Sprechgesang) dont parle Wagner.
Le projet est donc le fruit de cette expérience. Auparavant, mon travail consistait à rechercher des instruments et à les accorder sur la voix parlée des acteurs. C’est un lien que j’ai toujours revendiqué, même si personne ne le comprenait, et je me suis donc mis à m’intéresser davantage à la langue, aux langues, et à les collectionner. D’un seul coup, je me suis trouvé dans la position d’un collecteur, d’un collectionneur de langues et de sons jamais utilisés. Il y a des langues que j’ai enregistrées pour la beauté de la vie de l’âme qu’elles portent, mais que je n’arriverai pas à utiliser.
Josette Féral : Peut-on dire que cela relève, au point de départ, d’un goût de la collection ?
Jean-Jacques Lemêtre : Non. Je travaille sur des spectacles tellement longs que lorsque j’ai utilisé cinq cents fois un instrument de musique, je ne peux plus l’utiliser dans le spectacle suivant, puisque le timbre, le son est tellement calé sur le personnage que le comédien reconnaît tout de suite le personnage lié à cet instrument. Donc, je ne peux plus l’utiliser ultérieurement pour signifier autre chose. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le piano joue et remplace tous les instruments de musique, et qu’il est capable de rendre toutes les émotions de tous les êtres humains du monde. Pour les langues, c’est la même chose : il y a une immense variété de sons…
Josette Féral : Comment s’opèrent les choix ?
Jean-Jacques Lemêtre : Cela tient au hasard. Je ne décide pas à l’avance ce que je vais capter. Par exemple, quand je suis au milieu de l’Amazonie, je capte autant les chiens, les bruits des oiseaux, les bruits du vent, du feuillage que les mots ou les phrases. Je ne peux ni ne veux isoler les mots. La nuit, c’est même pire : j’entends tous les bruits des animaux et je pourrais les utiliser. Mais, pour cela, il faudrait que j’arrive à les isoler. Ce n’est pas ce que je cherche. Je veux juste la beauté de la langue et la musique de l’âme. C’est pour cela que mon projet a pris huit ans. Ce qui m’intéresse c’est la musicalité du langage. Je me retrouve donc à avoir des extraits de langues que je suis seul à avoir. En essayant de prendre l’éventail de langues le plus large possible, j’enregistre des gens qui parlent à coup de signes, ou qui se souviennent de mots ou de langues disparues comme le huron ou le maya – des langues qui leur viennent de leurs grands-parents et dont ils essaient de se souvenir.
J’effectue une sélection, disons, naturelle, mais dans le bon sens du terme. Si on me dit telle personne parle telle langue particulière, je vais l’enregistrer. Je finis par avoir de multiples doublons mais chaque personne a son timbre particulier, sa musique particulière, qui s’ajoute à la vraie musique de la langue.
Quand on plonge dans les langues, il y a le petit espoir d’en trouver l’origine, la langue adamique, peut- être. Toutes les questions que se posent les linguistes émergent d’un coup. Bien sûr, il s’agit de musique. Mais il y a un moment où la quête devient tout naturellement plus large. On me demande alors si je n’ai pas l’intention de retrouver la première langue du monde, de répondre à la question des origines.
Josette Féral : La durée de ces enregistrements varie-t-elle ?
Jean-Jacques Lemêtre : Oui. Certains durent quelques secondes. Par exemple, grâce à Yves Sioui, qui est Huron-Wendat, j’ai eu une phrase d’Abénaki et d’Atikamekw, de la part d’un Indien avec qui il m’a mis en contact. Celui-ci a voulu me faire un cadeau car sa langue, c’est la seule chose qu’on ne lui a pas volée. Il ne doit pas rester mille personnes dans le monde qui parlent cette langue. Une phrase comme celle-là me suffit comme paiement de tout mon travail.
Josette Féral : Comment abordes-tu les personnes dont tu veux enregistrer la langue ?
Jean-Jacques Lemêtre : De façons très différentes. Je les fais réagir avant tout. Je ne leur dis pas : « racontez-moi une histoire parce que j’ai besoin de votre langue » car j’aurai une réponse plate interrompue de temps en temps par des « euh », « ah », « oui ». Alors qu’en posant une question différente, qui interpelle les gens, je vais avoir l’émotivité du langage musical de la langue parlée et c’est ce que je cherche,
Les questions que je pose dépendent du contexte. Par exemple, si je suis au fin fond du Timor et que je dis à la personne devant moi : « J’arrive du village de l’autre côté de la montagne. On m’a dit que vous étiez un chasseur vraiment pas terrible !» Je vais avoir une réaction pleine de notes. Évidemment, j’ai toujours, dans ces cas-là, plusieurs traducteurs. J’entends les notes de musique. Ce sont ces notes qui m’intéressent et que je mettrai dans ma composition.
Josette Féral : Est-ce qu’il t’arrive de demander à quelqu’un de reprendre l’enregistrement ? On n’est pas tous forcément naturel au premier enregistrement.
Jean-Jacques Lemêtre : Non, puisque je ne travaille, théâtralement, que sur l’émotion, les émotions, les sentiments. C’est pour cela que chaque tableau dans l’œuvre finale est un sentiment.
Josette Féral : Comment provoques-tu cette émotion ?
Jean-Jacques Lemêtre : Par les questions que je pose. Quand on parle avec quelqu’un, le premier mot qui sort est toujours en lien avec ce que tu viens de demander.
Josette Féral : Je ne pense pas que toutes les émotions soient immédiates. Certaines peuvent naître au cours du dialogue. Elle ne sont pas données d’emblée.
Jean-Jacques Lemêtre : Le progressif ou le dégressif ne m’intéressent pas. Je cherche la sincérité.
Josette Féral : Cela veut dire qu’il y a des émotions que tu n’as pas dans ta banque. La colère, par exemple, ne naît pas forcément dès le premier contact.
Jean-Jacques Lemêtre : La haine non plus, je ne l’ai pas.
Josette Féral : Alors, quelles sont les émotions qui figurent dans ta banque ?
Jean-Jacques Lemêtre.: Pour la haine, j’utilise quelque chose d’assez étrange, c’est Hitler ou les dictateurs.
Josette Féral : Donc, tu n’as pas que des enregistrements de gens vivants.
Jean-Jacques Lemêtre.: Non. Il y a aussi plein de gens morts. J’ai également eu la chance d’enregistrer un des derniers shamanes de la Terre de feu.
Josette Féral : Une fois les enregistrements effectués, comment travailles-tu la composition ?
Jean-Jacques Lemêtre.: J’agis comme un créateur/ compositeur. Si j’ai besoin de mi, sol, la, je vais chercher celui qui m’a fait mi, sol, la lors de l’enregistrement, par exemple quelqu’un qui parle en Sa’dan-toraja ; je prends ces trois notes-là et je les colle dans ma composition. Ce ne sont pas des syllabes, ou des voyelles, ou quoi que ce soit d’autre. Ce sont avant tout des notes de musique.
Josette Féral : L’ensemble est très structuré. Il a une forme.
Jean-Jacques Lemêtre.: Oui. Il y a un morceau. On peut dire que c’est une chanson : couplet-refrain ou une fugue à la Bach. J’ai utilisé les règles musicales de composition.
Josette Féral : Cette œuvre est-elle dissonante ?
Jean-Jacques Lemêtre.: Non, consonante.
Josette Féral : Harmonique.
Jean-Jacques Lemêtre.: Oui.
Josette Féral : Rythmique.
Jean-Jacques Lemêtre.: Et mélodique.
Josette Féral : Dirais-tu qu’elle est « classique » ?
Jean-Jacques Lemêtre.: C’est du classique. C’est tonal et modal.
Josette Féral : Mais ce qui n’est pas classique, c’est le point de départ. Ce ne sont pas des notes.
Jean-Jacques Lemêtre.: Si, ce sont des notes mais pas au sens classique du terme ! Qui a décrété que le chant et le parlé n’étaient pas la même chose ? Qui a décrété que quand on parle, on est dans le sens et quand on chante, on est dans la musique ? Il y a des choses auxquelles il faut renoncer parce que c’est faux.