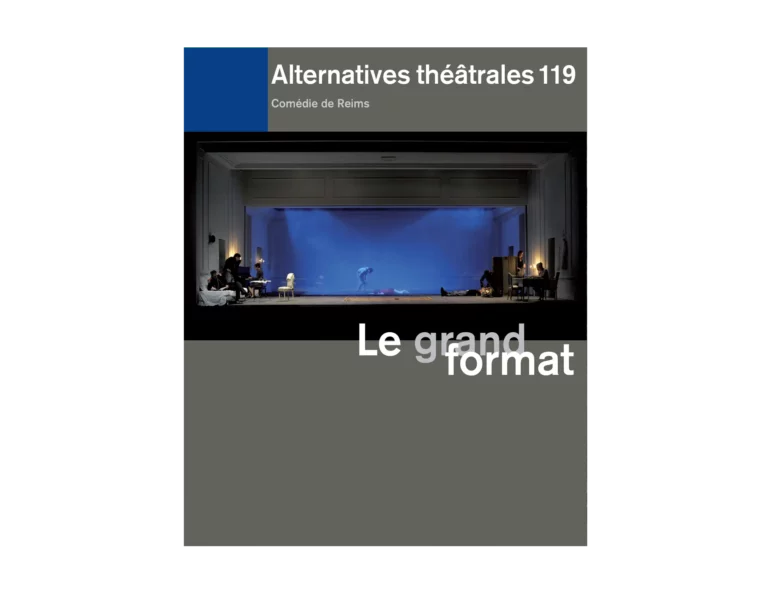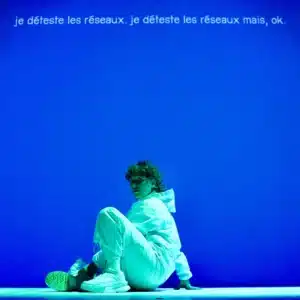L’œuvre CREMASTER CYCLE rejoue la genèse de l’homme, en se situant dans un microcosme organique. L’univers suggéré par Matthew Barney est localisé dans un muscle central de l’appareil reproducteur masculin (plus spécifiquement dans les testicules) auquel le titre de l’œuvre réfère directement. Lieu d’indifférenciation des genres, lieu d’indifférenciation de l’homme et de la matière, CREMASTER questionne les sources de la vie et les frontières entre les sexes en faisant émerger de ce microcosme un macrocosme : « body becomes landscape, and landscape becomes a body1 ». L’œuvre se propose comme « self-enclosed aesthetic system2 » nous indique Nancy Spector : un monde bref. Bien plus qu’un simple film de longue durée, c’est bien par l’interrelation de médiums, de matériaux et un travail de mise en scène présentant chacun des cinq films qui se concrétise par l’aména- gement du musée par des sculptures, des photographies, des dessins et des installations que prend forme CREMASTER CYCLE. Œuvre inséparable de son contexte de présentation, tout comme de son contexte de production qui se caractérise aussi par l’implication de l’artiste Matthew Barney se livrant à des performances physiques s’inscrivant dans le sillon du body art. À ce titre, le projet est qualifié de « body-centric projects ». Gigantesque mise à l’épreuve du corps par le biais de la fiction, CREMASTER CYCLE utilise les corps dans leur réalité et leurs mutations possibles pour rejouer une histoire qui ne cesse de renouveler les ambiguïtés de la vie organique et de l’artificiel. L’ensemble du contexte de production et d’exposition donne à voir la mise en scène d’un univers complexe se déployant dans l’espace et le temps, une installation sans fin.
Les modes de production de CREMASTER CYCLE tiennent de la surenchère, de la démesure : le travail menant à l’œuvre complète est étalé sur plus de huit ans et participe au gigantisme de l’œuvre.Le tournage des films s’apparente aux mégaproductions cinématographiques américaines : équipe de production, usage de technologies et d’effets spéciaux, déplacement sur des sites spécifiques, prises de vues complexes et budgets exorbitants encourus. D’ailleurs, l’œuvre est jalonnée de références à l’âge d’or du cinéma américain. La mégaproduction cinématographique devient ici une métaphore pour donner l’ampleur et l’exubérance au monde de Barney. Les méthodes de production sont à la mesure du projet démiurgique de Barney qui se rapporte à la production de la vie et à la maîtrise de l’énergie chaotique du désir. Pour rendre compte de cette énergie, il emprunte à un imaginaire qui se rapporte à la production industrielle, ainsi, il illustre la dépense à travers une certaine mise en scène du capitalisme et de ses rituels en mettant l’emphase sur leur aspect spectaculaire. On pense notamment aux manifestations sportives (football, voiture de course) ou au show rock, royaumes ritualisés : de la compétition, de l’exhibitionnisme et de l’idolâtrie. L’œuvre fait aussi allusion plus largement à la période industrielle : ballons dirigeables Goodyear, automobiles, construction du Chrysler Bulding. Les logos et les marques loin d’être évincés y prennent place avec clarté, tout autant que le CREMASTER CYCLE développe son propre design et ses logos pour chacun des films, travaillant à intégrer cette culture de masse à son propre travail. Toutefois, l’univers de Barney est inquiétant et révèle les zones troubles de l’énergie libidinale, mêlant tous les genres du gore au music hall, de l’opéra au heavy metal. Ainsi, une dimension brute, violente s’amalgame à une imagerie fantaisiste, mais trouble. Barney mélange adroitement des références à l’imaginaire et à l’histoire populaire américaine avec des récits mythiques réinventés dans lesquels des créatures inquiétantes et grotesques, mi-homme, mi-bête, expriment les tensions du désir à la source de la vie. Il met en scène une iconographie qui traduit les tensions à l’origine de la vie, cela, en évoquant l’imaginaire et la culture nord-américaine : du Bronco Stadium au Chrysler Bulding, du rodéo à la voiture de course, d’Ursula Andress à Gary Gilmore. Matthew Barney dresse une généalogie qui emprunte au réel et à l’imaginaire, un portrait possible et impossible de l’Amérique, horrible et fabuleux. Les modes de production eux-mêmes tiennent de la dépense et participent à cette épopée métaphorique, mais aussi littérale dans les processus qu’elle met en place.