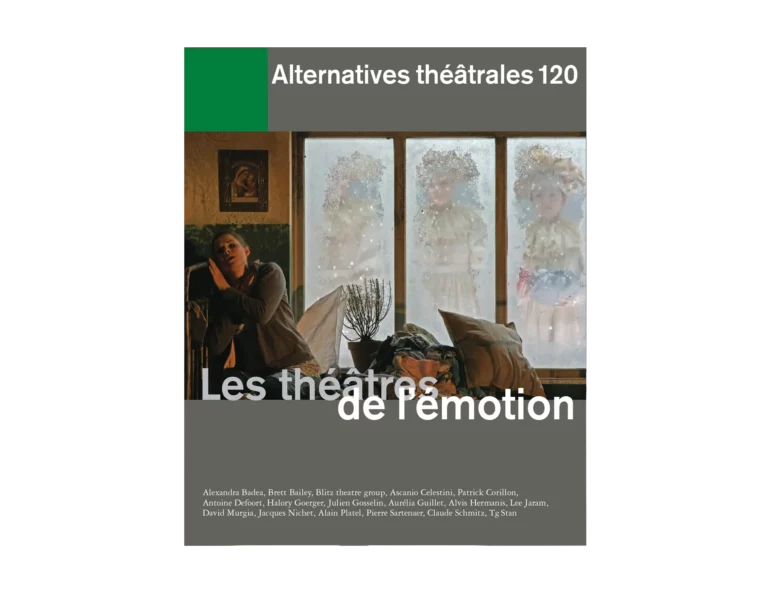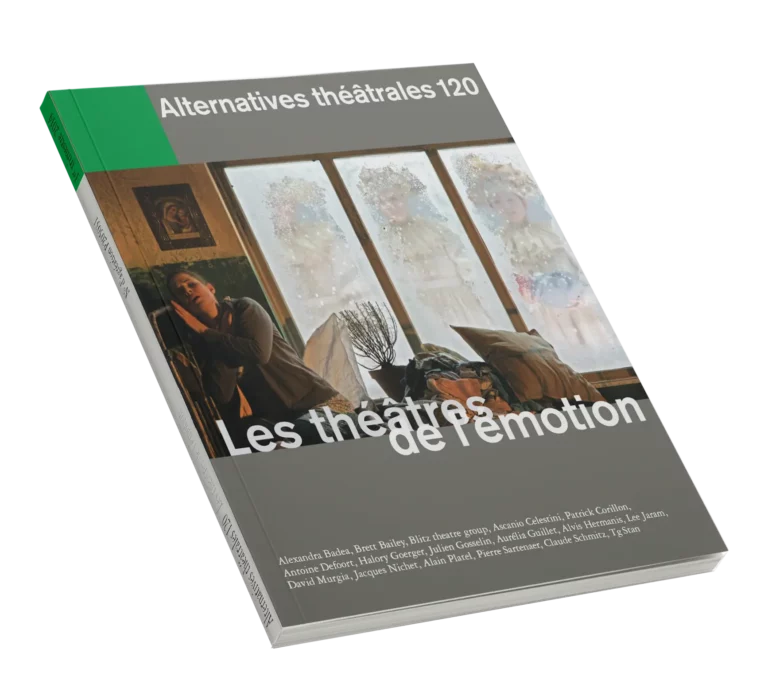Ascanio Celestini ne s’épanche pas sur son travail. Il répond aux questions qu’on lui pose mais préfère s’attarder sur ce qui le préoccupe vraiment : la situation dramatique des prisons surpeuplées, par exemple. Les détenus qui ont moins d’espace que celui prévu par les normatives européennes pour les cochons dans les élevages ; en Italie, quarante pourcent des détenus sont en attente de procès (donc non condamnés), et un tiers sont toxicodépendants.
Rencontrer Ascanio ou assister à un de ses spectacles c’est prendre de plein fouet des problématiques qui nous concernent mais qu’on a tendance à écarter — par lâcheté, paresse…
Il nous plonge tête la première dans des situations dont nous ne sommes pas fiers. Il nous démontre par a+b qu’il n’y a pas de quoi rire. Tout en nous faisant rire aux éclats.
Lorsque je le rencontre à Rome ce jour pluvieux de février dernier il est en face de moi, comme au théâtre. Assis, concentré, souriant. Il fait peu de gestes. Le décor est sobre. C’est un théâtre de mots, comme l’aimait Pasolini. Un théâtre qui nous parle de nous, de nos paradoxes, de nos faiblesses. Les histoires qu’il nous raconte nous renvoient à notre imaginaire, à notre mémoire, individuelle et collective.
Un théâtre sur écoute
En étudiant avec minutie les dossiers des procès tenus contre Menoccio, le meunier d’un petit village du Frioul, conduit au bûcher par un tribunal de l’Inquisition en raison de ses conceptions métaphysiques jugées hérétiques, le grand historien italien Carlo Ginzburg ouvre la voie à la « microhistoire ». Las des sources historiques traditionnelles qui n’évoquaient, d’après lui, que la « culture des vainqueurs », il a développé une méthode d’analyse des individus et de leurs comportements pour faire émerger les pratiques sociales et culturelles.
Ascanio Celestini, anthropologue de formation, s’est engouffré dans cette voie et a développé un théâtre de narration très particulier. Il part d’une minutieuse récolte de témoignages de ces « vaincus » de l’histoire, des opprimés, des marginaux, et les raconte seul sur scène, en un faisceau de récits qui s’emboîtent et laissent au spectateur le soin d’ouvrir son imaginaire et de produire ses propres images. Le spectateur ainsi sollicité réactive les images données par Ascanio de façon personnelle et autonome.
Celestini est quelque part lui-même ce Menoccio des temps modernes, et, s’il n’est pas envoyé au bûcher, il monte de son plein gré sur les planches sans craindre de se faire brûler. Se cachant derrière les discours de personnages imaginaires, il remet subtilement en question des schémas auxquels on est habitués depuis toujours.
« Au départ je voulais être journaliste », nous dit-il, « puis je me suis rendu compte que le théâtre m’amusait beaucoup plus. Le théâtre, c’est l’autre face du travail anthropologique. D’un côté tu recueilles et de l’autre tu donnes vie sur scène à ces mots que tu as entendus. » Sur scène, il confronte et superpose les histoires qu’il a entendues et produit ainsi une sorte de contre histoire relue par le bas.
Très connu en Italie, notamment par ses interventions télévisuelles (dans des émissions comme Parla con me, devenu the show must go off), ses chroniques (dans l’hebdomadaire Il Venerdi de La Repubblica par exemple), ses films, romans, pièces de théâtre, chansons, il est devenu aujourd’hui le chantre des opprimés, qu’ils soient prisonniers, « fous », employés de call center, ouvriers, ces exclus qui n’ont jamais la possibilité de s’exprimer et qui refusent de reconnaître le langage du pouvoir. En faisant exister ces paroles minoritaires, Celestini mène un véritable travail de résistance.
En Belgique, c’est lors du deuxième Festival de Liège que Jean-Louis Colinet invite Celestini avec Fabbrica. À travers les lettres qu’un ouvrier engagé par erreur écrit à sa mère, Fabbrica raconte l’histoire de Fausto, chef manoeuvre dans une usine en Italie à la fin de la deuxième guerre mondiale. Comme à son habitude, pour construire son récit l’auteur est parti d’une abondante récolte de témoignages des ouvriers de cette époque.
En 2005, Pietro Pizzuti monte au Rideau de Bruxelles la version traduite par Kathleen Dulac avec Angelo Bison comme interprète et, en 2009, ce même théâtre consacrera tout un « Automne » à l’auteur italien. La même année, Charles Tordjman choisira de monter ce texte comme dernier spectacle en tant que directeur de la Manufacture de Nancy. Il invitera sur scène la chanteuse et ethnomusicologue Giovanna Marini, personnalité bien connue en Italie, amie de Pasolini et spécialiste des chansons populaires.
Plus récemment, Discours à la Nation, écrit par Celestini et interprété par David Murgia, a remporté à Bruxelles le Prix de la critique et à Avignon le Prix du Public Festival Off.
Une radicalité poétique
Le théâtre d’Ascanio Celestini n’est ni compassionnel ni nostalgique. C’est un théâtre subjectif qui exprime un point de vue, le sien. Son discours politique n’est pas frontal, il investit émotionnellement le spectateur qui prend part à ses confidences et en ressort renforcé, avec l’impression d’avoir vécu une communion profonde. Il récrée le lien symbolique transmis par cet art ancestral du conte qui existait auparavant dans chaque communauté, dans chaque famille, et qui est aujourd’hui détruit, pour beaucoup, par la culture de masse.

Photo M.Iacovelli‑F.Zayed / Spot the Difference.
Son singulier regard sur le monde, loin des discours habituels et très ancré dans le présent donne à son théâtre un caractère politique : « Mon théâtre est politique parce qu’il montre qu’il y a une autre façon de regarder les choses. Qu’il y a un point de vue qui vient du bas. Une quotidienneté de l’histoire »1.
Il évite le didactisme avec élégance et, s’il aborde des sujets graves, c’est toujours avec légèreté et beaucoup d’humour. Par son auto-ironie cinglante, il est le digne héritier de L’Arioste du Roland furieux mais ses poèmes épiques inspirés des « petites gens », des déclassés de l’humanité, bien qu’ils se réfèrent à un passé absolu, exigent un jugement présent. Car ils nous parlent d’aujourd’hui, à travers la mémoire : « La mémoire est littérature. Elle est la littérature qui raconte l’histoire des êtres humains. Leurs vies. »2
Quand on se voit près de Campo dei Fiori, on commence donc à parler des prisons. Il est inquiet du sort imputé aux détenus de la prison de Marina del Tronto, une « super prison » réservée aux terroristes des Brigades rouges. Il repart ensuite sur la situation des hôpitaux psychiatriques, thème de prédilection de son texte La Pecora nera (La Brebis galeuse, traduit par Olivier Favier et publié aux éditions du sonneur).
Ensuite, il me raconte une anecdote significative : il est avec son fils (environ huit ans) et un ami de son fils dans la voiture. Ils voient par la fenêtre une maison. Ascanio dit : « Vous avez vu cette maison, comme elle est belle ! J’aimerais bien habiter une maison comme ça ». Le copain de son fils, adepte d’arts martiaux, réagit : « Je vais rentrer dedans et chasser les habitants avec des supers prises de Kung fu ». Le fils d’Ascanio : « moi je vais rentrer dedans et jouer tellement au piano qu’ils vont finir par partir ». Et l’autre répond : « oui mais tu dois jouer fort et faux ! ».