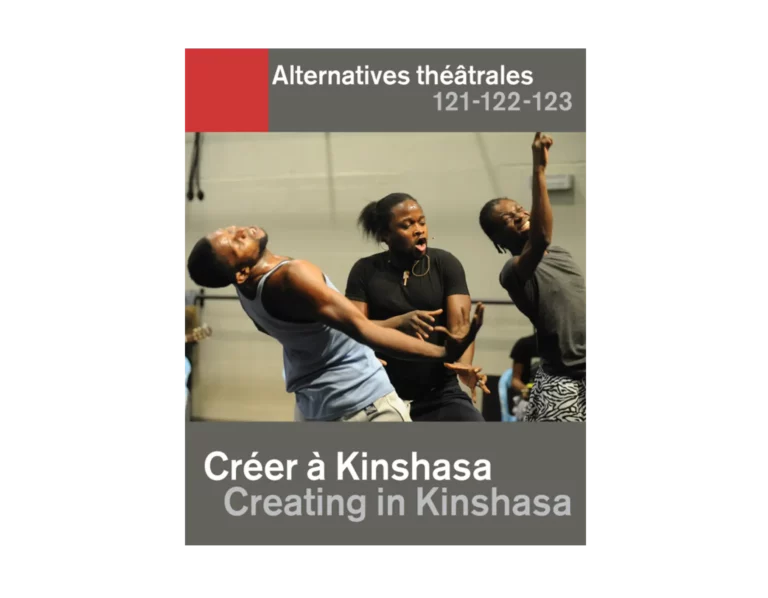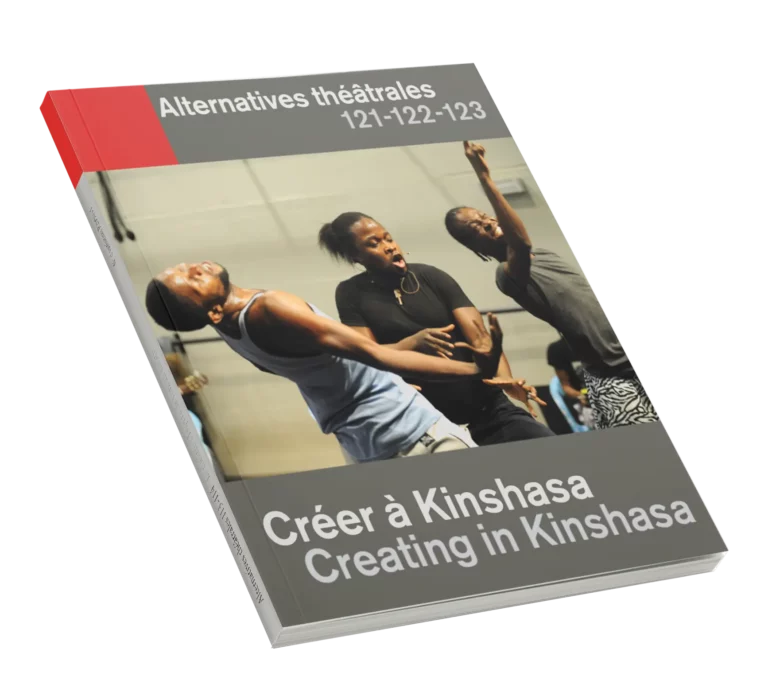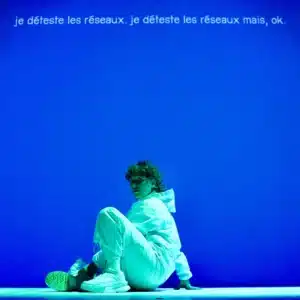Bernard Debroux : Comment êtes-vous venu au monde artistique et quel est le sens et la démarche de votre travail de création ?
Yves Sambu : J’évolue dans le collectif SADI (Solidarité des artistes pour le développement intégral), qui est un collectif de jeunes artistes à la recherche de nouvelles formes et expérimentations d’interventions artistiques. Chaque création artistique se construit en rapport avec une situation, ou une population donnée. Nous avons nommé notre démarche inter-influence parce que nous estimons que l’œuvre d’art, dans notre contexte social, a un rôle de vecteur de communication. Grâce à l’art, cette communication peut se faire en dehors de tout statut social, avec n’importe qui, même un ministre.
On dit souvent que les artistes dit engagés sont dans la critique et la condamnation du système politique et social (le gouvernement, la société, etc.) et que s’ils étaient eux-mêmes au pouvoir ils feraient pire encore. Les donneurs de leçons ne sont pas des exemples. Au lieu de donner des leçons, nous, nous voulons convaincre à travers des dialogues. L’inter-influence est basée sur le dialogue. C’est la base de notre démarche. On doit trouver des outils communs. Un acte posé par l’artiste pour susciter des interrogations.
Nous voulons dialoguer avec la population pour qui les concepts d’art, d’exposition, sont très étrangers alors que c’est notre champ d’intervention. Quelqu’un de Kinshasa qui fait des tableaux sur la guerre qui se déroule à l’Est alors qu’il ne l’a jamais vécue est souvent jugé très sévèrement. Alors quand il va présenter son travail en Europe…
Donc, pour nous, le premier interlocuteur, c’est la population qui est avec nous, en face de nous. Notre travail consiste à aller vers cette population, en écoutant ce qu’elle dit, en essayant de vivre sa situation pour en parler et la décrire du mieux possible. Ça instaure une sincérité chez l’artiste que la population ressent tout de suite. C’est un débat. Et la population y contribue. Du coup l’art lui parle directement. SADI est un groupe de huit personnes. Trois d’entre elles ne sont plus avec nous en ce moment : deux sont en France et l’autre vient de partir en Chine pour y faire des études de céramique. Nous sommes donc cinq ici, en Afrique.
Chacun a son médium, sa discipline. Ce qui est inté- ressant, c’est de travailler ensemble à travers une démarche commune. Moi, j’interviens par la photo et la vidéo. Didier Besongo pratique le théâtre : aujourd’hui il émerge via les stand-up et présente ses spectacles à Brazzaville. Francis Tenda travaille la transformation d’objets quotidiens. Mais en même temps, on n’est pas uniquement l’artiste d’une discipline. Nous nous considérons comme des artistes « hors forme », parce qu’à partir d’une idée, nous réfléchissons au medium qui pourrait le mieux en rendre compte, que ce soit un tableau, une photo ou une vidéo… Cette nature de touche-à-tout, on l’a appelée « hors-format ». Nous nous focalisons principalement sur la vie de la société. Pour l’un de nos projets, nous sommes partis en résidence dans une cité qui subissait beaucoup d’érosion, dont les bâtiments et les maisons s’étaient effondrés, et dont on a commencé à repeindre les murs. L’idée était pour nous de peindre l’angoisse de cette population, celle de la cité universitaire de Kindele. On voulait au départ immortaliser en images et en vidéos ce qui restait de cette cité, mais finalement on a repeint les maisons avec ce qu’on retrouvait du contexte historique dans ces habitations : des papiers, des notes, abandonnés. On a tenté de restituer l’Histoire sur les murs. La population était intriguée et des discussions se sont engagées. Les enfants sont venus écrire eux-mêmes sur les murs. Les gens du quartier se demandaient si notre démarche était spontanée ou si nous étions poussés par d’autres, s’il y avait de l’argent d’organismes internationaux, par exemple. Ils ne savaient pas
comment nous situer. C’est quand on leur a expliqué qu’ils ont adhéré à notre démarche et sont venus travailler avec nous.
On a ensuite créé un comité qui a pris en charge les problèmes locaux. Un dialogue s’est instauré avec la population, les autorités coutumières, le gouverneur… Auparavant, les journalistes passaient avec leur caméra et envoyaient des messages désespérés à la télé. Il n’y avait plus d’espoir dans ces espaces-là. L’érosion était partout, comme sur la route nationale !
Nous sommes allés voir les autorités, et, à notre grande surprise, ils ont admis qu’ils avaient une part de responsabilité dans la situation actuelle, parce qu’ils avaient vendu des terres sans se préoccuper du cadastre, et que ça avait créé des problèmes. Il y a eu une prise de conscience dans le public avec lequel nous discutions, et chacun semblait prêt à prendre ses responsabilités.
Nous avons approché le gouverneur, je lui ai expliqué notre idée et il l’a comprise. Je lui ai dit qu’il n’était pas responsable des catastrophes naturelles, que tout ça avait commencé avant qu’il soit gouverneur. La population aussi avait conscience de sa part de responsabilité. Mais au final, la grande route a été reconstruite en partie. Là aussi, l’idée de l’interaction a fonctionné.
C’est ce genre d’expérimentation que nous menons : notre intervention est éphémère, mais elle laisse aussi des traces.
B. D. : Comment en êtes-vous arrivés à avoir votre propre espace, ici, au Mont des Arts ?
Y. S. : Nous louons cet espace et notre contrat de bail s’achève à la fin de cette année. Grâce à la bourse attribuée par la Coopération Belge du développement il y a cinq ans, nous avons pu construire ce petit hangar multi fonctionnel de 12 m² et un bureau, qui nous sert non seulement d’atelier pour nos expérimentations et créations contemporaines, mais aussi de lieu
de rencontre d’hommes et de femmes intéressés par la culture.