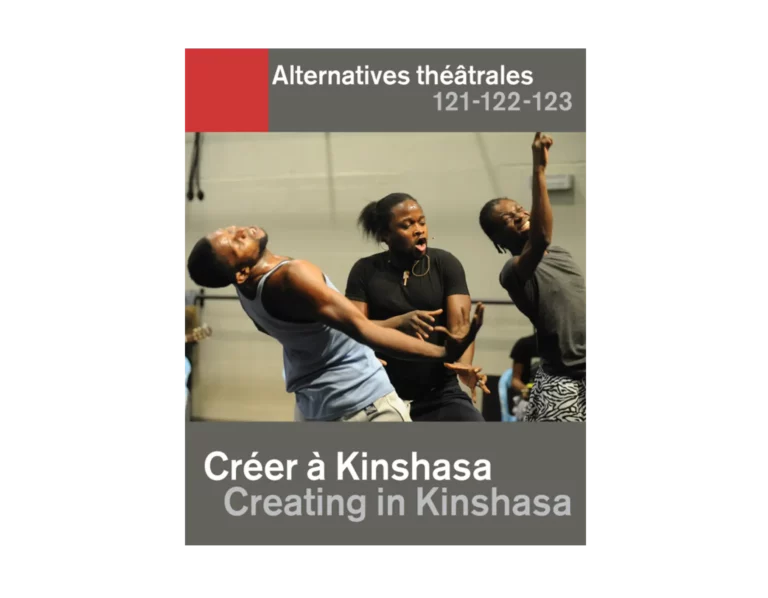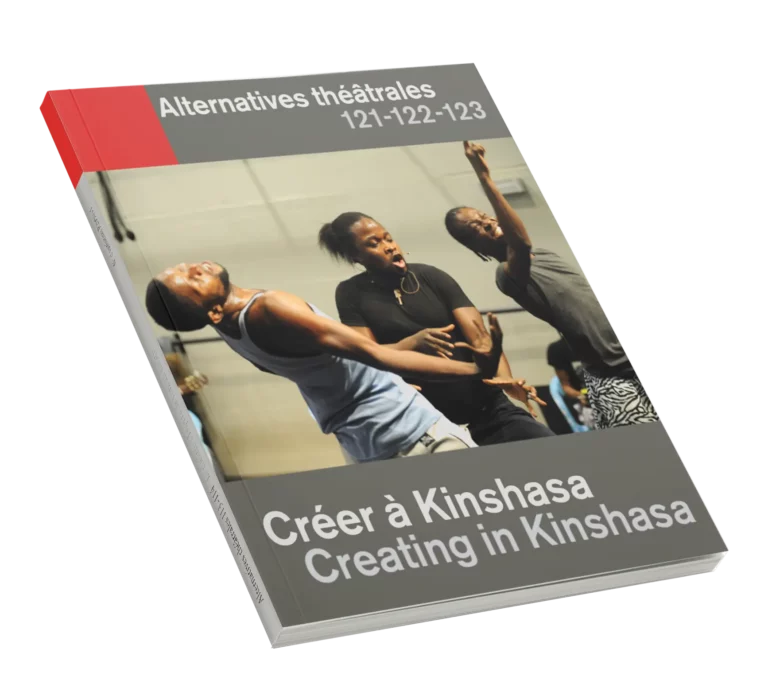Laurence Van Goethem : Pouvez-nous nous parler de vos origines, de votre formation et d’où vous est venue cette envie d’écrire ?
Marie-Louise Bibish Mumbu : Je suis née à Bukavu dans l’Est du Zaïre en 1975, dernière d’une famille de six enfants. Mon père était fonctionnaire de l’État, dans ce qu’on appelait la territoriale. Il était amené à se déplacer souvent, c’est pourquoi j’aime dire que notre famille est un peu à l’image de la nation congolaise. Sur les six enfants de mon père, seuls les deux aînés ont vu le jour à Kinshasa. Ma sœur (3e) est née à Mbandaka en Équateur, mon frère qui la suit est né à Kisangani dans la Province Orientale et l’avant-dernier est né à Katana dans le Sud Kivu, à l’Est du pays. Je me souviens d’avoir fêté mes cinq ans dans le Bandundu, et à six ans je suis allée à Kinshasa définitivement. Je n’ai plus jamais remis les pieds à Bukavu, malheureusement.
Le goût d’écrire m’est venu par la lecture. Ma mère était institutrice, mais elle a arrêté de travailler à la naissance de son deuxième enfant. Elle nous aidait pour nos devoirs, et nous lisait des histoires. Très chrétienne, elle nous offrait des bandes dessinées des éditions St Paul de Kinshasa, la collection biblique des livres historiques et prophétiques : David, Esther, Moïse, Samson… Il y avait aussi des BD de contes congolais comme Un Croco à Luwozi, Sha Mazulu, Ndata Sangu. Belle époque ! C’était les seules bandes dessinées congolaises. Les histoires de princesses blondes aux yeux bleus à cheval ne retenaient pas autant mon attention… Comme mon père était souvent retenu en « réunion » comme on disait, je lui laissais des petits mots avec mon journal de classe qu’il devait signer. Je lui racontais ma journée : j’avais toujours besoin de raconter et de prendre des notes. C’est quelque chose qui m’est resté.
L. V. G. : Prenez-vous encore des notes au quotidien ?
M.-L. B. : Oui, au fil du temps je me suis rendu compte que c’est ce que j’aime le plus. J’écris beaucoup, surtout depuis que je me suis éloignée de ma famille, en 2010. Mon père est décédé quand j’avais dix-huit ans, en 1994. La mort de mon père a été un choc, un repère qui s’est effondré. À sa mort je ne savais pas du tout ce que j’allais devenir. Pendant deux ans, je n’ai plus rien foutu. Je n’avais envie de rien. Un désert que j’ai traversé en grandissant tout à coup très vite. Je crois que mon désir d’écrire est parti de là.
L. V. G. : Vous étiez à Kinshasa à ce moment-là ?
M.-L. B. : Oui, avec ma mère dans la maison familiale. Mes deux frères aînés étaient déjà à l’étranger (l’un en Belgique et l’autre en Allemagne). Aujourd’hui, j’ai deux frères qui sont à Kinshasa avec notre maman, le reste de la famille est éparpillé de par le monde, et moi je réside au Canada. Ce goût du voyage, le fait qu’on n’ait pas peur de l’ailleurs, nous vient sans doute de notre enfance voyageuse.
L. V. G. : Quel a été le déclic qui vous a aidé à sortir de cet état de choc suite à la mort de votre père ?
M.-L. B. : Le déclic s’est opéré quand j’ai regardé la cassette des obsèques de mon père.
J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J’ai revécu toutes les douleurs liées à sa mort et ça m’a purifiée. J’ai compris que je devais vivre et que je devais réussir, pour mon père. Il avait fait en sorte de payer des études à tous ses enfants, aux filles comme aux garçons. Je me suis relevée pour qu’il soit fier de moi. J’ai décidé d’étudier le journalisme à l’Institut Supérieur des Techniques de l’Information à Kinshasa — ISTI. Dès le départ, c’est la presse écrite et le secteur culturel qui m’attiraient. Assez vite, dans le cadre de mes études, il a fallu interviewer des gens. Je suis allée à l’écurie Maloba et j’y ai rencontré Jean Shaka. L’écurie était à la recherche d’un attaché de presse. J’étais encore aux études, on m’a engagé comme stagiaire pendant le Festival International de l’Acteur. C’est à l’écurie Maloba que j’ai lu pour la première fois le magazine Africultures. Il y avait une annonce dans un numéro, ils recherchaient des correspondants dans les pays d’Afrique. Je leur ai écrit, tout était manuscrit à l’époque, ça a mis du temps. Pendant ce temps ma meilleure amie m’annonçait qu’elle partait vivre aux États-Unis. C’était comme si j’étais orpheline une deuxième fois. Puis un jour où je ne m’y attendais plus, j’ai reçu une réponse d’Olivier Barlet d’Africultures qui me commandait un article. On venait de vivre sans eau ni électricité pendant près d’un mois et une énième guerre civile faisait rage à Brazzaville. Mon article parlait de la participation des gens de Brazzaville au Festival. C’est comme cela que j’ai obtenu mon tout premier salaire.
L. V. G. : Ce que vous racontez dans Samantha à Kinshasa, c’est un peu votre histoire ?