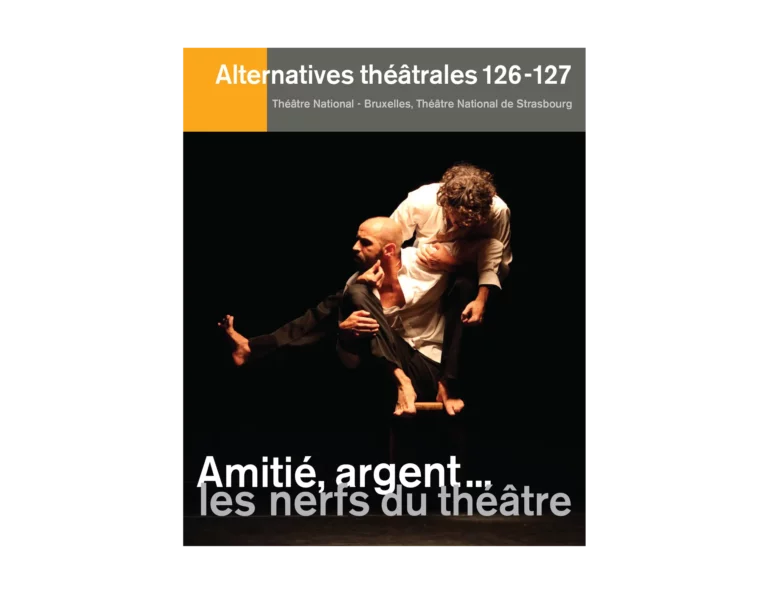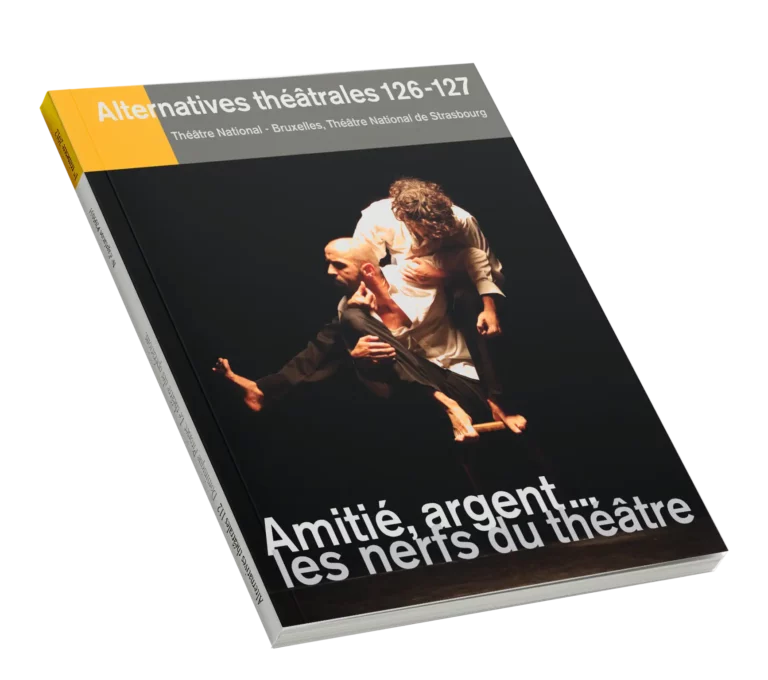Les amis, c’est une seconde existence
Baltasar Gracian
POUR LES GRECS, l’amitié était une « vertu » acquise grâce au commerce intellectuel et affectif entre des « gens de bien » car l’évaluation des partenaires sert de socle aussi bien que de garantie pour la pertinence de ce lien interpersonnel. Les discours sur le statut de l’ami se sont formulés au point de se relayer à travers le temps, d’Aristote et Cicéron à Montaigne, Nietzsche et tant d’autres comme Blanchot ou Derrida. L’ami, la plupart de ces exégètes le considèrent comme étant « un autre moi-même », un « tiers », qui accompagne le « double » dont tout être est constitué, ou encore un « alter ego ». Il s’agit ici non pas de relancer le débat sur l’amitié comme valeur fondée sur des liens interpersonnels mais d’emprunter certains propos afin d’éclaircir son rôle dans l’exercice du travail théâtral où elle se trouve associée à une activité de groupe, où l’affect amical et la création s’entrelacent souvent. Le théâtre ne s’accomplit pas dans la solitude d’un bureau ou d’un atelier d’artiste, mais dans une salle de répétitions où, sous la conduite d’un leader, plusieurs êtres se trouvent réunis. C’est la raison première qui explique la portée de l’amitié pour cet art où le pluriel se pose comme condition de sa pratique. Ici on cherche, le plus souvent, à instaurer une amitié communautaire sur la base du plaisir d’être ensemble. on fait du théâtre sur fond de confiance accordée à un engagement collectif qui pallie les peurs solitaires de l’artiste confronté seulement à lui-même. De là proviennent les efforts pour constituer des équipes, des troupes, des collectifs, qui érigent en condition première une reconnaissance valorisante du partenaire appelée à se convertir en amitié grâce à la longévité de la collaboration. Amitié qui se gagne dans la durée et qui, on le découvre, se détériore par la durée !
Nous sacrifions cette fois-ci la réflexion sur les communautés (à ce sujet le volume dirigé par Marie- Christine Autant-Mathieu reste essentiel1) pour procéder à un rétrécissement du champ afin de nous consacrer à des amitiés duelles, amitiés qui se rattachent au modèle du lien exemplaire qui s’est noué entre Montaigne et La Boëtie. Lien fondé sur la reconnaissance de soi dans l’autre avec lequel se cristallise une relation unique, nécessaire et rassurante. Les limites s’effacent, les identités se confondent et, ainsi, chacun des partenaires éprouve le sentiment réconfortant d’être enfanté aussi bien que protégé par l’autre. Voilà un entre-deux qui définit ces paires d’amis, paires étrangères aussi bien au cloisonnement des solitudes qu’à l’indistinction des communautés. Un théâtre fait non pas seul, ni à plusieurs, mais un théâtre fait à deux. Deux amis. « Qui a trop d’amis, n’a pas d’ami » dit Aristote – c’est une des traductions possibles de son fameux aphorisme ! – et ce propos se voit confirmé grâce aux exemples mobilisés ici. La cohortia du collectif théâtral se trouve suppléée, dans un premier temps, par la philia des singularités. « Je ne me fonds pas dans un collectif, mais je ne suis pas seul non plus » – posture défendue par les deux amis. « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Des amis je n’en ai pas plusieurs, mais un seul, mon ami – et nous nous portons garants l’un de l’autre. Au moins dans le présent sans préjuger de ce que l’avenir engendrera ou détériorera. Notre œuvre sera double, faite des compléments que l’un apporte à l’autre, de l’unité qui ainsi se réalise. Tout s’appuie sur une reconnaissance de soi, de même que sur l’apport d’une différence subtile fournie par l’ami : nous nous ressemblons, mais nous nous ne confondons pas. Les exemples sont rares, et pourtant ils ont marqué le théâtre occidental. Leur faiblesse numérique ne doit pas nous décourager ni nous tromper sur leur impact. L’amitié duelle se définit comme une amitié centrale, unique, distincte des amitiés épisodiques à la survie limitée aussi bien que des amitiés de groupe. Elle a déposé des empreintes décisives sur la scène européenne.
L’amitié des bâtisseurs
Le théâtre moderne est né d’une amitié et fondé par elle, l’amitié entre Némirovitch-Dantchenko et Stanislavski, qui, ensemble, ont imaginé le Théâtre d’art et l’ont imposé à travers des épreuves et des réussites. Leur amitié fut à l’origine scellée par un événement, la fameuse rencontre de dix-sept heures au Bazar slave (1897) lorsqu’ils ont partagé leurs projets et éprouvé le sentiment d’une communion à même d’accomplir l’utopie dont ils éprouvaient ensemble la portée essentielle. Cet événement s’explique par l’extraordinaire fusion intellectuelle et affective qui a relié les deux partenaires déçus par le présent mais habités par la perspective d’un renouveau possible. Amitié-événement qui, comme disait Montaigne à propos de la sienne avec La Boëtie, n’a pas besoin du temps pour mûrir ni de précautions pour se nouer. « Notre amitié, écrit Montaigne, n’avait rien à voir avec des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions, de longues et préalables conversations ». Amitié dépourvue de suspicion et animée par la confiance soudainement reconnue. Ainsi, au Bazar slave, grâce aux partenaires en présence surgit la perspective d’un programme de renouveau conforté par l’amitié qui lui sert de moteur aussi bien que de cadre. Les deux amis se soutiennent, s’entretiennent, et ainsi chacun sert l’autre. Amitié des bâtisseurs dont le présent du cœur et l’avenir d’une attente s’imbriquent. Ils sont synchrones, contemporains et dialogiques. Il n’y a pas de priorité, il n’y a que de la simultanéité. Les deux amis élaborent en commun leur vision et amorcent son exercice en s’appuyant sur l’assise complémentaire des affects et des idées. Le Théâtre d’art de Moscou – fruit d’une amitié. Il est issu de ce partage réciproque sans nulle arrière-pensée, de l’impulsion apportée par le caractère affirmatif de l’ami associé au projet. Amitié de bâtisseurs.
Cette amitié-événement se définit par le surgissement explosif de l’élection réciproque car les deux amis en présence éprouvent le sentiment que leurs identités s’élargissent grâce à cette force qui alimente l’accord sur les attentes aussi bien que sur les solutions envisagées. L’amitié légitime pleinement l’action programmée vu qu’elle rapproche, sécurise et mobilise les partenaires. Au Bazar slave durant leur rencontre historique les deux protagonistes infirment la mise en garde d’Aristote : « si la volonté de contracter une amitié est prompte, l’amitié ne l’est pas ». Ce jour et cette nuit-là elle le fut. Le contexte partagé des idées et des désirs de renouveau se trouve à l’origine de son émergence explosive.
Mais l’amitié ne reste que rarement immuable, elle se raffermit ou s’affaiblit sous l’impact de la coexistence des partenaires qui, forcément, ne restent pas insensibles au passage du temps. Pour preuve, l’érosion du lien fondateur du Théâtre d’Art de Moscou dont Boulgakov dans le RoMAN ThéâTRAL atteste avec humour la dégradation. L’amitié entre Stanislavski et Dantchenko a fini par se convertir en stratégie d’entreprise, en image de marque, en slogan promotionnel : sa vérité s’est évanouie. Boulgakov, de l’intérieur, dénonce le simulacre et l’instrumentalisation de l’amitié d’origine. C’est pourquoi son roman appelle une lecture plus complexe où l’on intègre, outre le constat désabusé actuel, le souvenir de la confiance perdue et de l’unité originaire dont les deux amis jouissaient en commun. Ruine d’une amitié aujourd’hui détériorée. Les protagonistes l’ont admis, ils ne se sont pas trompés mais ils ont continué de la « jouer » pour des raisons de survie, voire même de mythologie de leur entreprise. Boulgakov a dénoncé ce camouflage.
Une autre amitié engendrée sous les meilleures auspices fut celle, légèrement différente, entre Copeau et Jouvet. Amitié dissymétrique et non pas paritaire car, pour citer Torquato Tasso, il y a des amitiés qui naissent d’une adoration initiale pour se métamorphoser ensuite en affection partagée. Elles exigent du temps afin de mûrir et se convertir en relation partagée : Copeau — Jouvet ! Lien qui évoque l’autre couple, plus célèbre encore, Goethe — Eckermann. Chaque fois la différence d’âge et de statut se trouve surmontée, mais l’amitié perdure si, pour de vrai, la parité s’instaure. Ce ne fut pas le cas de Copeau qui voulut préserver son statut prioritaire au point d’exaspérer Jouvet : à force de rester dissemblables, les amis se séparent et l’amitié se brise. Secouée par ce déséquilibre, elle se fracture comme un navire en pleine mer. Les amis se dissocient, leurs chemins divergent, ils ne gardent plus que le souvenir de leur confiance de jadis. Rien ne sera plus comme avant et l’amitié, rapiécée, ne procurera pas la confiance indispensable à toute action engagée à deux.
Une autre amitié de bâtisseurs se trouve à l’origine de ce qui marqua la retour du Théâtre d’art : l’amitié de Giorgio Strehler et Paolo Grassi. Elle trouve ses assises, comme jadis à Moscou, grâce à leur programme commun car le Piccolo entend prendre le relais et trouver des réponses nouvelles aux questions similaires. Strehler et Grassi s’associent pour inventer un théâtre qui s’inscrit dans la lignée de Stanislavski et Dantchenko aussi bien que de Copeau et Jouvet, également engagés, eux aussi, dans la voie du « théâtre d’art ». Entre les amis de Milan la relation reste similaire à celle de leurs pairs du Bazar slave. Ce n’est pas le même avec le même qui s’associent, car une différence subtile les rend complémentaires et l’ami s’érige en « frère adoptif » chargé d’une identité non pas semblable, mais « apparentée » à son partenaire. Strehler assume la direction artistique et Grassi veille aux destins administratifs de la nouvelle institution mise en place, mais tous les deux collaborent dans un même effort à l’accomplissement d’une utopie concrète : un théâtre d’art dressé sur les ruines de la guerre. La perspective se formule à deux, les tâches sont distinctes, l’amitié surmonte les différences. Le Piccolo sera un théâtre d’art engagé ! Engagement qui n’entraîne nulle transaction politique sur le plan artistique : ils restent indissociables, comme Strehler et Grassi. Fruit de leur amitié, ce théâtre leur ressemblera !
Mais, ici aussi, la longévité de l’amitié s’est avérée limitée. Pourquoi ? Sans doute parce que les rapports aussi bien que la nature du projet ont fini par se modifier, s’éroder et se dégrader. Grassi s’éloigne du Piccolo, Strehler le quitte un laps de temps pour revenir ensuite comme seul maître à bord accompagné par des collaborateurs soumis. De même qu’entre Copeau et Jouvet, les deux amis assument au sein du théâtre leur rupture qui n’échoue pas pour autant en conflit public. Ils n’ont pas prolongé ce qui était éteint, ils se sont méfiés du simulacre et ont adopté le principe de vérité comme règle de conduite pour l’instauration ou la sauvegarde de leur amitié aussi bien que pour le constat de sa ruine.
Et comment passer sous silence l’amitié admirative de Ludwik Flaszen qui, une fois nommé directeur à opole, cette petite ville polonaise, s’est tourné vers Jerzy Grotowski pour lui proposer d’assumer la responsabilité du Théâtre des Treize rangs (1959), qui deviendra la matrice du Théâtre Laboratoire construit sur la base de cette amitié préliminaire préservée tout au long de la période théâtrale de Grotowski. La relation duelle qui a uni Flaszen à Grotowski se trouve à l’origine d’une des plus radicales aventures du théâtre occidental dans la deuxième moitié du xxe siècle.

Photo D. R.
Plus récemment, en France, il est important de citer cette expérience binaire qui a perduré, celle de la compagnie Vincent — Jourdheuil, véritable agent mobilisateur du paysage théâtral des années 70 pour se défaire ensuite et se reconstituer avec un autre partenaire Jourdheuil — Peyret. À l’écart de l’institution qu’elle a refusée, cette compagnie « double » reste emblématique pour les vertus dialogiques de l’amitié au travail. On ne dirige pas tant une institution, mais on crée tout de même un outil de production.
- Marie-Christine Autant-Mathieu, CRÉER ENSEMBLE, POINTS DE VUE SUR LES ARTISTE (FIN DU XIXe-XXe SIÈCLE), Montpellier, l’Entretemps, collection Les voies de l’acteur, 2013. ↩︎
- Alternatives théâtrales, no 12, juillet 1982, Scénographie : images et lieux. Numéro épuisé, disponible en PDF. ↩︎