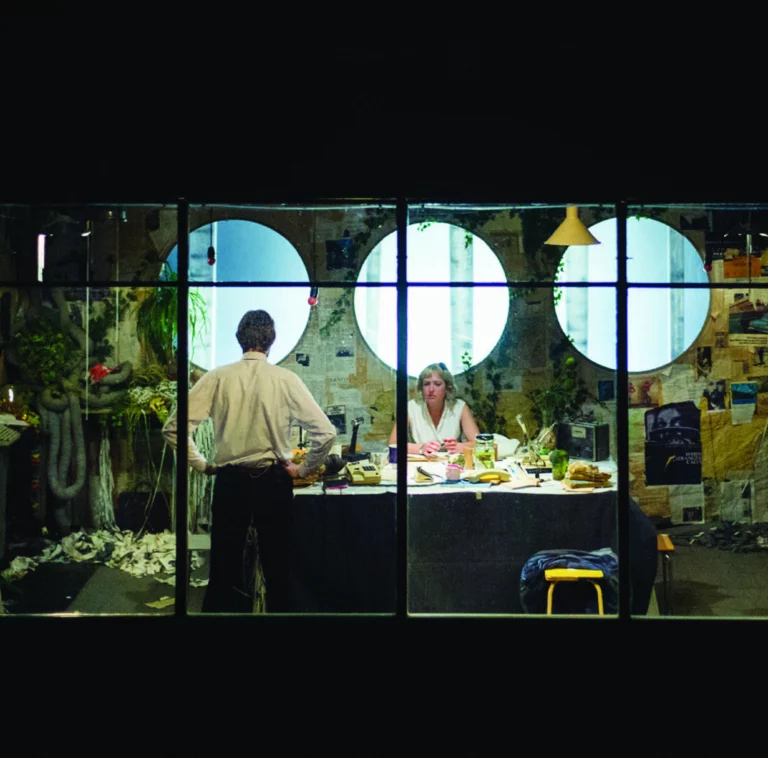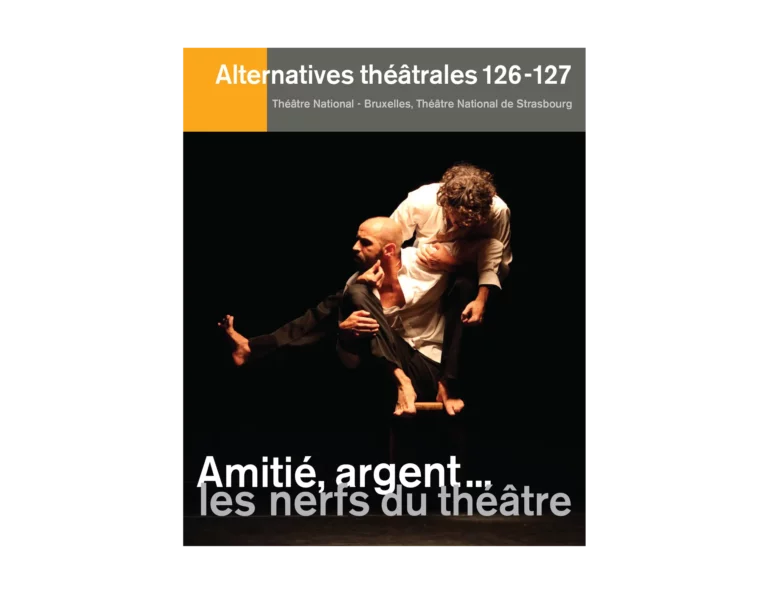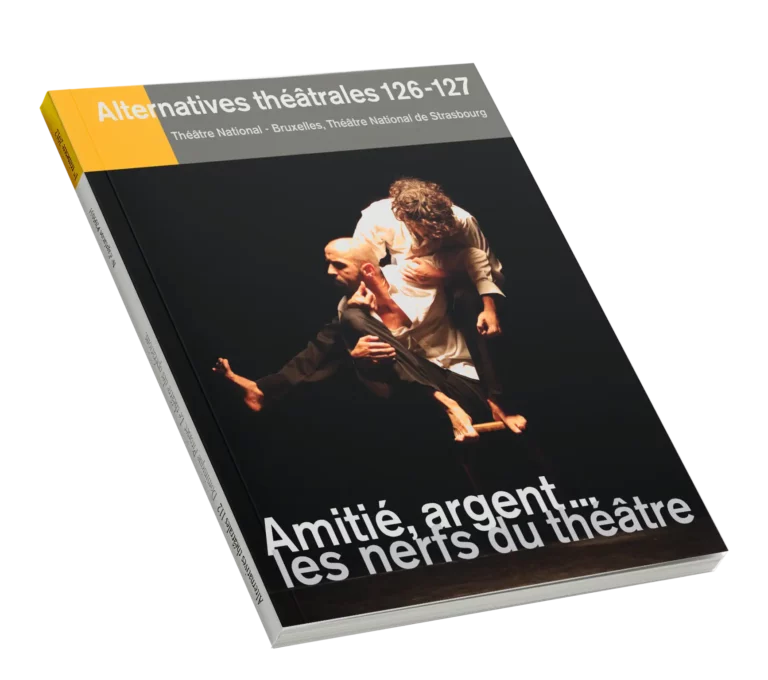Propos recueillis à l’occasion d’une rencontre publique organisée par le kunstenfestivaldesarts, 26 mai 2015.
BENOÎT HENNAUT : Le contexte et le champ théâtral dans lequel vous travaillez est le plus souvent défini comme le « théâtre indépendant » de Buenos Aires, par opposition au théâtre officiel directement soutenu par l’état, d’une part, et au théâtre commercial, largement diffusé sur l’Avenue Corrientes notamment, d’autre part. Que pensez-vous de cette appellation ? Est-elle toujours valable et utile aujourd’hui pour décrire votre travail et son contexte ?
Mariano Pensotti : C’est un terme qui peut signifier beaucoup de choses différentes. Il définit au minimum un système de production qui s’éloigne d’un format de deux mois de répétitions dans une salle contrôlée par l’état, ou d’un lien avec un théâtre qui recherche un bénéfice commercial prioritaire. Il est au contraire basé sur le désir commun d’un groupe de faire du théâtre de manière auto-gérée, coopérative, qui démarre un projet sans bien savoir ce qu’en sera la forme finale. De manière générale, le théâtre le plus intéressant qui est produit à Buenos Aires appartient à cet ensemble du théâtre indépendant. En revanche, je reste réticent face à cette appellation et à la tentation d’une forme de romantisme qui lui serait applicable. Il y a en effet un certain danger à penser qu’en Amérique latine un grand nombre de productions puisse se créer sans beaucoup d’argent, de manière fragile, sur base d’un fort engagement de la part des artistes et de leur entourage. La vérité est que cette situation n’est ni agréable ni désirable ! C’est un système qui s’impose à nous et qui nous oblige à fonctionner de cette manière. Ce n’est pas que notre créativité soit débordante grâce au fait de ne pas avoir d’argent et que personne ne nous appuie. Au contraire, notre manière de travailler doit s’inventer malgré ce contexte, et non pas grâce à lui.
Federico León : Indépendant réfère aussi au fait que le théâtre que nous pratiquons réunit un certain groupe de personnes indépendamment du fait qu’une pièce doive en sortir et être créée à une certaine date et dans un certain lieu. L’attention se porte essentiel- lement sur le processus de création de la pièce, à la différence d’un théâtre à visée commerciale ou d’un canevas plus institutionnel, dans lesquels le format d’aboutissement du travail est dès le départ beaucoup plus important.
B. H.: y a‑t-il un lien avec le système d’ateliers ou d’écoles de jeu et de dramaturgie qui est particulièrement développé au sein du théâtre indépendant ? L’idée y est en effet très souvent de développer un travail dont l’issue est incertaine, car c’est au processus du jeu ou de l’écriture qu’on s’intéresse en priorité.
F. L. : C’est possible. De manière générale, on connaît évidemment le cadre dans lequel on travaille, et l’existence d’un calendrier de production. Mais le fait est que le rythme et la temporalité s’envisagent sur un temps plus long, dans le respect du matériel qui va composer la pièce, tenant compte de son évolution. L’indépendance c’est également une zone de liberté. Cependant, la production n’est jamais totalement indépendante, ne fût-ce que parce que la pièce devra au final cohabiter avec d’autres dans un même théâtre, ce qui engendre d’énormes contraintes.
Pour revenir à cette visée romantique ou idéalisée d’une création sans argent, il faut également souligner que cette absence de sécurité des moyens influence cette emphase sur le processus, le fait de démarrer avec une idée ou un texte qui vont aller en se modifiant. L’imprévisibilité du cadre renforce l’imprévisibilité du processus de création. Celui-ci reste ouvert, recelant sa part de mystère quant au développement qu’il peut suivre. Ainsi, cette idée romantique d’un contexte dans lequel rien n’est jamais certain, d’un pays dans lequel changent constamment les règles, produit quand même concrètement une série de ressources créatives.
B. H.: Les deux spectacles que vous créez cette année présentent une série de points communs, bien qu’ils développent des esthétiques très différentes. C’est le cas par exemple du traitement de l’archive, du matériel perdu, jeté dans la corbeille de l’ordinateur (LAS IDEAS) ou enterré dans des sacs plastiques au fond d’un jardin (CUANDO VUELVA A CASA…). Il s’agit de travailler avec quelque chose qui se refuse, qu’on ne veut plus voir ou connaître, qu’on veut cacher, mais qui revient au devant de la scène malgré la volonté des personnes. Quelle est la relation que vous avez développée avec cette idée d’un matériel caché ou proscrit, en tant que matériau créatif ?