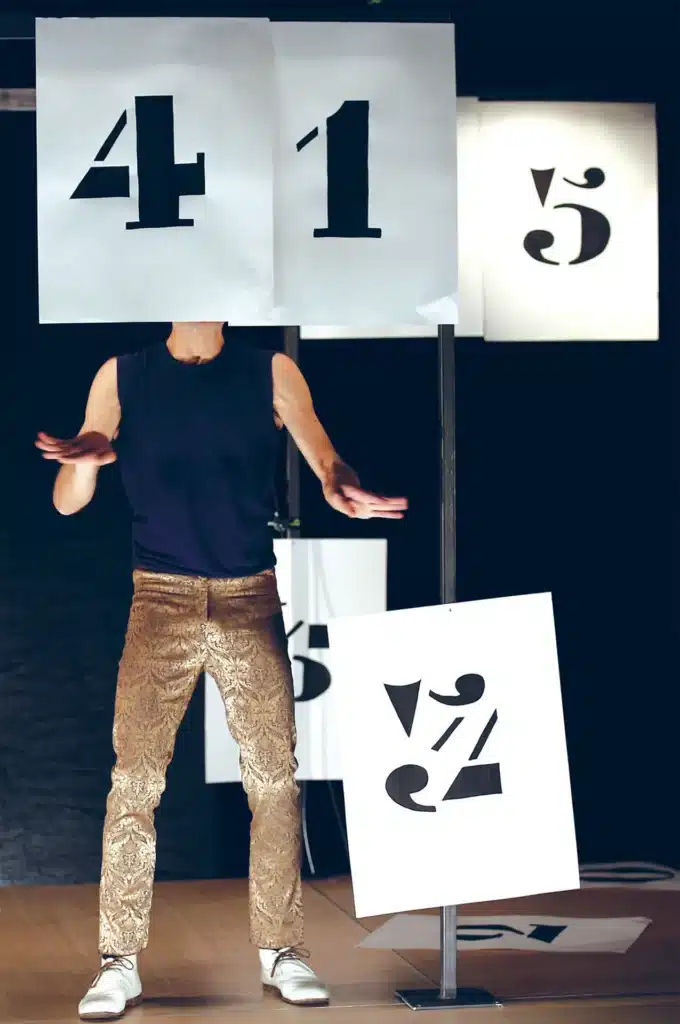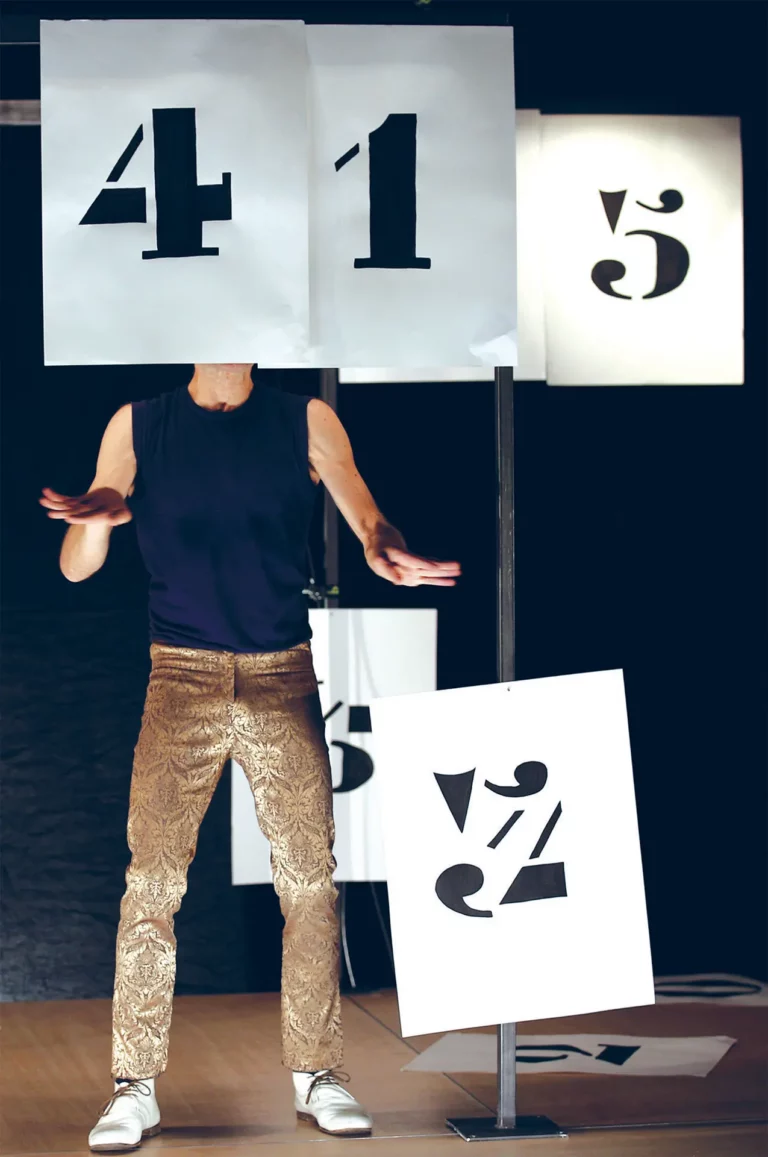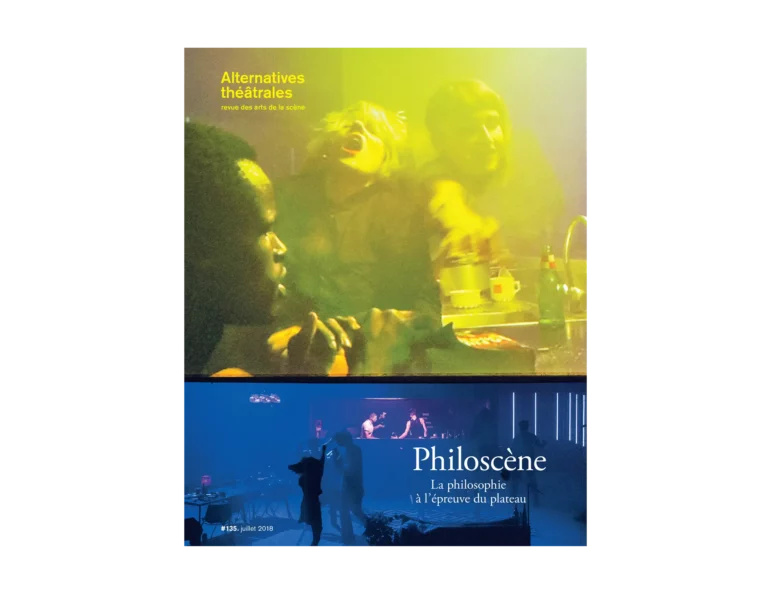L’engagement d’Alain Badiou se développe et se décline avec bonheur entre philosophie, politique et création théâtrale.
Fortement marqué dans sa jeunesse par l’univers impérial et les guerres coloniales en même temps que par l’arrivée massive de travailleurs immigrés, il a puisé dans ces évènements historiques la matière première de son théâtre. Lecteur attentif du théâtre antique et classique, où depuis toujours le personnage de la plus basse des classes est le héros de la comédie – l’esclave chez Plaute, le valet chez Molière – Alain Badiou a prolongé cette tradition en choisissant un héros de banlieue pour en faire le personnage central de sa Tétralogie d’Ahmed1, faisant le pari que « quelque chose de la vérité n’est perceptible, n’est lisible que du point de vue de celui qui est exclu ». C’est lui qui est porteur de la vision réelle des contradictions que la société produit. Ce théâtre de l’opprimé, pour parler comme Augusto Boal, fait de l’esclave et du valet, celui qui permet de dénouer les intrigues de la société, et de rouler dans la farine les dominants.
Dans l’effervescence des années 1968, qui auront marqué en profondeur toute une génération, des étudiants et de jeunes professeurs allaient à la rencontre d’ouvriers algériens et marocains ; ensemble ils tentaient de démêler les nœuds des principes d’oppression qui étaient au cœur de leur situation. Alain Badiou a participé à ces tentatives de proximité de la jeunesse avec les travailleurs immigrés.
Le personnage d’Ahmed est le fruit de la familiarité de son auteur avec l’histoire du théâtre, conjuguée à une expérience concrète de participation aux mouvements de contestation sociale et politique des années 1950 et 1960.
Deux des pièces de la tétralogie sont des réécritures. La première, Ahmed le subtil, est la transposition moderne des Fourberies de Scapin de Molière et la quatrième, Les Citrouilles, celle des Grenouilles d’Aristophane.