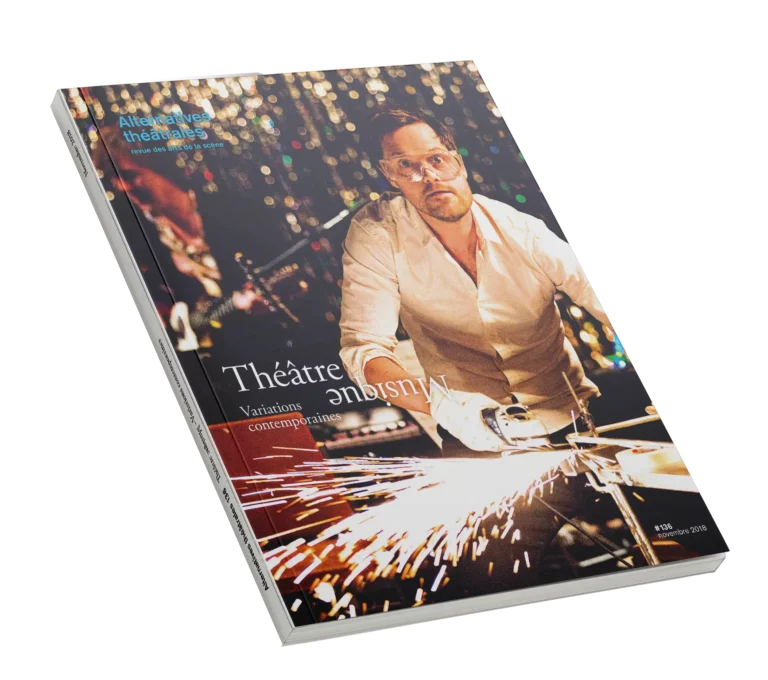CT
Comment l’association de la musique avec le théâtre est-elle venue dans ton parcours
MB Parlons peut-être du cinéma pour parler de la musique : c’est le cheminement qui a été le mien. La musique fait, à bon ou mauvais escient, partie intégrante du cinéma ; son usage y est codifié, reconnaissable. Quand j’ai commencé à faire du théâtre, la question du cinéma était prédominante : plus précisément celle du montage, essentielle au cinéma. Qu’y a‑t-il entre les plans ? Souvent la musique fait le lien. À nos débuts, avec la compagnie Sentimental Bourreau, on ne se posait pas toutes ces questions, mais on baignait dedans, c’était concret : il fallait se mettre d’accord sur la manière d’opérer. Comment agencer les textes à partir des sujets, trouver des transpositions sur le plateau… ? J’ai le sentiment que, dans ces montages parfois un peu abrupts, la musique a fait le lien. Elle permettait de digresser, rebondir, de créer des passerelles entre les différents textes, et toutes les associations d’idées qu’on pouvait faire. Et puis, il y avait une pratique : je suis musicien de formation, percussions classiques, puis batterie. Vers seize ans, je suis parti sur les routes avec des groupes de rock, j’ai beaucoup aimé ça, et je crois en avoir toujours gardé un rapport direct et instinctif d’énergie. Mais on en fait vite le tour, à partir du moment où l’on a une certaine curiosité, ce qui était notre cas – je dis « notre », car il y avait déjà avec moi Sylvain Cartigny, bassiste et guitariste, et nos pratiques sont intimement liées… Vers dix-huit ans, on s’est dit qu’il nous manquait les rapports à l’image, au texte, à la pensée. On a commencé à rêver d’albums ou de concerts concepts, d’opéra rock… On écoutait beaucoup Franck Zappa, les Beatles, les Stones, Bartók, Stravinsky, Charlie Mingus… C’était très éclectique. On a eu le désir de prolonger notre geste. Et il y avait également un désir de théâtre, puisque familialement je viens de là… Très vite, donc, il y a eu l’envie de réunir ces amours : cinéma, littérature, musique, théâtre. On a invité quelques camarades à nous rejoindre : des musiciens, et des gens venant du théâtre, comme Judith Henry. De ce groupe est né Sentimental Bourreau, et nous avons commencé à faire du théâtre avec, comme postulat, qu’on monterait des spectacles à partir d’essais, de livres d’art, de journalisme, de scénarios, du cinéma – aucun texte dramatique – et pourquoi pas de la musique, mais c’est arrivé un peu plus tard.
CT
Que prenait en charge la musique dans ces premiers spectacles ?
MB L’énergie, et la tension. Avec l’âge, j’ai appris à travailler avec le corps d’un acteur, sa voix, sa capacité à incarner, mais à l’époque, on n’avait pas du tout cette capacité, ni la volonté. On avait une approche très formelle, on produisait des signes, des images, mais pas à l’endroit de l’interprétation. D’une certaine façon, la musique venait s’y substituer.
CT
L’énergie, mais aussi l’affect ?
MB Oui, quand même… Mais c’est là que je me méfie de la musique, et c’est pour ça aussi que je fais du théâtre : la musique peut être très manipulatrice ; trois accords un peu répétitifs, et tu obtiens tout de suite l’émotion souhaitée. C’est pour cela qu’elle peut parfois devenir indécente dans certains spectacles, soulignant, accompagnant, captant l’attention, disant ce que le spectateur devrait ressentir… On connaît ces codes par cœur, ils sont insupportables. On n’utilisait pas cela avec Sentimental Bourreau, on l’évitait même à tout prix, mais l’énergie. Et l’adresse : l’arrivée des micros sur les plateaux, que tout le monde a empruntés grosso modo à la pop ou au rock, a fait tomber définitivement, pour moi en tout cas, le quatrième mur. Et c’était juste par rapport au théâtre qu’on voulait construire. Toutes les comédiennes chantaient, on pouvait donc facilement insérer des moments de chanson, comme on pouvait en trouver dans certains films qu’on aimait. D’un côté, il y avait ce travail avec la compagnie, et, de l’autre, on avait une activité de musiciens sur d’autres spectacles : les Imprécations de Michel Deutsch (qui réunissaient André Wilms, Judith Henry et Marie Payen, et six musiciens dont ceux de Sentimental Bourreau, au sein d’un groupe qu’on avait appelé Sentimental Trois Huit) ont été très importantes. Michel avait écrit ces textes dans une tradition brechtienne et müllerienne (le montage, encore), et notre musique y jouait un rôle essentiel d’articulation, de liant, d’énergie, ou de moments singuliers. Notre pratique musicale était très particulière, ce n’était pas une approche de compositeurs : en termes d’écriture, il n’y avait pas chez nous la conscience d’une grammaire…

CT
Une conscience de faire du théâtre musical ? Vous ne définissiez pas du tout votre pratique en ces termes ?
MB Non. Ce que j’ai très vite remarqué, c’est que la musique avait une part énorme dans nos spectacles, de même que dans les spectacles de Deutsch auxquels nous participions. Mais on n’en avait pas conscience, parce qu’on n’avait pas, ou très peu, de commentaires dessus. Les critiques de théâtre qui venaient voir nos spectacles, dans lesquels il y avait trente minutes de musique sur une heure quinze, nous faisaient des retours sur ce qu’on avait produit en termes de littérature, de sens, ou même de rapport à l’image, mais pas sur la musique. Donc, pendant longtemps, je n’ai jamais considéré que je faisais du théâtre musical. On faisait du théâtre avec de la musique, c’était une des composantes avec lesquelles on travaillait. Puis, nous avons joué en Allemagne, et là, pour la première fois, on a eu des articles assez incroyables sur la musique, bien construits, avec des références. Cela nous a donné conscience du pouvoir de la musique dans notre travail. Il y a là-bas une tradition, brechtienne en particulier, de la musique sur la scène. Karl Valentin, les Dada, Hanns Eisler-Brecht, Kurt Weill-Brecht, jusqu’à Einstürzende Neubaten, les pièces radiophoniques… Les spectacles de Castorf sont remplis de musique, par exemple, plutôt rock ou folk. En France, je ne trouve pas d’équivalents. Il y avait un peu Alexis Forestier, qui venait plutôt de la chanson et avait basculé vers le texte, très influencé par Dada et les contre-cultures, le punk… Sinon, on était du côté de la musique contemporaine, de la musique sérieuse, mais nos partitions ne ressemblent absolument pas à ça, elles s’adressent à des comédiens qui ne savent pas lire la musique. Il y a eu aussi la découverte des spectacles d’Heiner Goebbels, qui, eux, s’inscrivaient vraiment dans une association entre les deux disciplines. Goebbels qui, juste après Ou bien le débarquement désastreux, avait fait un spectacle magnifique sur un de nos albums préférés, Pet Sounds des Beach Boys. On était dans la musique savante, mais il était aussi possible de construire sur la culture pop des spectacles ultra-savants. Ça a été un choc, et on s’est dit qu’il y avait quelque chose qu’il fallait un peu plus affirmer à l’endroit de la musique, qui était une de nos spécificités. Et l’écriture de Müller aussi, l’idée de matériau : travailler avec des fragments, reconstruire à partir des ruines. J’étais complètement dans cette logique.
CT
Le fait que Heiner Goebbels fasse de la musique savante tout en venant du punk, des musiques expérimentales, cela ouvrait un espace pour toi ?
MB Oui, il venait de la Rote Fanfar, qui jouait dans la rue pour accompagner les manifestations dans les années 1970, avec un répertoire de chansons révolutionnaires de Hanns Eisler…
CT
Eisler est pour toi un maître de théâtre musical ?
MB Oui. Il est musicalement bien plus intéressant que Kurt Weill, en termes de complexité d’écriture, d’harmonie, de timbres… Énormément empruntés au jazz, qu’on aimait aussi beaucoup, car il y soufflait un vent de liberté. Les années 1930, c’est magnifique : Eisler, Duke Ellington… Et là, on parle des rapports entre culture populaire et culture savante. C’est ce que j’ai tant aimé chez Bartók : toutes ses pièces à partir des mélodies et chansons folkloriques qu’il est allé recueillir dans les campagnes hongroises et roumaines. Pour Bartók, il n’est pas possible de se couper des racines populaires, au risque d’une rupture avec le peuple (au meilleur sens du terme) et le monde. La question de ce qui nous réunit tous et qui est peut-être de l’ordre de l’universel – une mélodie qu’on reconnaît, qu’on peut identifier, chantonner, faire sienne – me hante : comment on est traversé par les émotions sans qu’elles se limitent à notre petit « moi » personnel, mais peuvent porter une aspiration à plus loin que nous. Populaire/savant : j’ai aussi aimé le cinéma pour ça. Et je crois que chez les compositeurs que je préfère, que ce soit Zappa ou Eisler, il y a toujours, même dans les écritures les plus complexes, quelque chose qui est identifiable. J’essaie moi-même d’amener les gens à des endroits où je considère qu’il y a toujours une porte d’entrée possible, même dans ce qu’on pourrait considérer comme la pointe de la radicalité. Pour moi, tout fait théâtre, tout peut faire sens, mais la question est : comment trouver des points de jonction, comment pouvoir s’y projeter ? La musique permet cela. Quand je suis arrivé à Montreuil en tant que directeur, je me suis vite dit que le rapport entre théâtre et musique était un endroit où, potentiellement, un dialogue pouvait se mettre en partage avec les spectateurs.
CT
La question de comment certaines musiques peuvent toucher tout le monde est très prégnante dans tes derniers spectacles…