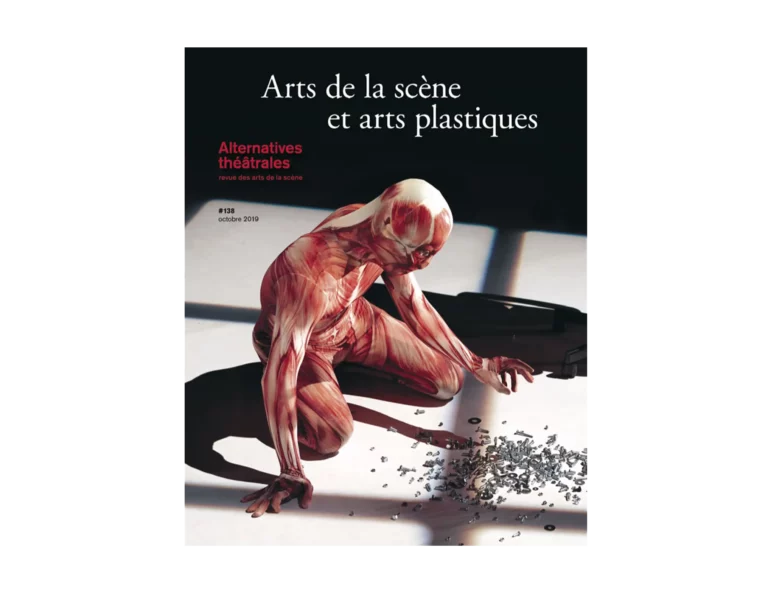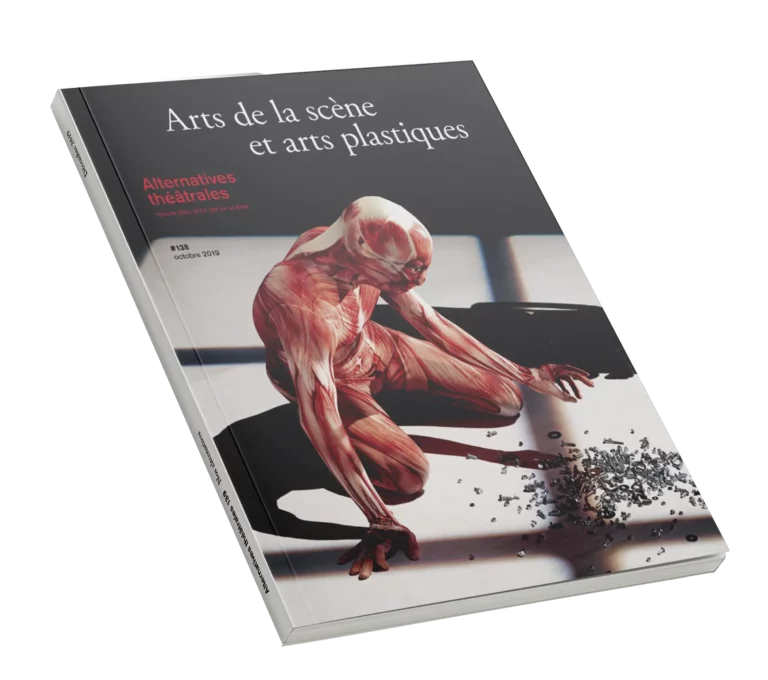Tandis qu’il rejouera la saison prochaine au Théâtre National à Bruxelles ses Vies en soi – cinq « épopées intimes » de 60 minutes chacune –, Patrick Corillon déploiera son nouveau projet Une histoire sentimentale de la ventriloquie dans plusieurs musées de Tournai. Entre les arts de la scène et les arts plastiques, l’artiste navigue joyeusement en suivant le cours de ses fictions vraies qu’il raconte avec objets, images animées et livres créés de sa main.
Isabelle Dumont
Dès tes débuts comme plasticien dans les années 1980, tu as cherché à incarner des récits et les placer dans des espaces – muséaux et autres. Lors de notre entretien pour Alternatives théâtrales en 2014, tu évoquais la nécessité de mettre ton corps en jeu par rapport à ces récits. Tu es alors allé voir du côté des arts de la scène, et depuis 2011 tu racontes des histoires personnelles réinventées. Mais tu n’as pas quitté le monde des arts plastiques pour autant, puisque tu présentes aussi tes récits dans des galeries, des musées…
Patrick Corillon
Mon identité la plus profonde, c’est de transmettre des histoires en partant du principe que le flot d’une histoire est comme le flot de l’eau : il peut s’introduire partout, dans tous les mondes, tous les domaines. Donc dès le départ, je me dis que mes spectacles vont pouvoir aller partout : dans un théâtre, une bibliothèque, dans la rue, dans ma maison, dans une galerie ou un musée. Ce n’est pas que j’envisage des adaptations spécifiques, mais ces environnements différents apportent quelque chose de spécifique à la représentation… De même les objets, qui sont les fils conducteurs de mes récits, je les imagine d’emblée aussi bien sur une scène que dans une salle d’expo ou dans un livre.
Isabelle Dumont
Et qu’apporte le musée comme spécificité aux spectacles et objets que tu y proposes ?
Patrick Corillon
Pour moi, le musée n’est pas un écrin de conservation, c’est un lieu de dialogue, de résonance entre les oeuvres qui s’y trouvent « éternisées » et les performances « momentanées » que je peux y proposer. Le musée montre les objets dans un rapport au temps et au monde qui n’est pas le même que celui qu’on peut trouver au théâtre, et c’est ça qui m’intéresse. Le théâtre a une forme de réactivité par rapport à l’époque dans laquelle on vit – à travers l’écriture et le vivant sur scène qui mettent en perspective nos psychologies et expériences humaines – alors que les arts plastiques, même s’ils réagissent à des faits de société, vont plutôt chercher une essence à travers la forme. Je trouve mon équilibre entre les deux.