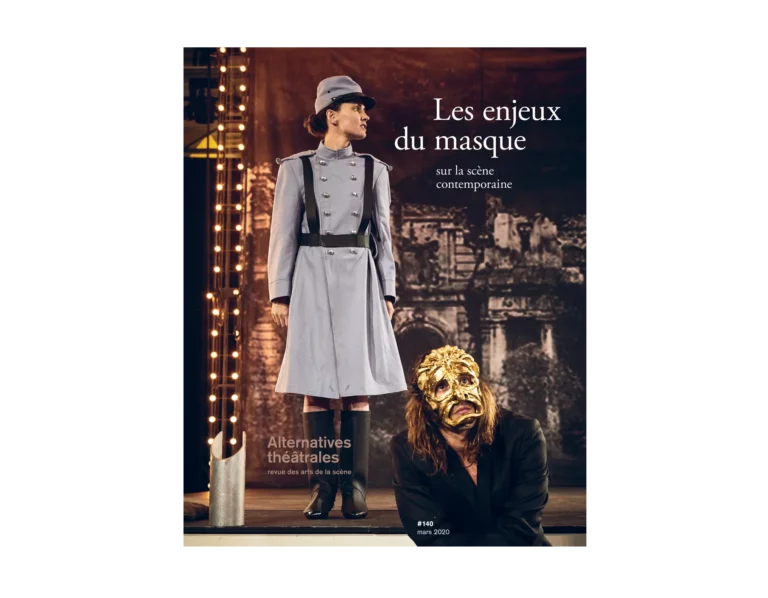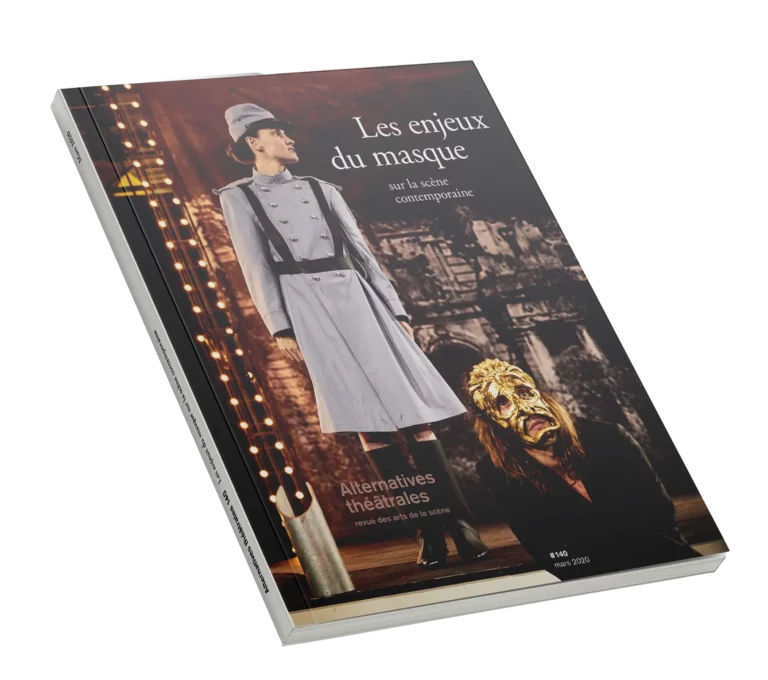Dans quelles conditions as-tu porté le masque pour la première fois au Théâtre du Soleil ?
Comme beaucoup de comédiens, je suis entré au Théâtre du Soleil après un stage, où l’on travaillait essentiellement les masques. C’était pendant Sihanouk1, en 1986. Et je me souviens que tu donnais à cette époque la préparation corporelle avant les spectacles. C’est durant ce stage que j’ai porté pour la première fois des masques balinais. Je n’en avais jamais vu avant, alors que les demi-masques de la commedia dell’arte je les connaissais un peu, car j’avais étudié trois années à l’École Marceau. Ensuite, dans tous les spectacles, les masques ont été présents. Pas forcément dans le spectacle lui-même, mais pendant les répétitions où ils étaient toujours derrière les rideaux. Même quand on a monté Le Tartuffe2, les masques étaient là, rangés dans un casier et ils accompagnaient notre travail de leur présence. Ils étaient nos guides, des « ouvreurs » de théâtre… Plus tard, on s’est éloignés un peu de cette utilisation des masques, mais il nous arrive parfois de les ressortir, quand Ariane ressent le besoin de renouer avec une théâtralité plus affirmée et désire travailler plus à fond les signes de la transposition du jeu, ce qu’elle nomme les « lois fondamentales du théâtre ».
Pourrais-tu préciser la place occupée par le masque dans les processus de création du Théâtre du Soleil ?
Ces processus diffèrent selon les spectacles. Dans Les Éphémères3, par exemple, les masques étaient totalement absents. Et pourtant, je dirais que même dans ce spectacle, le masque, en tant qu’esthétique de jeu et recherche de théâtralité, était présent. Le jeu masqué est toujours au centre de notre approche du théâtre parce que le masque oblige l’acteur à une transformation corporelle et faciale, qui passe le plus souvent par le maquillage. Quand on se maquille au Soleil, c’est pour devenir quelqu’un d’autre, et ce maquillage est une continuité du travail du masque. Donc, même dans un spectacle qui apparemment est très éloigné du jeu masqué, comme Les Éphémères – où l’on parlait de ce qui nous était proche, de nos histoires, de nos familles, de nos voisins – on avait toujours avec nous cet outil essentiel qu’est le masque, pour nous aider à aborder le personnage comme quelqu’un d’autre que soi. Dans d’autres spectacles, comme Tambours sur la digue4, le masque est le cœur même de notre recherche.
Et cependant il n’y avait pas de masque à proprement parler, si ce n’est un masque-maquillage…
Nous utilisions des bas que nous avions maquillés et que nous appliquions sur notre visage en les transformant par l’accentuation de certains volumes, notamment les joues. Nous rendions notre visage vraiment conforme à un masque, avec des parties rigides et d’autres mobiles, en particulier bien sûr les yeux. Et ce masque souple s’alliait à un travail de « marionnettisation » du corps pour créer un « masque total », qui rejoint la marionnette. La marionnette, dans Tambours, était notre propre corps, cet outil premier de la transposition de l’acteur. Dans ce spectacle, j’ai été, comme l’on dit au Soleil, une « locomotive », en ouvrant le chemin vers la plasticité des corps dans l’espace. Car la marionnette ce n’est pas qu’un objet, c’est toute une esthétique. Comme le masque, elle impose ses lois, une théâtralité. Les principes gestuels que j’ai appris auprès de Marceau – qui fut un Maître pour moi – m’ont beaucoup servi dans ce spectacle, comme prendre une impulsion en arrière pour aller de l’avant, ou descendre avant de s’élever. Ces lois du mime sont celles du mouvement, et on les retrouve partout, en particulier dans le théâtre asiatique. Elles m’ont aidé pour arriver à trouver un corps en apesanteur, ce qui est le propre de la marionnette, un corps artificiel qui devait sublimer les contraintes de la gravité.
Qu’entends-tu par l’expression « marionnettiser » son corps ?
À un moment, après trois ou quatre mois, Ariane a voulu qu’on fasse une pause dans notre travail car on n’arrivait plus à avancer. Jusque-là, on se référait à la marionnette, mais de loin, alors je me suis dit : « et si j’essayais vraiment d’être une marionnette ? ». Je me suis mis autour du bras un bambou qui pouvait être manipulé, autour de la taille un harnais que l’on pouvait tenir et un hakama5 qui cachait mes pieds… je voulais essayer d’être vraiment une marionnette, de ne rien faire et d’accepter que mes camarades me manipulent. Bien évidemment, quand je voulais me déplacer, j’indiquais par un signe où je voulais aller, par exemple en baissant mon point d’appui pour prendre un élan que les manipulateurs transformaient en un saut. Cela a été une révélation. Un moment de grâce. Ariane a tout de suite ressenti que c’était par là qu’était la voie du spectacle, et qu’on avait enfin trouvé.
Dans ce travail, tu as dû quitter ton corps quotidien pour accéder à une forme de jeu non réaliste, ce qui est également le propre du jeu masqué…