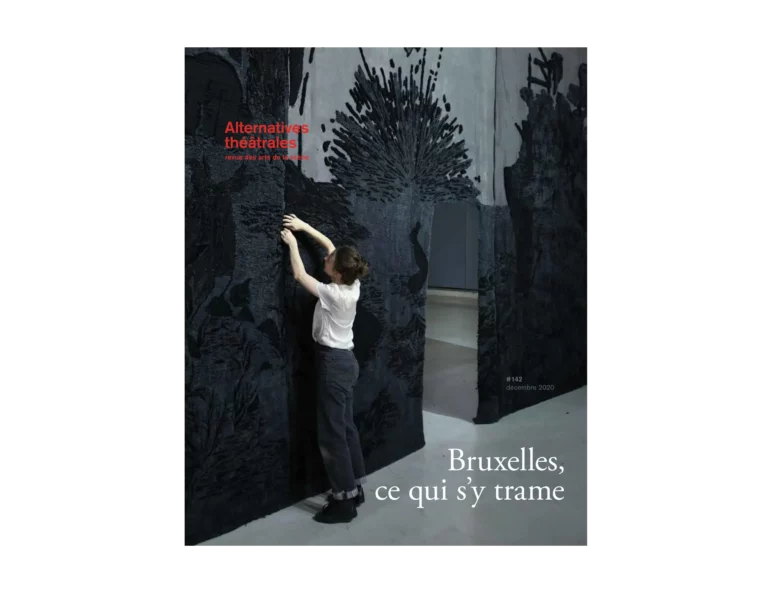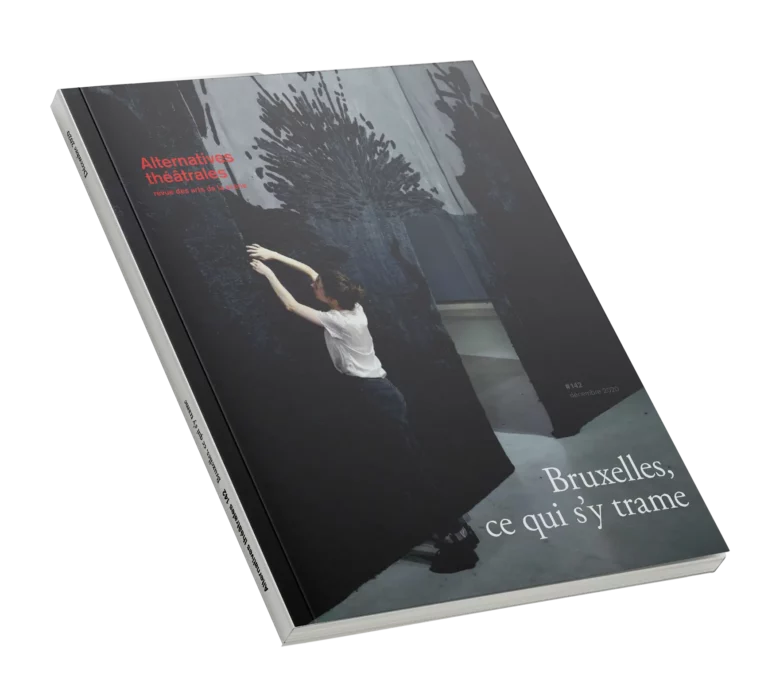En écrivant aujourd’hui cet article au sujet du travail de Léa Drouet*, que j’assiste depuis la création de Boundary Games (2017), je mesure à quel point ses hypothèses de création nourrissent une attention particulière à prendre soin de ce qui l’entoure. Hypothèses organisées par des interprètes agissants dans leurs rapports et sur l’espace dans Boundary Games ou par une parole solitaire, habitée par ses fantômes et son besoin de justice dans Violences ou encore incarnées par la prise de risque d’un groupe de skateurs avec Mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve et par l’occupation errante d’une gare désaffectée dans Déraillement ou depuis peu par le dessin d’un lieu de théâtre au 210, Léa Drouet n’a de cesse de vouloir penser et panser ce qui la travaille intimement. Et ceci se résume — s’il fallait introduire notre dialogue par sa fin car il semblerait depuis quelques mois que prendre les choses à rebours serait sans doute une manière saine d’éviter le piège du confortable lieu de la conclusion aveugle — j’introduirai donc notre échange par cette phrase de Léa : « il s’agit de faire confiance à ce qui nous touche ».

Ce qui touche Léa a tout à voir avec la volonté de remettre de la vitalité aux fixités malheureuses dans lesquelles nous nous tenons parfois. Des problématiques migratoires à celles des assignations identitaires, des affects tristes aux sentiments d’impuissance, des désirs d’hospitalités face aux inconforts de l’altérité, de l’amour pour l’intelligence collective confrontée aux conditions liberticides, sa recherche prolonge son engagement et pose une forme d’activisme délicat dans le champ qui lui est propre, l’espace théâtral. Espace qu’elle ouvre et déplace du plateau (Violences) à la rue (Squiggle, performance-conversation dans l’espace public à Athènes), de l’atelier (Boundary Games à Nanterre-AMandiers) au Skate Park (Mais au lieu du péril croit aussi ce qui sauve, KFDA).
Ce désir de déplacement et d’attention à ce qui demeure affecté en elle n’est pas un leurre d’empathie pétrie de bonnes intentions ou de douceur recouvrante mais bien au contraire
une attention politique claire et attachée à la puissance de renversement possible de nos regards et de nos gestes. Faire confiance à ce qui nous touche dans la manière dont nous pouvons supporter le monde dans toute la polysémie de ce verbe. Faire confiance à nos seuils d’intolérance. Faire confiance aux points inconfortables qui persistent dans l’inquiétude et leur tirer les vers du nez avec le plus de précision possible.
J’emploie cette image sans innocence, car oui il s’agit à mon sens de pensées en forme de parasites, d’habitantes, de ce qui grouille en nous de soulèvement comme de gêne au lieu-même de nos vitalités, de nos maladies sociales, de nos plaies politiques, de nos histoires de famille et de celles des autres qu’on aimerait voir se rassembler ou au contraire se diluer, de ces murs qui hantent, empêchent, concentrent et divisent à la fois, de ces héritages troubles ou vidés par le poids des silences, de nos obsessions à déconstruire pour tenir puis re-construire si possible ou simplement laisser vivre.
Autrement dit, c’est la considération des paradoxes faisant nos vies contemporaines (et l’actualité le crie plus que jamais) que Léa Drouet se propose de traverser et de questionner avec les spectateurs.
Nous, nos, notre… comme autant de termes me permettant d’écrire ici à quel point ce que Léa Drouet cherche dans son écriture du plateau est d’une profondeur qui se partage et s’expérimente car ce dont elle « parle », pourquoi et avec qui elle « parle » pourrait bien être un « nous » en forme de question.
Ce « nous » questionné, exposé, renversé et en dialogue avec la pensée de Camille Louis, dramaturge des dernières pièces de Léa Drouet et co-fondatrice du collectif kom.post, n’a rien de complaisant. Il mène au contraire dans les zones délicates de l’expérience du dissensus et de l’apparition des singularités au lieu-même du commun. Particularité qui opère d’ailleurs tout autant sur le plateau qu’à son alentour, c’est à dire dans les modes même d’invention et de dialogue que rend possibles — encore- la création artistique, des premières pierres de l’écriture au partage avec les spectateurs.
Savoirs, savoir-faire, intuitions, affects et émotions ont ici la place de se croiser et de s’épaissir les uns les autres. C’est un savoir bien particulier que celui de la mise en scène chez Léa Drouet car il appelle l’implication responsable de chaque singularité qu’elle convoque, de la création musicale (Èlg, Yann Leguay, Jean-Philippe Gross, David Stampfli) à la scénographie (Élodie Dauguet, Gaëtan Rusquet) en passant par la dramaturgie (Camille Louis), la lumière (Gégory Rivoux, Léonard Cornevin, Mathieu Ferry), l’administration (France Morin), l’assistanat mais aussi l’implication singulière des spectateurs eux-mêmes (assis sur des praticables en archipel, déambulant dans une gare ou participant à une conversation à l’intérieur d’une cabane en construction).