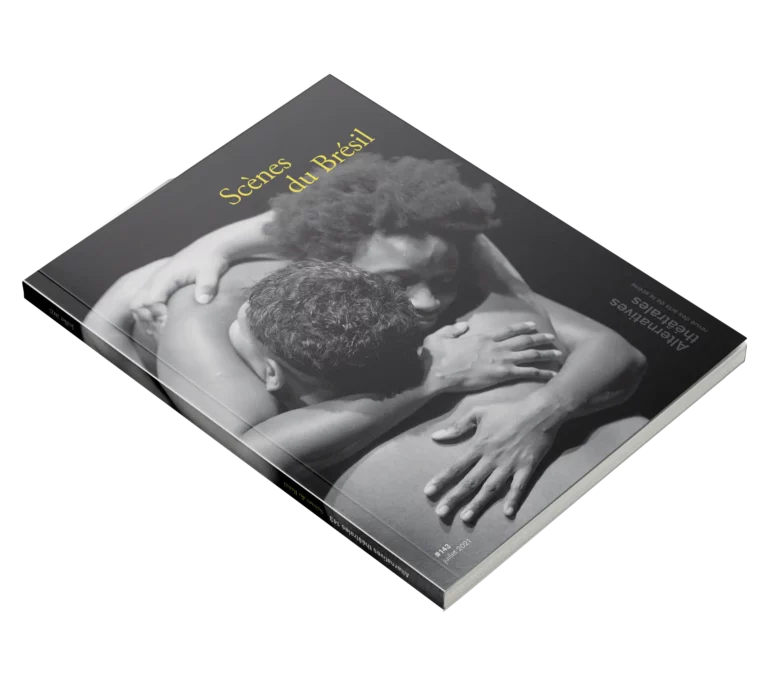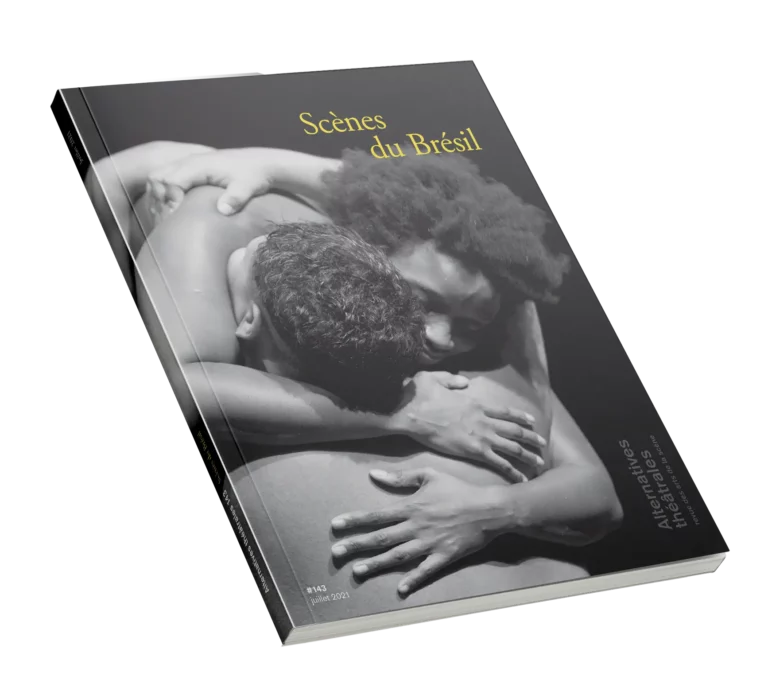Quelles sont les origines de votre intérêt pour le Brésil et ses scènes ?
BB J’écoute de la musique brésilienne depuis mon adolescence ; j’ai toujours été bercé par cette musique et cette langue, et j’ai assez vite senti que, dans ses croisements entre cultures africaine, amérindienne et européenne, il y avait au Brésil un cœur battant qui avait beaucoup de sens, tout comme dans son histoire de nombreux éléments permettent de comprendre le monde dans lequel on vit. Ensuite, progressivement, des rencontres plus précises avec certains artistes, certains films, certains livres, ont confirmé cette appétence – les spectacles sont venus après, ceux de Lia Rodrigues notamment.
J‑MG On a tous fait un peu le même parcours initiatique ; ce qui a amené le Brésil sur le continent européen, c’est vraiment la musique. Pour moi, il y a également mes origines : je suis issu d’une famille portugaise, mais qui n’a rien fait pour que j’apprenne la langue. C’est le film Orfeu negro (1959), qui m’a fasciné adolescent, qui m’a ouvert un horizon. C’était aussi l’époque où je commençais à comprendre la langue brésilienne, car je jouais de la musique avec des groupes brésiliens. Quelqu’un, aussi, a été extrêmement déterminant : Rémi Kolpa Kopoul (dit RKK), qui a fait découvrir en France la scène musicale brésilienne ; c’est par le biais de ses chroniques dans Libération que je m’y suis passionnément plongé.
Ces empreintes premières, musicales et filmiques, les avez-vous retrouvées dans les formes scéniques brésiliennes que vous programmez – le CENTQUATRE comme Passages Transfestival étant résolument transdisciplinaires ?
BB Je pense que ma plongée dans les musiques brésiliennes – dans toute leur diversité – a aussi nourri mon goût pour une telle diversité dans les spectacles. Fúria, de Lia Rodrigues, me semble assez emblématique de ça : c’est une chorégraphie qui est aussi du théâtre, de la musique, une sorte de transe incroyable qui porte complètement les corps, et ça s’achève avec de la parole. Il me semble que dans beaucoup d’œuvres brésiliennes, on ne se pose pas la question des genres comme en Europe. Les Brésiliens ont en eux des milliers de chansons qu’ils connaissent par cœur, des milliers de mouvements de danse, et il y a quelque chose d’intimement naturel dans le fait de ne pas séparer les disciplines.
José-Manuel, quels ont été les premiers spectacles brésiliens que vous avez programmés ?
J‑MG J’ai programmé beaucoup de concerts dans les années 1980 – 90. Pour ce qui est du théâtre, je pense que c’est lorsque je suis arrivé à la Ferme du Buisson, alors devenu un programmateur identifié et reconnu, que j’ai commencé à sillonner la scène brésilienne. Je n’ai d’ailleurs rien programmé pendant des années, car j’ai toujours pensé qu’il ne fallait pas programmer des artistes étrangers par exotisme ou pour « faire son malin », mais se demander ce que les inviter pouvait faire à la scène française – j’ai par exemple attendu plusieurs années après avoir vu son travail avant d’inviter Christiane Jatahy au CENTQUATRE. C’est donc il y a une vingtaine d’années que j’ai commencé à faire venir Enrique Diaz et Lia Rodrigues, que j’avais l’un et l’autre rencontrés bien avant. Je me suis dit que c’était le moment, qu’il y avait une scène importante – j’aurais aussi aimé, par exemple, faire venir le Teatro da Vertigem, mais un spectacle-parcours et in situ comme l’extraordinaire BR‑31 que j’avais vu dans la baie de Guanabara était impossible à faire venir et transposer en France. Il ne faut pas nier non plus le lien sentimental très fort que j’ai avec ce pays et ces œuvres : à un moment, une intuition faite d’éléments très concrets et de quelque chose d’incompréhensible font que vous passez à l’acte. Mais il y avait alors une convergence : énormément de chorégraphes très productifs, une scène d’arts visuels très importante.