Appelé en janvier 2020 à prendre la direction de l’Opéra national du Rhin, Alain Perroux se voit dès le mois de mars de la même année confronté aux conséquences de la fermeture des lieux de culture dans la plus grande partie des pays d’Europe pour cause de pandémie. Si la question des écosystèmes s’est imposée au monde lyrique depuis plusieurs années, il semble que la récente crise sanitaire ait incité à accélérer un certain nombre de réflexions aujourd’hui essentielles. Le point de vue de Alain Perroux quant à cette situation et aux projections qui peuvent être envisagées a été recueilli au cours d’un entretien mené en visio-conférence.
La question de l’écologie à l’opéra est-elle motivée par une demande du public ou par des impératifs budgétaires ?
L’écologie à l’opéra est une préoccupation dont se sont emparés les responsables d’institutions d’abord parce que nous avons une responsabilité sociétale. Diriger un opéra, c’est constamment penser à l’après, à l’avenir, à la manière dont on construit des choses qui prennent du sens avec le temps, on est toujours dans l’anticipation. Nous ne pouvons donc rester insensibles à la question du développement durable. D’autant que nos tutelles nous y encouragent. J’y réfléchis pour ma part depuis longtemps. La mairie de Strasbourg, écologiste depuis les dernières élections, y est évidemment attentive, de même que la région Grand Est, qui a entamé des réflexions sur la culture et l’écologie et a mis sur pied des groupes de travail avec les directeurs d’institutions culturelles dans le but de tracer des stratégies mutualisées sur les court et long termes. Les impératifs budgétaires ne jouent qu’un rôle indirect, car cette préoccupation réclame aujourd’hui certains investissements – les économies sont attendues à moyen terme. Quant au public, il vient dans les théâtres pour trouver une confrontation avec les œuvres et les artistes, des émotions, du plaisir, des débats parfois. Il ne nous demande pas de comptes (pour l’instant !), mais en revanche nous avons un devoir d’exemplarité à son égard.
La pandémie a‑t-elle rendu cette réflexion plus urgente qu’elle ne l’était ?
La pandémie perturbe les nouvelles initiatives dans ce domaine. Mais elle a aussi des effets intéressants. On s’aperçoit que l’on peut modifier nos habitudes, s’adapter. Le monde de l’opéra a d’ailleurs révélé une plasticité insoupçonnée ! On s’aperçoit en outre que l’on peut améliorer certaines pratiques grâce aux outils numériques, pratiques qui vont perdurer, car ces outils permettent des économies et nous conduisent à être plus écoresponsables. Les présentations de maquettes, par exemple, se prêtent bien aux visioconférences, car on y rassemble beaucoup de monde (chefs de service, artistes internationaux) sans avoir plus besoin de faire venir toute une équipe extérieure en avion. La question des voyages se pose lorsqu’il s’agit de rencontrer des artistes, de se rendre à des séances de travail ou de participer à des congrès.
Faut-il être radical et arrêter d’engager des artistes internationaux ?
Un opéra doit travailler avec son écosystème, mais il ne serait pas juste de rejeter en bloc tout ce que la mondialisation nous a apporté. La richesse d’un opéra dans une ville comme Strasbourg, c’est aussi de refléter l’immense diversité des artistes sur le plan européen et mondial. Toutefois, dans la préparation, on peut rationnaliser les choses, éviter certains voyages, privilégier le train par rapport à l’avion. Certains artistes se posent même la question de réaliser des spectacles zéro carbone – la metteuse en scène Katie Mitchell notamment. Ce sont des expériences intéressantes, mais je ne pense pas qu’on puisse les généraliser. En définitive, notre métier reste le spectacle vivant et en aucun cas le numérique ne peut être considéré comme la seule planche de salut. Le numérique en tant qu’outil de préparation, de maintien du lien avec le public, est un soutien, un prolongement. Et c’est aussi un outil créatif enrichissant certains spectacles. Mais il ne peut se substituer à notre cœur de mission, qui est aux antipodes du numérique, ce qu’Olivier Py appelle la « présence réelle » des artistes dans un espace partagé avec des spectateurs.
Le retour au système des troupes est-il une solution ?
Une troupe d’opéra permet d’éviter les voyages et les séjours à l’hôtel. Mais elle ne peut fonctionner que dans des théâtres de répertoire ou de semi-répertoire. Or ce système n’a de sens que lorsqu’on peut jouer beaucoup, sur une longue durée, donc dans des villes qui ont un réservoir de public suffisamment grand. En France, le système de troupe serait transposable à l’Opéra national de Paris, qui a toutefois besoin de « stars », lesquelles n’ont aucun intérêt à être en troupe. À Strasbourg, nous n’avons pas de troupe, mais nous recourons aux jeunes chanteurs de l’Opéra Studio et à certains artistes du chœur pour des rôles secondaires. Ils habitent dans la région, donc nous évitons ainsi un certain nombre de voyages et de frais.

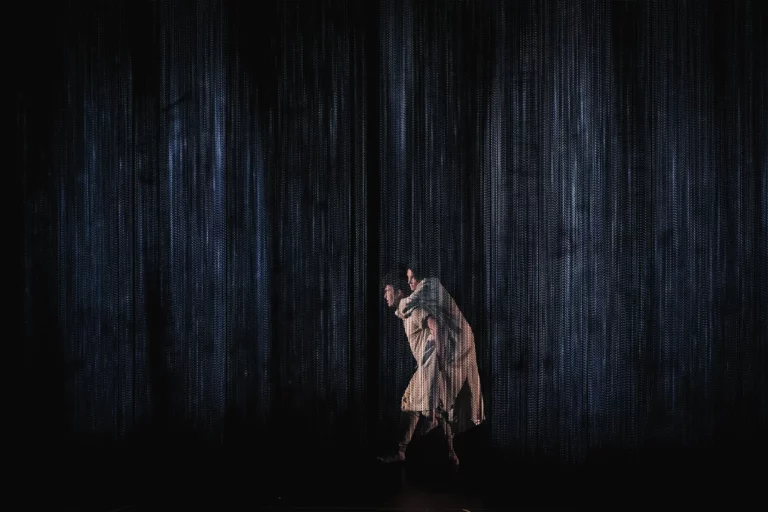



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

