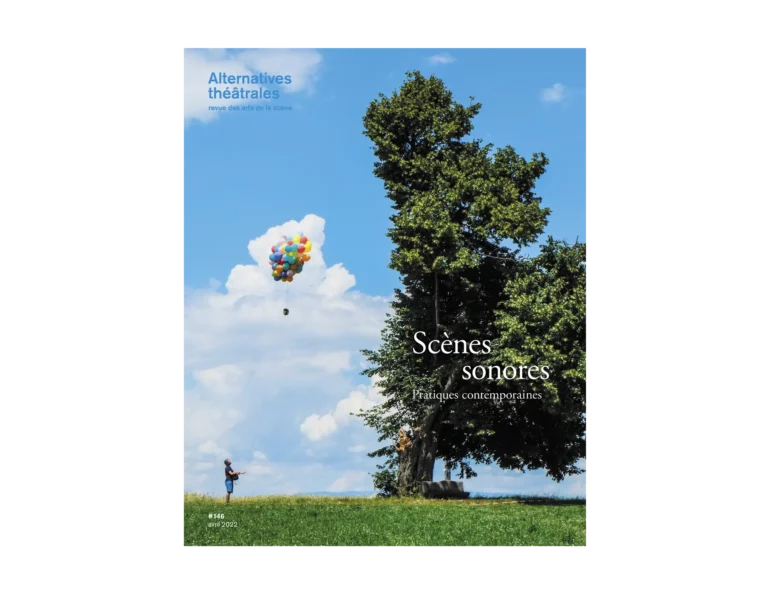En 2016, Claude Régy crée ce qui sera son dernier spectacle, Rêve et folie, à partir d’un texte de Georg Trakl. Sur scène, un seul interprète : Yann Boudaud.
Au cours du travail de Rêve et folie, tu as expérimenté un exercice un peu singulier que tu désignes comme une expérience de « visualisation sonorisée », tu peux en dire quelques mots ?
Oui. Tout d’abord il faut dire que pour Rêve et folie le son a eu une place importante. Il existait presque continûment à l’exception de quelques moments de silence. La structure sonore que Philippe [Cachia] a créé est restée inchangée pendant toute l’existence de ce spectacle à l’exception notable d’une marge d’improvisation qui se traduisait à chaque représentation par des variations de volume, de rythme ou par une redistribution de certains sons au sein de la structure, selon ce que Philippe percevait et ressentait de ce que je produisais sur le plateau avec le texte de Trakl. Car outre le fait que Philippe soit un créateur sonore extraordinaire, c’est lui – et c’est suffisamment rare pour le souligner– qui était là tous les soirs pour procéder à la conduite sonore de Rêve et Folie.
Pour ce spectacle-là j’ai éprouvé le besoin de travailler avec Philippe d’une manière que je n’avais encore jamais expérimentée : chaque jour, dans le cadre de ma préparation d’avant- représentation nous passions une heure ensemble, lui et moi. Dans les lumières de service, je m’asseyais dans le gradin avec le texte de Trakl et mes cahiers de notes en regardant le plateau et il me repassait la conduite sonore intégralement ou en version courte, cela dépendait des soirs.
J’écoutais la bande-son tout en relisant le texte et en regardant le plateau, alternativement.
De cette façon, je « revoyais » mon parcours de la veille de manière fictive, imaginaire.
Ce travail de visualisation, je précise, était un travail de visualisation sensible : ce n’était pas qu’une simple visualisation technique. Je ré-éprouvais physiquement et psychiquement (en me voyant imaginairement sur le plateau) absolument toutes les perceptions qui avaient sous-tendu le travail de la veille. Je ré-éprouvais ainsi l’ensemble de la structure motrice et perceptive qui constituait l’armature du spectacle. Structure quasi-immuable car très opérante et qui s’était cherchée puis testée et confirmée répétition après répétition jusqu’à sa forme finale.
Très curieusement cette visualisation me permettait aussi de ressentir de nouvelles sensations, de nouvelles intuitions, de les noter par écrit et de me dire : « J’aimerais bien essayer ce soir telle nouvelle sensation sur telle ou telle séquence ou conduire autrement tel ou tel mouvement pour voir si c’est juste et ce que cela produit ». Ces nouveautés ouvraient de nouvelles possibilités d’improvisation.
C’était vraiment un travail de dédoublement et de visualisation de mon corps dans l’espace avec le son pour fil conducteur. Cela me permet- tait de mieux « voir » et de ré-éprouver l’ensemble du spectacle puisque je connaissais la double chronologie jeu/son. Comme si d’une certaine façon je rejouais tout en étant dans le gradin.
Par moments je m’y déplaçais tout en continuant d’écouter, pour changer de point de vue. Pour me voir imaginairement sur le plateau sous différents angles. J’allais même parfois derrière le plateau pour me voir de dos. Je demandais à Philippe de repasser plusieurs fois certaines séquences sonores pour « me revoir encore », pour bien comprendre à nouveau ce que je ressentais en me voyant faire et ce que je pouvais éventuellement améliorer ou effectuer encore plus précisément.
Autre curiosité, cet exercice de re-visuali- sation sonore me permettait également de me remémorer avec précision ce qui m’avait semblé dysfonctionner dans la représentation de la veille ou ce qui au contraire avait produit quelque chose de valable.
- Création janvier 1998 à La Colline, Paris. ↩︎