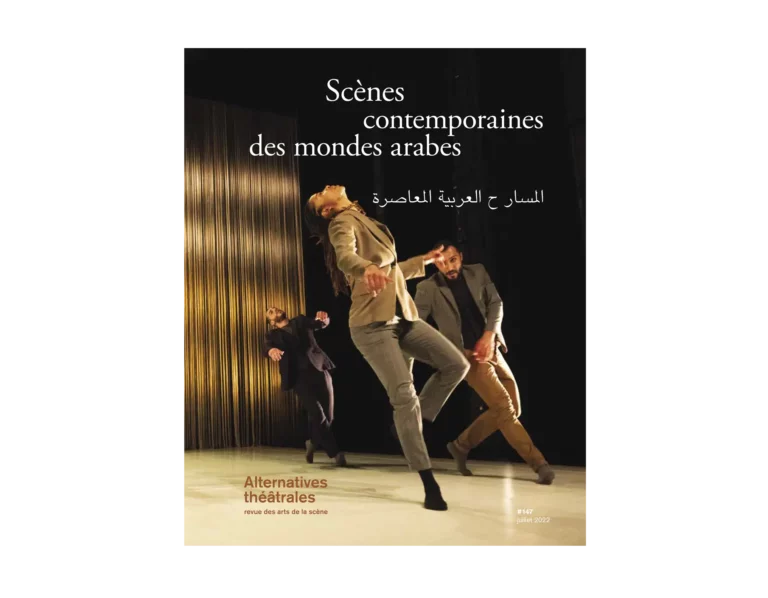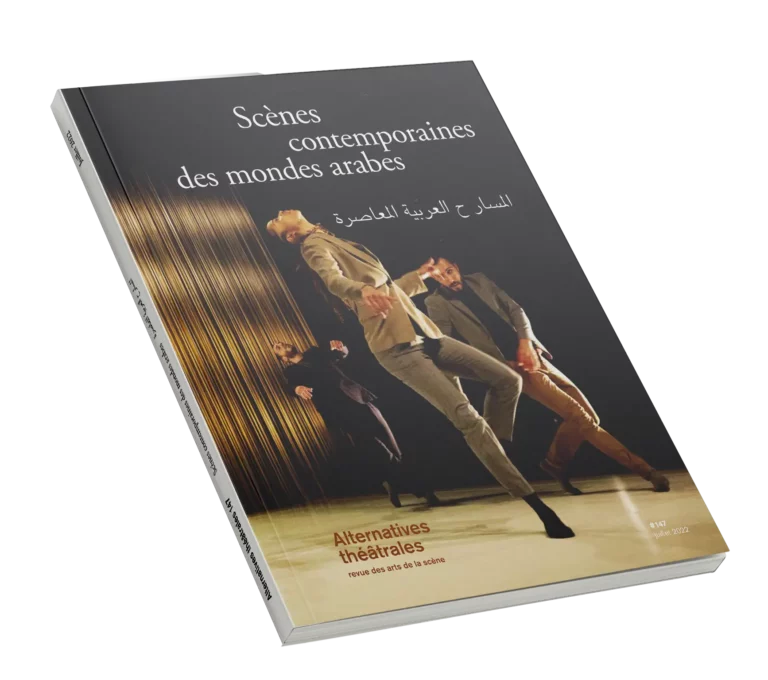Accoster sur les rivages sud de la Méditerranée pour un numéro d’Alternatives théâtrales est une entreprise aussi complexe que passionnante. Passionnante, car les esthétiques et les propos des arts spectaculaires des scènes arabes sont d’une diversité et d’une créativité folles. Complexe, car très vite se pose la question des « scènes des mondes arabes ». L’expression « monde arabe » est le plus souvent employée au singulier et en terme géographique pour désigner un ensemble de pays couvrant la péninsule arabique, l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. D’autres critères, linguistiques mais aussi culturels peuvent être pris en compte pour le définir. Ainsi, selon l’Institut du monde arabe, il s’agit d’un espace où « on parle majoritairement arabe, et (où) les peuples partagent une culture commune, fondée sur la langue, l’alimentation méditerranéenne, et la prégnance de la religion musulmane1 ». Les bornes sont donc mouvantes. C’est l’une des raisons pour lesquelles ici, pour aborder les pratiques spectaculaires contemporaines de certains de ces pays profondément différents les uns des autres, nous avons choisi, à l’instar de Didier Billion (Géopolitiques des mondes arabes, 2018) l’emploi du pluriel. Ce sont des « mondes arabes » et de leurs diasporas qu’il est question dans ce numéro. Car il nous faut rassembler, pour les écouter, les histoires que les pays de l’autre côté de la mer nous apportent, et cela sous un titre, si imparfait soit-il. C’est d’autant plus nécessaire que les extrêmes de tous bords et le manichéisme occupent des places de plus en plus encombrantes dans nos existences. Il faut d’abord tordre le cou à quelques idées reçues qui voudraient que le théâtre n’existe pas dans les pays arabes. C’est faux, et l’on découvrira très vite, en s’éloignant un instant d’une vision ethnocentriste, que diverses formes spectaculaires (comme la halqa ou le théâtre d’ombres) existaient depuis des siècles dans les pays arabes, lorsqu’y survient, au xixe siècle, le théâtre sous sa forme occidentale.
Hélas, nous n’avons bien souvent que quelques échos des pratiques spectaculaires des pays arabes, et les spectacles que l’on voit en Europe sont souvent conditionnés par les actualités des pays dont elles sont issues. Le théâtre contemporain des pays arabes est déterminé, dans sa pratique comme dans son économie, par les problématiques sociales et géopolitiques des pays dans lesquels il est joué ou dont il s’exile. On le verra notamment à travers les analyses consacrées au théâtre syrien, palestinien et égyptien, mais cette situation n’est pourtant pas exclusive. Les arts du spectacle des pays arabes ne sont pas que deuil, guerre et exil. Et bon nombre de ses artistes, y compris parmi ceux qui abordent ces thématiques, ne veulent pas que leurs créations soient cantonnées à ces problématiques. Ni être programmés en Europe exclusivement lorsque leurs pays vivent des tragédies, comme ce fut le cas, ces dix dernières années pour les artistes syriens. Sans prétendre à une exhaustivité aussi illusoire que prétentieuse, ce numéro veut être une porte ouverte : une immersion historique dans l’évolution des formes spectaculaires de certains pays du monde arabe et, dans un second temps, un reflet, subjectif et passionné, de leur vitalité, à travers des exemples d’artistes et de spectacles emblématiques, qu’ils circulent ou non dans le reste du monde.
Mais qui peut en parler ? Sans tomber dans les dérives dangereuses et les méandres vaseux de la notion « d’appropriation culturelle », le risque d’un orientalisme, au mieux naïf, est toujours présent. Ainsi, dans le but de nous éloigner d’un « Orient créé par l’Occident » (Edward Saïd, 1978), les analyses portant sur les arts du spectacle ont été proposées à des chercheurs issus des lieux dont ils parlent. Les rares fois où ce n’est pas le cas, ils y ont un attachement profond, en parlent et lisent la langue. C’est aussi, grâce à la générosité de quelques confrères arabophones que nous remercions, la possibilité de lire certaines plumes actives et reconnues dans leurs pays, mais rarement publiées en français.
La mondialisation ne devrait pas être unilatérale et meublée de stéréotypes. L’Occident a beaucoup à apprendre de l’Orient. En outre, ces spectacles naissent aussi parfois « chez nous », de l’autre côté de la Méditerranée qui est aussi chez eux. Et nous parlent d’un Orient, historiquement et géopolitiquement très proche, grâce aux artistes issus de ces pays ou de leur diaspora.
Ainsi, notamment, la complexe question des origines est posée à plusieurs reprises dans ce numéro. Le plus souvent par des artistes européens, et issus de pays qui furent des colonies françaises. Le passé est brûlant, souvent douloureux et méconnu. Et c’est la famille qui revient sans cesse. La fiction, la psychanalyse et les rêves sont les moyens de déterrer les fantômes familiaux pour ne plus en avoir peur chez Myriam Saduis. Wajdi Mouawad, sous les plumes d’Emmanuelle Favier et de Georges Banu, nous parle de la sienne et de l’exil jusque dans Mère, sa dernière et bouleversante création. Le chorégraphe libanais Ali Chahrour tisse mémoire familiale et histoire collective à travers un hommage à sa mère et ses tantes. Tamara Al Saadi dédie un chant d’amour à ses aïeules irakiennes dans Istiqlal (Indépendance). Quant à Hanane Hajj Ali, elle s’empare de Médée pour interpréter des mères, libanaises, poussées au pire par une société qui les a abandonnées. On pourrait s’étonner d’une telle prégnance de la famille. Peut-être dit-elle que ces artistes, en créant à partir de ce qu’ils ont de plus cher, et de ce que nous avons tous en commun, cherchent à rendre possible l’altérité et à établir des ponts entre les deux rives. Puissent ces familles de personnages exaltants et empreints de sincérité nous toucher et nous relier.