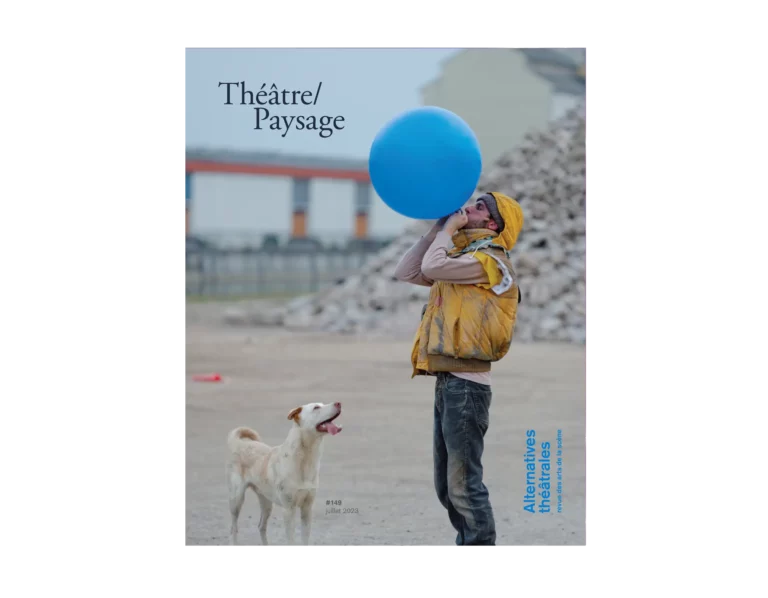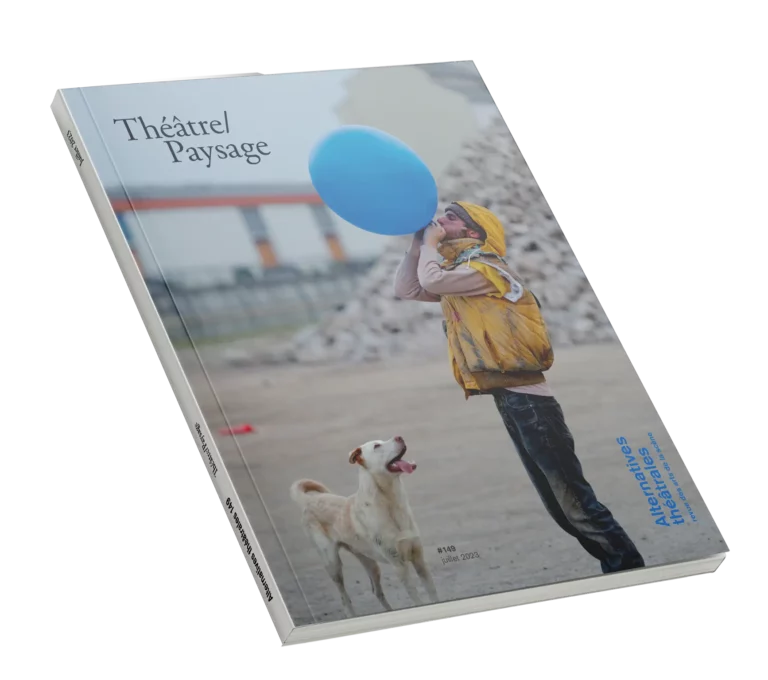MOUTON collectif se forme au Théâtre de la Toison d’Or. Après plusieurs cartes blanches, iels quittent ce haut lieu du rire bruxellois et commencent une transhumance joyeuse, de maisons de vacances en fermes et châteaux ; cela donne naissance à leur première création extra-muros, dans les Ardennes : Partouze Pastorale. Empreint·e·s de cette première expérience réussie, et la covid-19 ayant fermé l’accès aux salles de spectacles, le collectif rêve à une nouvelle création située. Iels entament un processus réflectif sous la forme de « jachères ». « Jachère 1, 2, 3… » rythment les échappées de ces petits moutons et leur permettent de se ressourcer loin des restrictions. C’est décidé, iels veulent créer uniquement en extérieur et sortir des institutions. Dans l’esprit d’une nouvelle Dogma 95, un premier principe naît et crée le fondement de leur identité artistique : leurs jachères se déroulent toujours dans des lieux et des localités différentes, des tiers-lieux où d’autres personnes ont choisi de s’installer pour y construire des vies collectives, avec une note d’utopie. Ces rencontres résonneront d’ailleurs dans leur écriture, sous forme d’hommage, de clin d’œil. Mais c’est finalement une « jachère sanitaire » – la seule jachère réalisée entièrement sur zoom – qui impulse concrètement une nouvelle création.
L’élément déclencheur est une visite guidée virtuelle d’un des membres du collectif, qui réside à ce moment-là dans un château du sud-ouest de la France ; un peu à la manière de la voix off dans L’Année dernière à Marienbad, sa description du parc, du four à pain, de la tapisserie de sa chambre aux motifs de bateau fait rêver le reste de l’équipe ; le processus inspirationnel s’enclenche et le nouvel opus voit le jour quelques mois plus tard, dans ce même château, avec tout le reste de l’équipe et quelques artistes invité·es1.
Voici l’histoire de Château-Bateau. Une « épopée métaphysique en prairie », ou l’histoire de Roberta qui décide de quitter un lieu-dit, le Château (à jardin), une grande muraille faite de carton d’emballage de pare-brise, peuplé par une communauté inventée, toustes fans d’une émission radio qui passe en boucle. Roberta s’enfuit, pour s’extirper de cette société et cherche un sens nouveau à sa vie, après un prologue prophétique sur la fin du monde, scandé par une pythie locale ; elle traverse l’existence en solitaire, sur la Mer (au centre) en bateau-jupe ; elle navigue dans l’horizon de la prairie, sous le soleil de la golden hour ; cette échappée belle permet au public de découvrir l’île de Pastorale (à cour) où une bergère et ses moutons animent une émission radio philosophico-poétique, dans un studio insulaire, avec comme background une toile peinte : un ciel bleu, des nuages épars, irréels. « Cette Pastorale n’est peut-être qu’un rêve. C’est en tout cas un lieu qui représente l’utopie. C’est peut-être pour cela que c’est le lieu du paysage peint, du paysage rêvé, du paysage décrit, plutôt que du paysage réel. » L’ivresse philosophique du studio radio élargit d’ailleurs la question du paysage. L’animatrice dit : « Est-ce que je fais partie du paysage ? lequel ? Est-ce que mon humeur, ma joie, ma tristesse modifient le paysage ou au contraire sont-elles modifiées par le paysage ? Est ce qu’on peut habiter un paysage ? » Le « paysage spectacle » laisse place au paysage émotionnel des personnages ; un trop plein introspectif pour Roberta qui décidera de retourner à sa vie initiale.

Château-Bateau s’est joué dans cinq prairies différentes et une nouvelle version est prévue prochainement dans un bois avoisinant Bruxelles. « Le paysage a une super puissance scénographique » confirme le collectif. « On parle souvent du paysage en tant qu’image, mais on pourrait aussi parler du fait d’être dans un paysage ensemble avec le public, le temps du spectacle, assis·e·s sur des couvertures dans l’herbe, les sons des oiseaux, les odeurs, les insectes, la chaleur de l’été, la nuit qui tombe. » Une « fiche technique prairie » est en cours d’écriture, car trouver la bonne prairie n’est pas mince affaire : « nous avons besoin d’un grand espace pour apparaître et disparaître au loin, pour y jouer les voyages sur la mer, les courses poursuites, les naufrages, […] se cacher, faire des entrées et sorties surprenantes. Bosquets d’arbres, haies et buissons sont nos coulisses naturelles. Nous cherchons aussi une prairie qui nous donne une impression d’immensité, où il y a une beauté, un « effet paysage » ». Et il y a la question de la saison (été uniquement) et de l’heure de présentation (« juste après l’heure dorée, quand le soleil est au crépuscule, avant qu’il fasse nuit, c’est ça notre création lumière »). La dramaturgie sonore accentue l’expérience sensorielle de ce récit : l’émission radio live qui « masse auditivement les spectateurices » et guide, « comme une méditation », le personnage de Roberta ; des sons augmentés de nature, océan et île grâce à l’amplification de bruits d’animaux (oiseaux, lamantins et moutons) qui propose un jeu de contrastes entre acoustique artificielle et naturelle ; une expérience phonique qui cristallise singulièrement cette épopée dans l’oreille du public. Le collectif a désormais envie de fonder leur propre paysage, en trouvant un lieu fixe, loin de l’urbain évidemment.
- Mariya Kekilikova et Christophe Armand pour le son. ↩︎