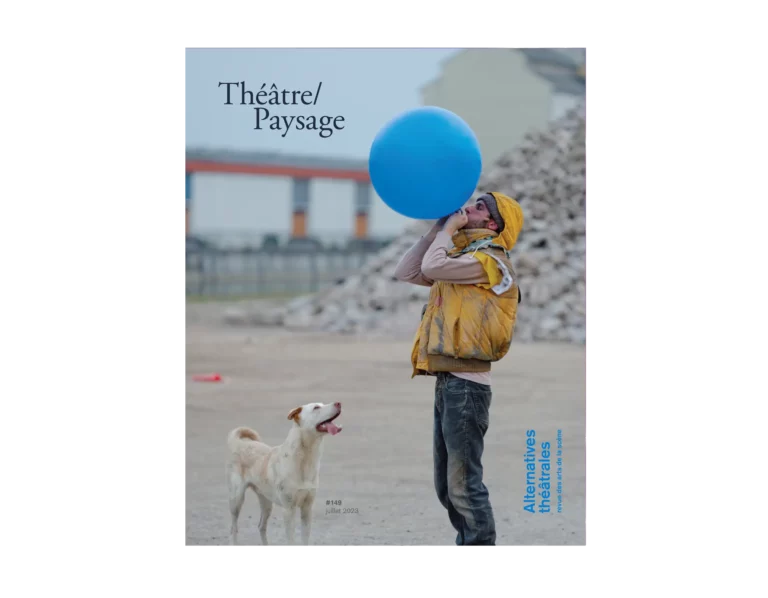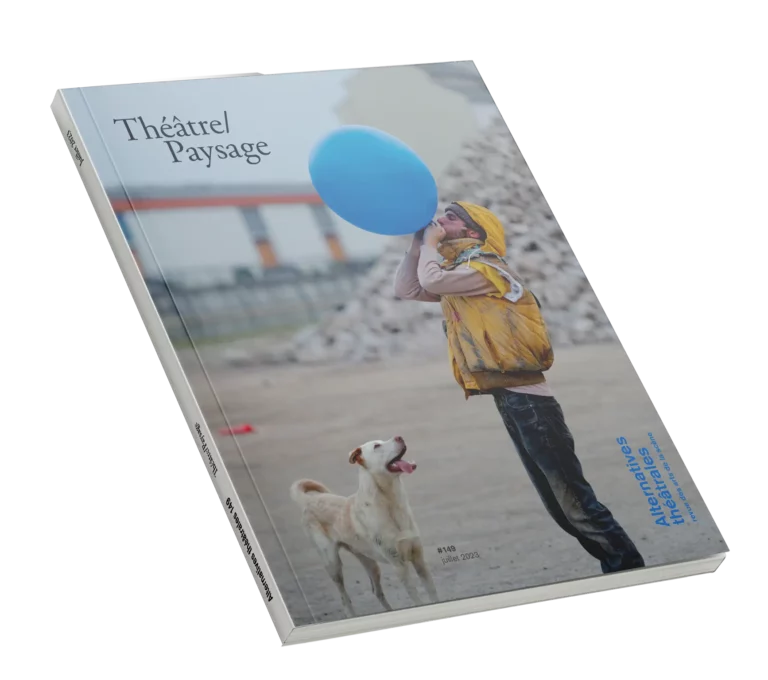Depuis le début de notre travail, nous questionnons le paysage, le rapport que l’humanité entretient avec lui, pour ainsi développer et créer une triangulation entre paysage, cirque et musique.

Travailler sur le concept de paysage soulève souvent des réflexions dichotomiques. Quand nous évoquons la notion de paysage, la première pensée qui nous anime est un tableau d’une nature, belle, flamboyante, lumineuse, prospère. Une nature « naturelle » et prolifique. Or, quand nous travaillons cette notion, nous sommes confrontés à ce que la terre subit : dégradation, domination, appauvrissement des sols, cultures intensives, bétonisation… La terre est vue comme une source de production qu’il faut soumettre aux lois des Hommes. Productions intensives de céréales et de viandes, traitement de la terre par les pesticides, emploi de produits phytosanitaires, accaparement des réserves d’eau, tout cela, nous le savons déjà, affaiblit et rend stériles les sols. Pourquoi ce paradoxe si grand entre la pensée du paysage et le rapport que nous entretenons avec lui ?
Rappelons que le paysage est un concept apparu en Europe au xvie siècle par l’art pictural. En peignant la nature, l’homme crée la notion de paysage dans un rapport sujet-objet. En objectivant le paysage, il s’en extrait. Il est donc en dehors de lui, en dehors de la nature, en dehors de ce qui l’entoure. Cet état de supériorité provoque conquêtes, colonisations, propriétés, territoires… La terre devient un dessin que l’on divise. Elle devient abstraite.
Pouvons-nous penser le paysage autrement ? Et si oui, comment ?
Pour chaque création de spectacle, nous avons un même processus : nous marchons. C’est un terrain de recherche essentiel pour chacune de nos œuvres puisqu’il nous semble être le meilleur moyen de nous connecter au plus près du paysage. La marche nous ancre dans le monde. Elle permet à la fois de nous recentrer, de ressentir notre corps, ce qu’il s’y passe, d’activer notre pensée, et de nous englober dans l’environnement dans lequel nous sommes. En plus de cela, elle nous connecte aux autres. C’est aussi une façon de parler la même langue, de faire commun, avec les personnes que nous choisissons pour nos créations, qui viennent d’horizons ou de techniques différents. Issues du travail de la chorégraphe Christine Quoiraud, et du Body Weather Laboratory de Min Tanaka, danseur et chorégraphe japonais, nous développons ce que nous nommons des marches chorégraphiques. Comme nous aimons donner du sens à ces marches, elles sont expérimentées de manières différentes sur chaque projet, même si le cadre est, lui, identique. Nous essayons de les éprouver dans des temps différents : pour Landscape(s)#1, nous marchions à chaque résidence tous les matins d’une à deux heures, pour Lieux dits, nous avions proposé à notre équipe une semaine d’immersion où nous marchions toute la journée sur l’île d’Ouessant. Pour Solitude·s ce fut aussi une immersion dans une forêt suisse pendant une semaine. Pour Women weave the land nous avons repris des marches régulières lors des résidences, en ajoutant une marche par mois faite à distance, dans le lieu où chacune se trouvait alors. Nous avions ainsi un rendez-vous mensuel où nous savions que nous marchions, séparément, mais ensemble. L’idée était de garder une trace par écrit de nos ressentis, de nos sensations, que nous nous envoyions pour créer ainsi une correspondance entre nous tou·te·s, un fil. Le cadre de ces marches chorégraphiques reste inchangé : à chaque début de marche, une consigne spatiale, temporelle et corporelle est donnée. Par exemple, si nous marchons de 9h à 11h, la consigne pourrait être la suivante : à 10h15, allongez-vous sur le dos, là où vous êtes, la tête au Nord, les pieds au Sud, et retournez-vous en 15 minutes. Les consignes varient en fonction du projet et de la finalité voulue.
Ces marches nous permettent d’avoir un vocabulaire commun, entre interprètes, metteuse en scène, musicien·nes, scénographes, pour avancer dans l’écriture de nos spectacles. À la fin de chaque marche, nous échangeons, soit par écrit, soit par oral, sur la marche que nous venons de vivre, la consigne collective, sur nos ressentis, émotions qui nous ont traversé·e·s, sur ce que nous avons vu aussi, qui nous avons croisé… L’expérience ainsi racontée permet à Marion de fabriquer une collecte de sensations communes, qu’elle écrit dans un carnet. Elle va ensuite se servir de ces mots comme cadre d’improvisation ou d’écriture. Pour Landscape(s)#1, nous avons ainsi construit une séquence sur le sentiment de plénitude que nous traversons régulièrement en marchant, lorsque nous sommes face à un point de vue puissant qui nous submerge. Comment le retranscrire sur l’agrès ? Dans le corps ? Cela a permis aux interprètes d’écrire efficacement à partir d’un sentiment vécu communément et de cette façon le dialogue entre mise en scène et interprétation est renforcé. Ainsi, nos marches agissent concrètement sur le plateau
Nous pouvons dire aujourd’hui que notre expérience autour du paysage est plurielle. Chacune de nos pièces est venue questionner nos liens au paysage. Ce travail au long court de réflexion nous amène à nous inclure dans la notion même de paysage. Chez certains peuples racines, comme les Maya Lacandon ou les Maasaï, le mot « paysage » n’existe pas, tout comme le mot « nature ». Dans leur façon de penser le monde, il est pour iels absurde de s’exclure, se différencier volontairement du paysage. Iels disent qu’iels sont tout à la fois la montagne, la rivière, le chemin et l’oiseau. Au fil de nos expériences nous faisons d’une certaine façon ce même constat, « nous sommes paysage ». Ce changement cosmologique est pour nous une continuité et ouvre d’autres horizons. Nous déroulons artistiquement une pensée qui mute au fil de nos marches et c’est passionnant.