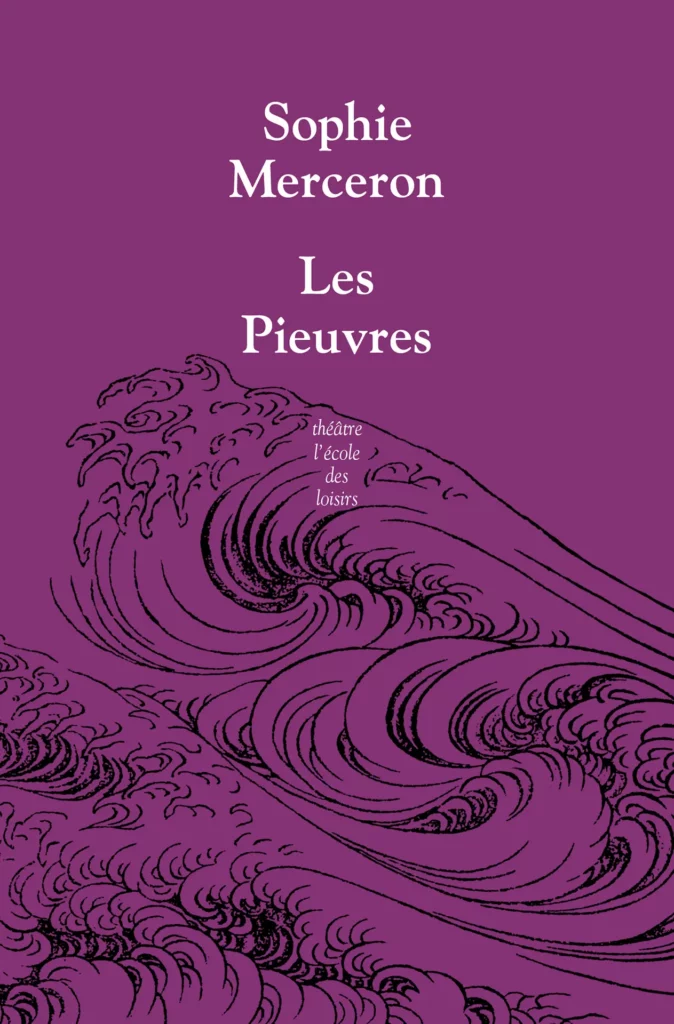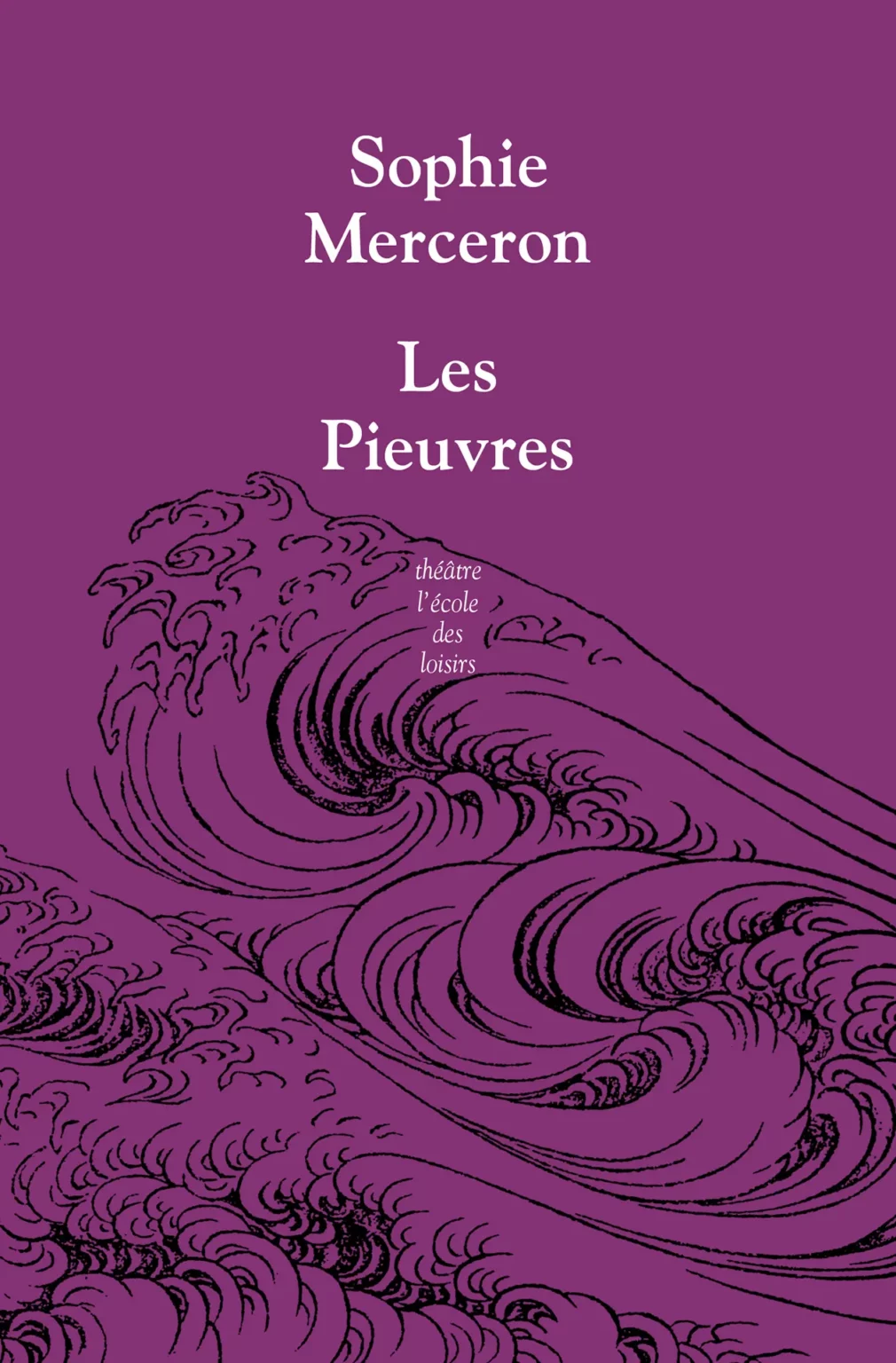Le théâtre pour la jeunesse s’est développé dans l’espace francophone depuis les années 1990. Il propose des productions souvent engagées, dénonçant des problématiques sociopolitiques dans le dessein de sensibiliser et de conscientiser son jeune destinataire sur l’état du monde contemporain. Depuis une dizaine d’années, de récentes thématiques engagées au sein de ce répertoire traitent de l’écologie et plus exactement du désordre climatique. Tout en proposant un discours sur un problème social et sociétal d’envergure, ces textes permettent d’interroger la construction identitaire du personnage et par extension du jeune destinataire. Ainsi, lorsque le dérèglement climatique est abordé, il est souvent associé au bouleversement individuel. Dans les quelques pièces de théâtre que nous nous proposons d’aborder ici, il s’agit en outre d’appréhender en quoi les catastrophes naturelles rapportées peuvent métaphoriser l’état intérieur de personnages qui connaissent eux-mêmes des bouleversements dans leur développement personnel et doivent surmonter des chocs liés à l’existence.
À titre d’exemples, le texte Fiesta de Gwendoline Soublin (Espaces 34, 2021), sur fond d’actualité lors de sa publication, est en lien avec le confinement associé à la crise sanitaire du Covid. Il raconte comment des enfants parviennent à déjouer la solitude provoquée par l’isolement et à s’unir pour célébrer la vie et le collectif. Ils résistent ainsi à la tentation de céder à la peur et à l’individualisme, et ce, malgré une tempête dévastatrice qui retient chacun prisonnier. L’écriture associe récit choral – au passé et au présent – et dialogues. Elle invite à la mise en voix pour identifier l’énonciation et lever les difficultés de compréhension liées à la polyphonie informationnelle, tout en rendant sensible l’imbrication du collectif et de l’individuel. Tandis que la tempête « Marie-Thérèse » sévit et contraint la population à s’isoler sur injonction gouvernementale, les enfants d’un même immeuble s’organisent pour résister au climat anxiogène généré par la catastrophe. Pour eux, la résistance se matérialise dans la communication archaïque qu’ils entretiennent, tant bien que mal, par envoi de messages, des « boulettes de papier » jetées au gré du vent par les fenêtres de leur habitat. Par la suite, ils se décident à braver l’ultime interdit pour se retrouver physiquement dans une cave, motivés par le fait de célébrer l’anniversaire de leur ami Nono. C’est une exaltation du vivre, ainsi exhibée par ces enfants terrés dans cette cave qui hurlent les choses joyeuses de l’existence. À la fin de la pièce, au moyen d’une prolepse, le destinataire1 découvre les personnages d’enfants devenus adultes qui reviennent sur cette expérience de confinement, et il apprend par là même que Nono avait une maladie qui lui « rongeait le cerveau ». Décédé à l’âge de 11 ans, son dernier anniversaire dans cette cave aura été le plus réussi et le plus joyeux. Nono avait « une tempête dans la tête », un chaos intérieur, matérialisé dans la fiction par la tempête Marie-Thérèse, qui, invitant au courage, faisait des pieds de nez à la maladie. Le discours sur la maladie infantile qui s’insinue dans un second temps propose de continuer à célébrer la vie en dépit de la catastrophe – nécessairement polysémique dans le texte. En se rassemblant, en s’unissant, c’est dans le collectif que l’individu semble pouvoir trouver la force de surmonter les problématiques liées à l’intime, quand bien même l’issue est inexorable.
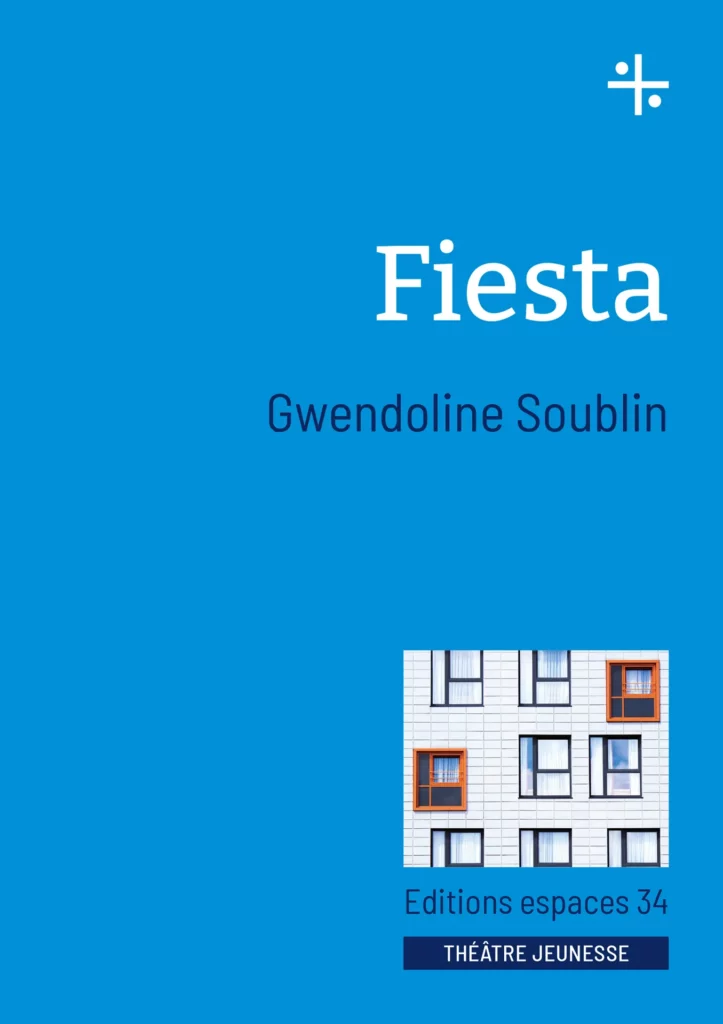
Dans Les Pieuvres (L’École des loisirs, 2021), Sophie Merceron présente le quotidien d’enfants évoluant en centre spécialisé du fait de leurs névroses obsessionnelles, phobies et chocs post-traumatiques. À cette première intrigue, relative aux angoisses juvéniles, se greffe une seconde intrigue, concernant le désordre climatique. La construction particulière de la dramaturgie propose un découpage en deux parties qui invitent à questionner les liens entre réalité et imaginaire, interrogeant le rapport à la théâtralité. Dans cette pièce, trois adolescents se trouvent confrontés à l’imminence d’un cyclone et à l’impératif de devoir survivre. Révélant un environnement hostile et brutal, la nature s’incruste dans le quotidien des personnages d’adolescents qui menaient une vie proche de l’ordinaire dans leur IME (institut médico-éducatif), et prend le pouvoir à l’image de leurs propres angoisses intérieures. Pour ces personnages, il s’agit alors de résister et d’apprendre à dépasser les heurts et cataclysmes de l’existence. En outre, ils connaissent une émancipation au moyen d’un ensauvagement : ils se mettent à rugir tels des animaux et engagent un retour aux sources en communiant parfaitement avec la nature, et parvenant à la dompter. Mais c’est grâce à leur communication sur leurs troubles respectifs et la mise en mots de leurs situations douloureuses que les personnages parviennent à avancer. Tel un récit initiatique, Les Pieuvres met en perspective la libération et l’émancipation par le langage, lequel agit tel un exutoire : lorsqu’il s’agit de s’ouvrir, à soi et aux autres, il devient possible d’affronter et de dépasser, voire de domestiquer, ses propres peurs et angoisses. Cette émancipation juvénile donne ainsi forme et naissance à une communauté.
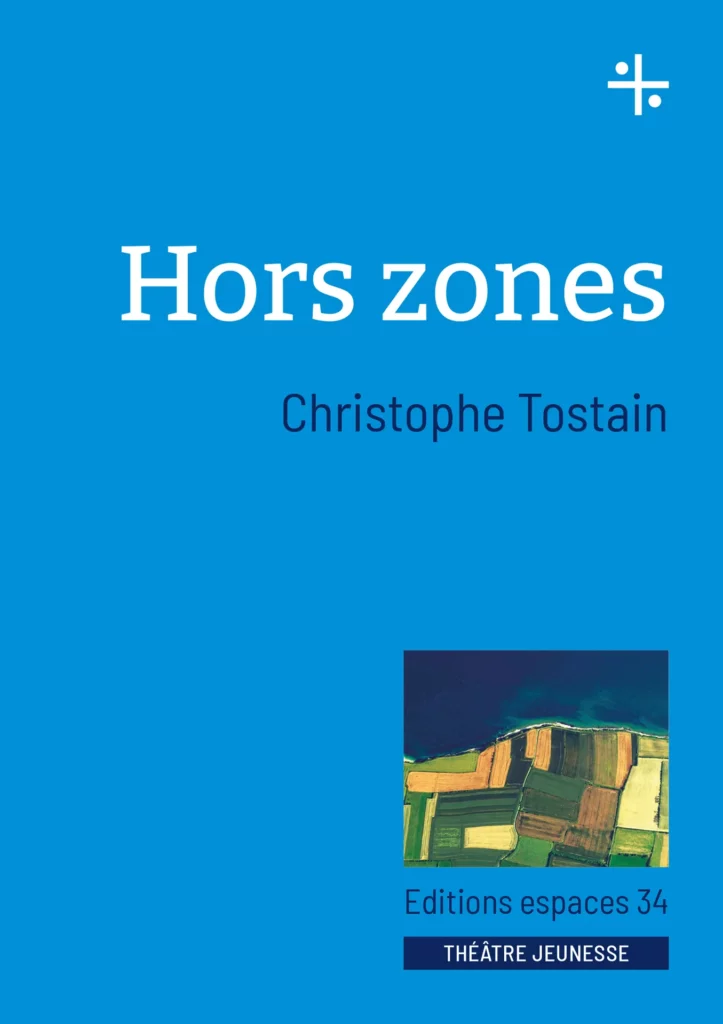
Enfin, la pièce de théâtre Hors zone (Espaces 34, 2021) de Christophe Tostain aborde quant à elle l’enfance en déshérence en présentant une fratrie de trois enfants et adolescents, livrés à eux-mêmes, devant trouver un chemin pour s’en sortir. Dans un paysage dévasté et cataclysmique, l’errance se révèle formatrice et initiatique là encore. Dans cette pièce de théâtre, comme dans notre réalité actuelle, les catastrophes climatiques que sont les tremblements de terre, les tsunamis et effondrements de montagnes, sont autant d’épreuves et de difficultés à outrepasser pour continuer à avancer dans un paysage de désolation. Compte tenu de l’hostilité de l’environnement, l’errance et les pérégrinations enfantines deviennent le moyen de se remémorer le passé pour les personnages : « les bonnes choses, le sourire de maman, les yeux de papa, le sable dans le jardin ». Les personnages sont dans un vide transitoire, un entre-deux à la fois évoquant un « avant », le passé, et souhaitant un « après », l’avenir, avec la conviction partagée que le changement qu’ils expérimentent – matérialisé par le bouleversement environnemental dans la fiction – n’est que transitoire. C’est la force de croire et de rêver malgré la dureté de la situation qui permet aux personnages de s’en sortir. Pour cela, ils imaginent une réalité autre et accessible, contrant de la sorte le désenchantement du monde.