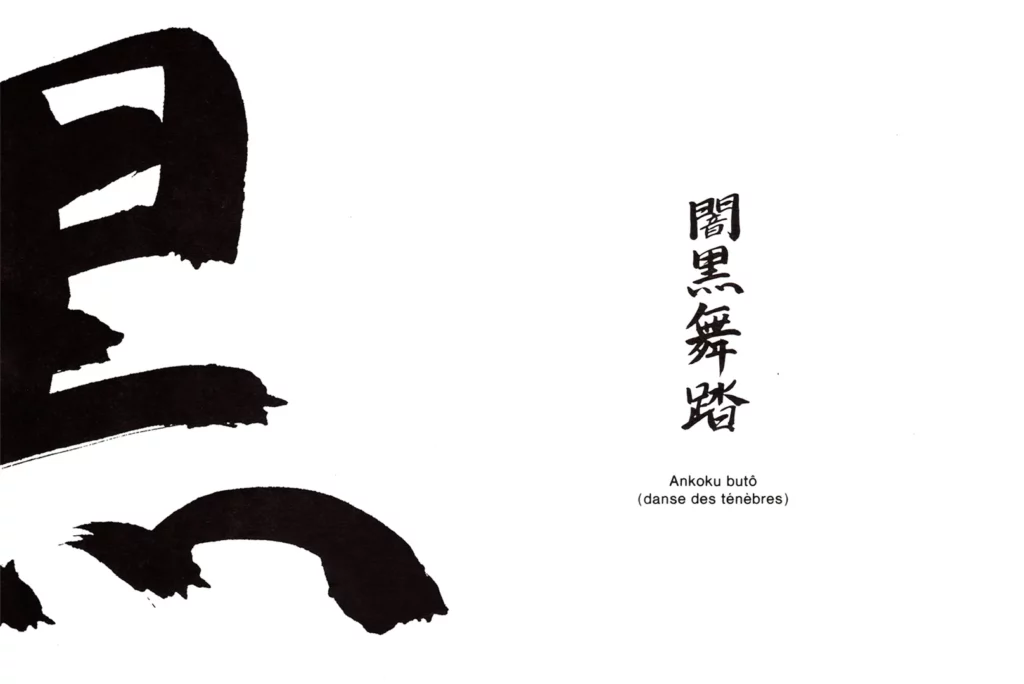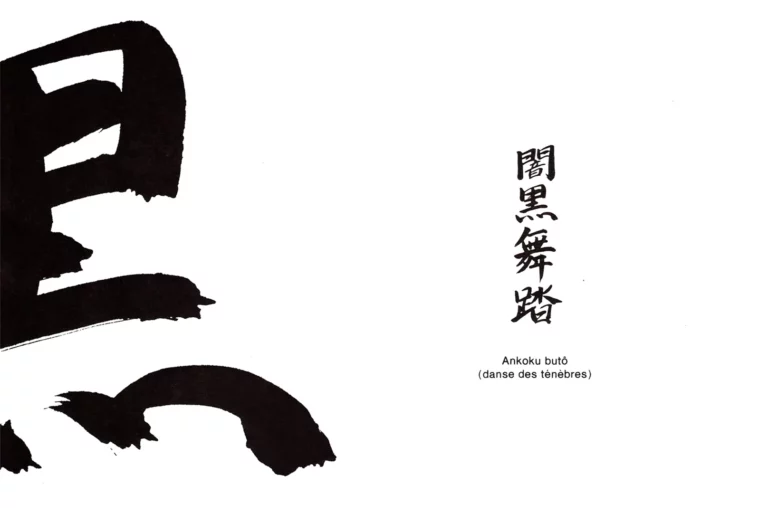Ogino Suichiro : La seule façon de définir le butô consiste, à mon sens, à définir les raisons pour lesquelles on ne peut pas définir le butô !
Parce que le phénomène évolue aujourd’hui encore, il n’existe pas de butô définitif ni donc de définition : au mieux, le butô manifeste une essence — négative — qui le rapproche de l’anti-art tel qu’il apparait dans les avant-gardes depuis dada et le surréalisme.
Parce que le butô consiste pour un danseur à exposer non pas même sa vision de la vie, mais son image de sa vie et son intelligence de son propre corps, et parce que la diversité est ainsi inscrite au cœur même du butô1, il n’existe pas non plus un butô officiel auquel on puisse rapporter les autres — encore qu’on puisse en revanche expliquer par cette notion d’individualisme foncier comment fonctionne le butô, à la fois dans sa poétique (voire sa philosophie), dans sa pratique (soit la façon dont chaque danseur doit élaborer son propre butô) -2 et même dans son rapport au public, puisqu’en l’absence d’une signification unique et établie, le butô agit en tout comme un miroir où chaque spectateur, comme avant lui le danseur, se retrouve face à lui-même.
Il y a bien, enfin, une définition historique, mais ce n’est pas celle que l’on croit:du fait même que le butô a été largement influencé par les avant-gardes européennes (surtout le surréalisme), il serait ridicule d’y voir uniquement le reflet d’une crise de société (la contestation des années 60), voire comme on l’a fait parfois une séquelle du cauchemar nucléaire ! Par contre, c’est toute l’histoire culturelle du Japon qui semble procéder par périodes alternées d’absorption et d’assimilation :les spectacles sophistiqués importés de Chine à l’époque de Nara ont été progressivement japonisés au fil de l’ère Heian ; au Moyen Âge, ce sont les danses profanes du continent qui s’élaborent jusqu’à produire le nôgaku3 ; l’ère Edo4 voit le bunraku raffiner l’art grossier des poupées mawashi, puis le kabuki réaliser la synthèse de toutes les formes précédentes. Dans cette logique-là, nous voyons aujourd’hui apparaître les premières formes dramatiques authentiquement japonaises après un siècle et plus d’adoption des styles occidentaux, et ces formes nouvelles font à leur tour la synthèse de tout ce que le Japon est devenu en un siècle, intégrant les éléments autochtones aux influences étrangères : le buté et le shô-gekijô5 sont nos premiers spectacles originaux depuis la révolution de Meiji6.
Daniel De Bruycker : Est-ce qu’on peut y voir deux styles jumeaux, apparus parallèlement l’un dans la danse et l’autre dans le théâtre ?
O.S. : Oui, à ceci près que le butô s’est constitué bien avant que Kara Jurô commence à rénover le théâtre, mais ilest vrai qu’il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les deux disciplines :ainsi, Dairakudakan, la troupe de butô dont sont issus Amagatsu (Sankaï Juku) et Oosuka (Byakkosha), a été fondée par Maro Akaji, un transfuge de la troupe de shô-gekijô Kurotento, le « Chapiteau noir » de Sat Makoto, lui-même inspiré par l’exemple de Kara Jurô qui avait fondé Akatento, le « Chapiteau rouge », après qu’on lui ait interdit l’accès des salles de théâtre !
Ceci dit, presque tous les acteurs du shô-gekijô reconnaissent l’influence de Hijikata Tatsumi : Kara Jurdô, Terayama Shuji et Suzuki Tadashi, les trois fondateurs du mouvement, étaient tous des amis de Hijikata, dont le studio était à l’époque le rendez-vous de toutes les avant-gardes, théâtrales, graphiques, littéraires…
D.D.B. : Politiques également ?
O.S. : Celles-là se retrouvaient plutôt à l’université Hanazono, où j’ai moi-même fait le plus clair de mes « études » pendant la fermeture des campus, à la fin des années ’60.
D.D.B. : Hanazono ? Je ne connais pas cette université…