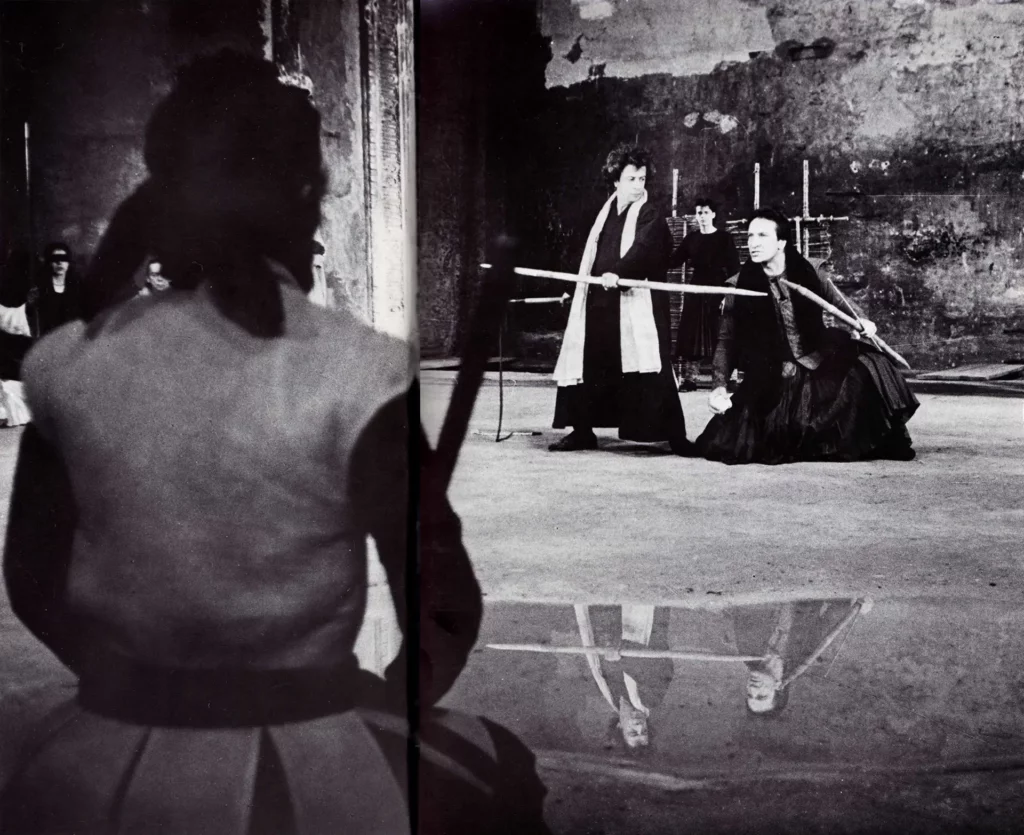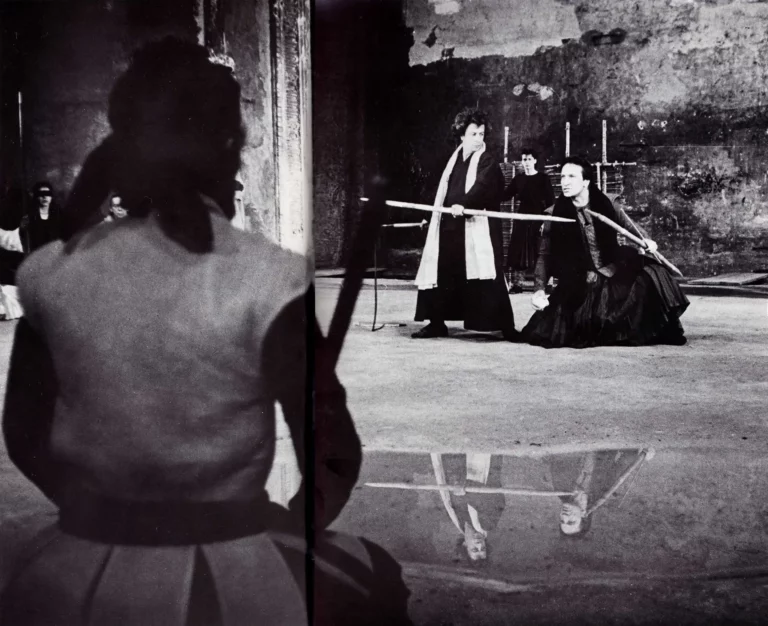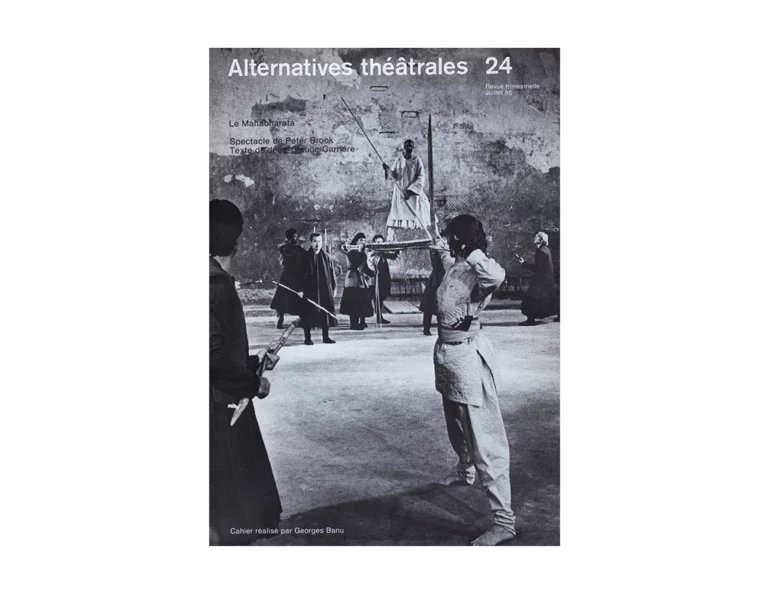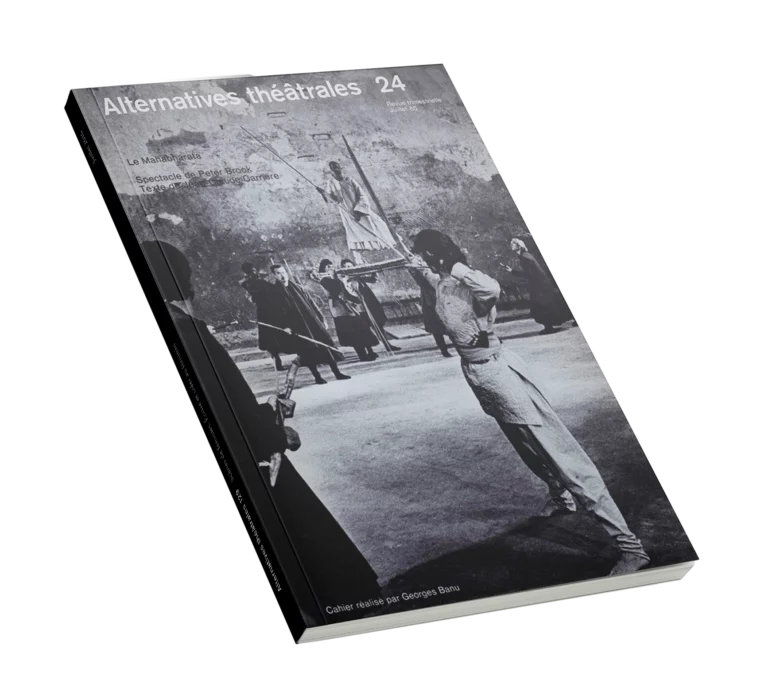« L’ensemble des moyens du bricoleur n’est pas définissable par un projet …il se définit seulement par son instrumentalité, autrement dit et pour employer le langage même du bricoleur, parce que les éléments sont recueillis ou conservés en vertu du principe que « ça peut toujours servir » …
Le bricoleur s’adresse à une collection de résidus d’ouvrages humains, c’est-à-dire à un sous ensemble de la culture …
Dans cette incessante reconstruction à l’aide des mêmes matériaux, ce sont toujours d’anciennes fins qui sont appelées à jouer le rôle de moyens … (le projet) une fois réalisé sera inévitablement décalé par rapport à l’intention initiale …
Or, le propre de la pensée mythique, comme du bricolage sur le plan pratique, est d’élaborer des ensembles structurés, non pas directement avec d’autres ensembles structurés, mais en utilisant des résidus et des débris d’évènements ».
Claude Lévi-Strauss, « La science du concret » in La pensée sauvage,Pion, 1969, p. 27 – 32.
La trame musicale du Mahabharata évoque indubitablement l’esthétique des musiques de l’Inde. Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour s’en convaincre : la seule présence, sur scène, d’un certain type d’instruments, les sonorités qui en émanent sont déjà en eux-mêmes des éléments suffisamment révélateurs. Quant à la musique, son style comme sa « couleur » démontrent, à leur tour, une influence indienne certaine. Les musiciens n’étant pas d’origine indienne, on est tout naturellement porté à penser que le travail qu’ils ont eu à accomplir résidait en une imitation aussi fidèle que possible de cette esthétique. Mais, quel résultat peut-on escompter d’un travail de quelques mois pour une musique réclamant des années d’apprentissage ? Qui plus est, quelle liberté d’action, quelle part d’imagination resterait-il, dans ce cas, aux musiciens ?
En réalité, le style musical du Mahabharata n’est pas — comme nous le verrons ‑l’effet d’une reproduction, mais la conséquence d’une reconstruction. Les musiciens ne sont pas partis de la musique indienne : ils sont venus à elle progressivement, je dirais même tout naturellement. Il est donc nécessaire de dire quelques mots sur l’historique d’une telle démarche.
Le travail a débuté par une écoute aussi ouverte que possible de toutes les musiques traditionnelles du monde : nous avons ainsi passé en revue une quantité impressionnante d’échantillons musicaux, voire d’échantillons sonores, venant de tous les horizons. Il s’agissait d’écouter, tout simplement, d’écouter attentivement mais sans aucune arrière-pensée, c’est-à-dire sans aucune préoccupation liée de prés ou de loin au Mahabharata. En effet, nous n’étions pas à la recherche d’une certaine stylistique, d’une musique particulière, mais, au contraire, « à l’affût » d’effets sonores originels, en deçà de toute structure et surtout de toute connotation culturelle. Notre premier but était d’établir un catalogue initial de combinaisons sonores brutes, originaires. Comme on le voit, il n’était nullement question de musique, à savoir de langage constitué (et donc a fortiori de musique indienne), mais de simples éléments que nous retenions pour l’impact qu’ils communiquaient à partir d’un minimum de moyens mis en œuvre. Ce retour aux sources n’était pas subordonné à un projet réellement structuré. Sa raison d’être s’explique si l’on veut bien voir dans le Mahabharata- selon les termes de Jean-Claude Carrière — « la grande histoire de l’humanité ».
Ainsi, nous guettions tout au long de nos écoutes la manifestation de certains signes révélateurs d’une « musique première », constituant ainsi — sans nécessiter pour cela un quelconque dirigisme — un échantillonnage hétéroclite : notre propre patrimoine. Nos discussions étaient à l’image de ces premiers pas : il y était question de la densité du souffle, des qualités du timbre, de la fonction du rythme, etc. Les musiciens s’essayant à reproduire les fragments musicaux retenus, une seconde phase de travail s’amorçait : la manipulation. Celle-ci adopta toutes sortes de configurations : on reproduisait tel échantillon musical, on l’imitait, on le rythmait différemment, on en modifiait l’agencement, etc. Tous ces essais, toutes ces expérimentations étaient une façon d’engager, en quelque sorte, un dialogue avec nos « morceaux choisis », dialogue collectif mais qui ne pouvait rester longtemps à l’abri des pratiques musicales propres à chacun des musiciens : dans un essai d’imitation, de reproduction et surtout de modification d’une structure quelconque, émergeait inévitablement la « griffe » de chacun, de sorte que, peu à peu, cette manipulation devenait une affaire personnelle. Les musiciens se sont ainsi regroupés par affinité (de culture ou d’instrument), intégrant à leur jeu personnel les matériaux nouvellement acquis. L’activité musicale s’est donc, à partir de ce moment, diversifiée selon plusieurs lignes de conduite. Outre le travail personnel de chaque musicien, des tentatives de réalisation, la liaison avec les acteurs s’opérait par le biais d’un travail vocal, de l’apprentissage de certains instruments (trompes, conques, etc.), et des premiers essais d’application à la scène du bagage musical accumulé. C’est également à cette période que démarra une confrontation avec des musiciens indiens venus du Rajasthan, confrontation qui allait se prolonger plusieurs semaines. Celle-ci s’est traduite, dans les faits, par des séances de travail basées essentiellement sur la pratique instrumentale qui ont permis aux musiciens de faire l’apprentissage de nouveaux instruments ainsi que d’adapter leurs acquis au style propre d’une musique indienne populaire. De même, les rencontres périodiques avec le violoniste indien L. Subramaniam leur ont permis d’étendre leur exploration initiale à l’esthétique de la musique, cette fois-ci savante, de l’Inde.
C’est, munis de ces atouts et forts d’une telle expérience, que les musiciens se sont confrontés au jeu des acteurs. La mise en place définitive de la musique a été, à partir de là une affaire collective, une question de choix, d’expérimentations sans cesse renouvelées, de raffinements progressifs.
Nous n’entrerons pas dans les détails de cette exploration finale, l’important étant, à notre avis, d’expliciter ici un type de démarche et non de décrire sa matérialisation ultime. Comme on a pu le voir, une telle démarche se caractérise par une sorte de progression en « tuilage » : chaque nouvelle phase de travail se dessinant avant que la précédente ne se termine véritablement, les buts successifs servaient en même temps de nouveaux tremplins. A aucun moment ne s’est posée la question d’une structuration précise du chemin à parcourir, et, c’est ainsi que le chemin n’a pas été celui d’une construction : en effet, il ne s’agissait pas, au bout du compte, d’inventer à partir d’un schéma prédéterminé d’avance, mais bien plutôt d’agencer entre eux des éléments existants et de renouveler au mieux les combinaisons auxquelles ils se prêtaient. Pour réaliser la musique du Mahabharata, nous avons « bricolé » avec des bouts de la musique du monde.