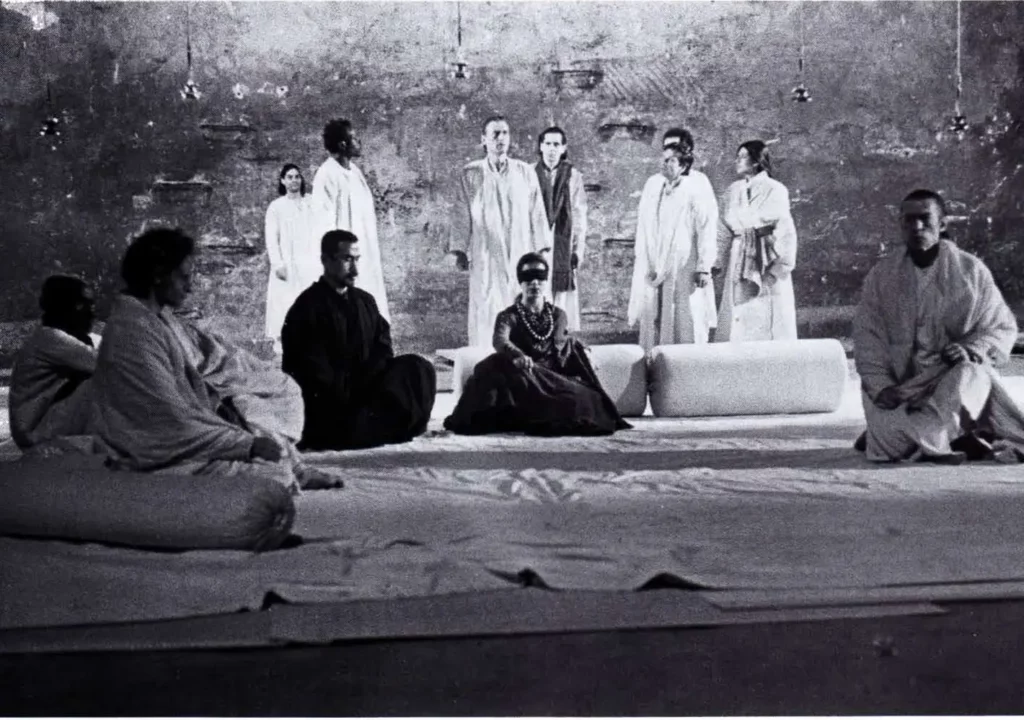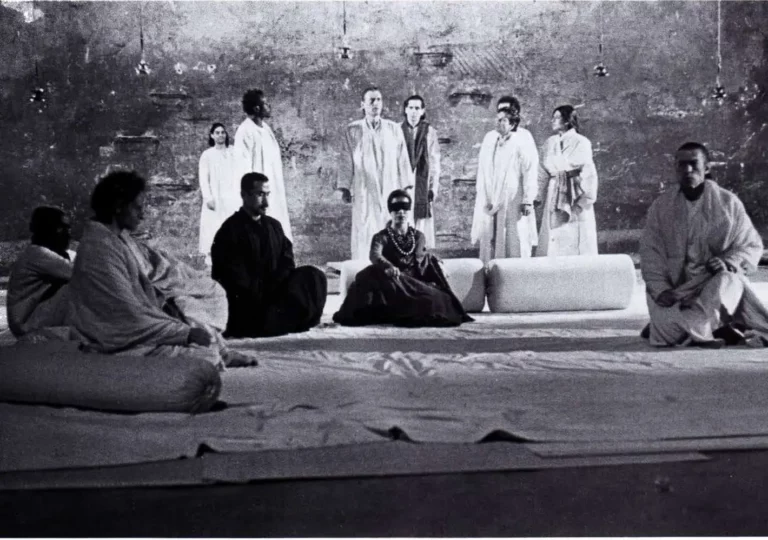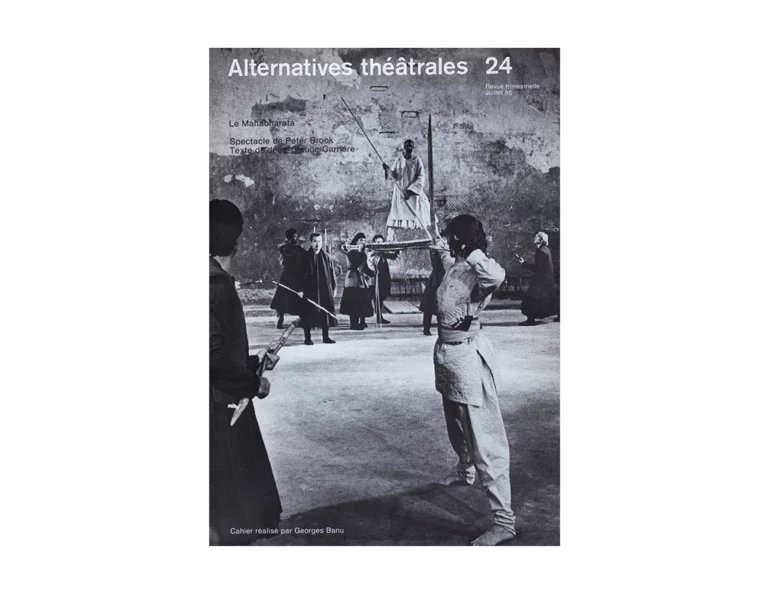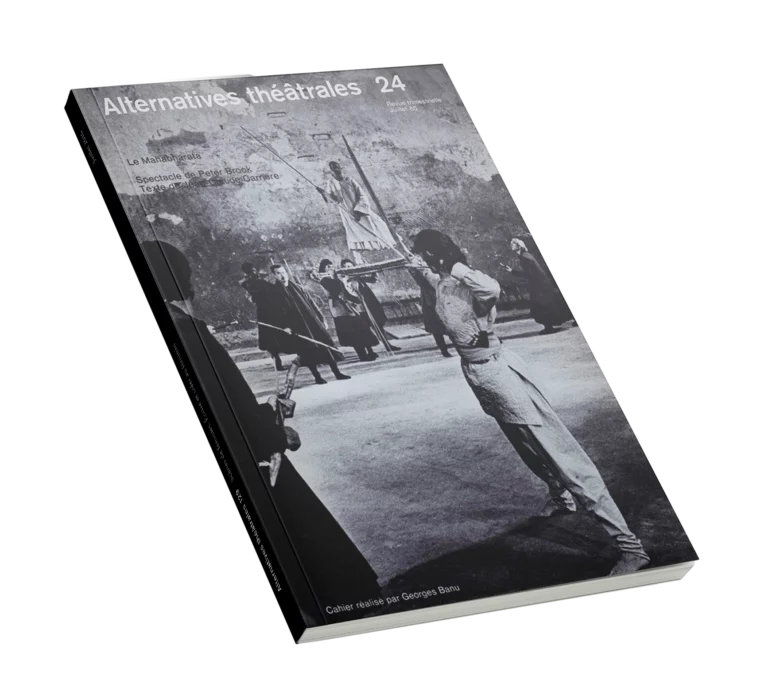Georges Banu : Avec Le Mahabharata tu t’es retrouvé dans la même situation que lors de La conférence des oiseaux car il s’agissait de ne pas partir d’une œuvre dramatique, mais d’une œuvre épique. Il me semble que le type d’écriture change ici par rapport à La conférence. Quels sont pour toi les rapprochements, et quelles sont les différences qui peuvent s’établir entre ces deux formes de travail ?
Jean-Claude Carrière : Dans les deux cas, j’ai cherché à m’adapter le plus possible à l’œuvre originale. Avec La conférence, il s’agissait moins d’un poème épique que d’un poème … initiatique, tandis que Le Mahabharata est une véritable, immense épopée. Le ton, même sans qu’on le veuille, s’adapterait nécessairement.
La deuxième différence concerne l’Inde. Dans Le Mahabharata, l’Inde se retrouve à tous les niveaux et donc on ne peut pas ne pas se poser la question : quelle part donner à l’Inde ? Finalement elle va être présente dans le spectacle à tous les niveaux, et la part de l’Inde est infiniment plus grande que la part de la Perse dans La conférence des oiseaux, qui est beaucoup plus au-dessus de la terre, beaucoup plus dégagée des contingences réalistes. C’est cela qui permettait d’introduire des masques de Bali, des costumes plus stylisés, tandis que Le Mahabharata ne le permet pas, et on l’imagine très difficilement joué avec des masques japonais, coréens ou avec des éléments occidentaux. La troisième différence vient d’un problème d’écriture assez subtil que je vais essayer de t’expliquer. Avec La conférence, je n’avais presque rien comme référence occidentale et il n’y avait aucun danger de comparaison avec tel ou tel modèle de notre culture. Elle restait un conte oriental sans aucune réalité historique et cela me permettait une certaine liberté de langage. Avec Le Mahabharata j’ai senti dès le début le danger énorme qu’on le compare à des tragédies occidentales, quelles qu’elles soient, que ce soient des tragédies classiques ou, le danger était encore plus grand, des drames romantiques. Il y a très peu d’écrivains occidentaux qui se sont inspirés de l’Inde. Il y en a quand même un qui l’a fait, parce qu’il a tout fait, c’est Victor Hugo.
Il l’a fait superbement dans un poème de La légende des siècles. La tentation était, et mon rêve premier eût été, d’être Victor Hugo et d’écrire Le Mahabharata comme Victor Hugo l’eût écrit. Très vite ce rêve s’est brisé car dès qu’on essaye d’y introduire un mouvement poétique français (comme c’est le cas de la traduction du Mahabharata faite sous le Second Empire) on tombe dans un sous-Hugo, inévitablement pompier. On ne peut l’éviter. J’en ai été très conscient et pour cela j’ai abandonné mes premiers essais pour écrire en vers, en faux vers dont il reste tout de même le fait que la prose de la pièce est une prose rythmée. La recherche du langage a ètè beaucoup plus longue que pour La conférence.
G. B. : Et cette recherche de langage, par rapport à quels termes s’est-elle effectuée ? Par rapport à qui entendais-tu te définir ?
J. ‑C. C. : J’ai commencé très humblement par relire énormément de poésie et de théâtre français. Et puis j’ai procède progressivement à des éliminations. Elles visaient à écarter tout ce qui pouvait produire une référence précise à l’Occident. Par exemple, les termes chrétiens : pas de péché, pas d’âme, pas de vie éternelle, pas de rédemption, pas d’incarnation. Tous ces mots étaient à exclure immédiatement, car on voyait derrière d’autres images que nous voulions éviter. Deuxième catégorie de mots à éliminer : les mots moyenâgeux. Les mots noble, chevalier, suzerain, principauté. Si on gardait ces mots-là, c’ètait comme si on mettait derrière les personnages indiens l’image de notre Moyen-Âge. Troisième catégorie de vocabulaire à éliminer : le vocabulaire qu’on pourrait appeler classique ou néo-classique. (Celui qui fera la version anglaise se heurtera aux mêmes problèmes car, même dans Shakespeare, il y a des mots qui ont ètè très forts et qui ont faibli aujourd’hui.) Il y a des mots qui s’usent, qui se rident, qui vieillissent, qui se flétrissent, des mots qui sont puissants chez Corneille ou Racine mais qui n’ont plus la moindre force de nos jours. Par exemple : affligé, tourment, courroux. Ils sont inutilisables, parce qu’ils renvoient inévitablement aux sous-produits néo-classiques. La quatrième catégorie de vocabulaire à éliminer : le vocabulaire pompier des poètes parnassiens du XIXe siècle. Tous les mots pseudo-antiques de Salambô de Flaubert ou de José-Maria de Hérédia. C’est-à-dire la couleur locale transposée en vocabulaire français, le brillant du casque pompier.
En éliminant, j’ai voulu éviter de mettre derrière la pièce et les personnages un fantôme, fantôme qui peut attirer l’attention sur lui par le jeu subtil des mots et de leurs associations. Une fois qu’on a éliminé toutes ces catégories — plus, inutile de le dire, le langage moderne — on se trouve devant un vocabulaire très simple. On retrouve des mots qui n’ont absolument pas perdu leur force. Le mot cœur, le mot sang, le mot mort : trois mots très simples qui sont à la base de la pièce. Ces mots restent tout à fait vivants et ils ne se rattachent à aucune des catégories de vocabulaire dont je t’ai parlé. En prenant ces trois mots et vingt-cinq autres (par exemple, déchiré, que j’aime beaucoup) et en les reliant à des adjectifs inhabituels que j’ai souvent cherchés dans le vocabulaire précieux des poètes baroques du XVIIe (c’est là où le langage français, étant plus archaïque et pas encore codifié par le classicisme, est le plus intéressant) on trouve des associations très étonnantes. Très fortes. Par exemple, un personnage dit:«Si dans ton coeur profond tu souhaites la défaite », le coeur profond c’est inhabituel sans être artificiel. Je vois qu’on parle beaucoup vocabulaire…
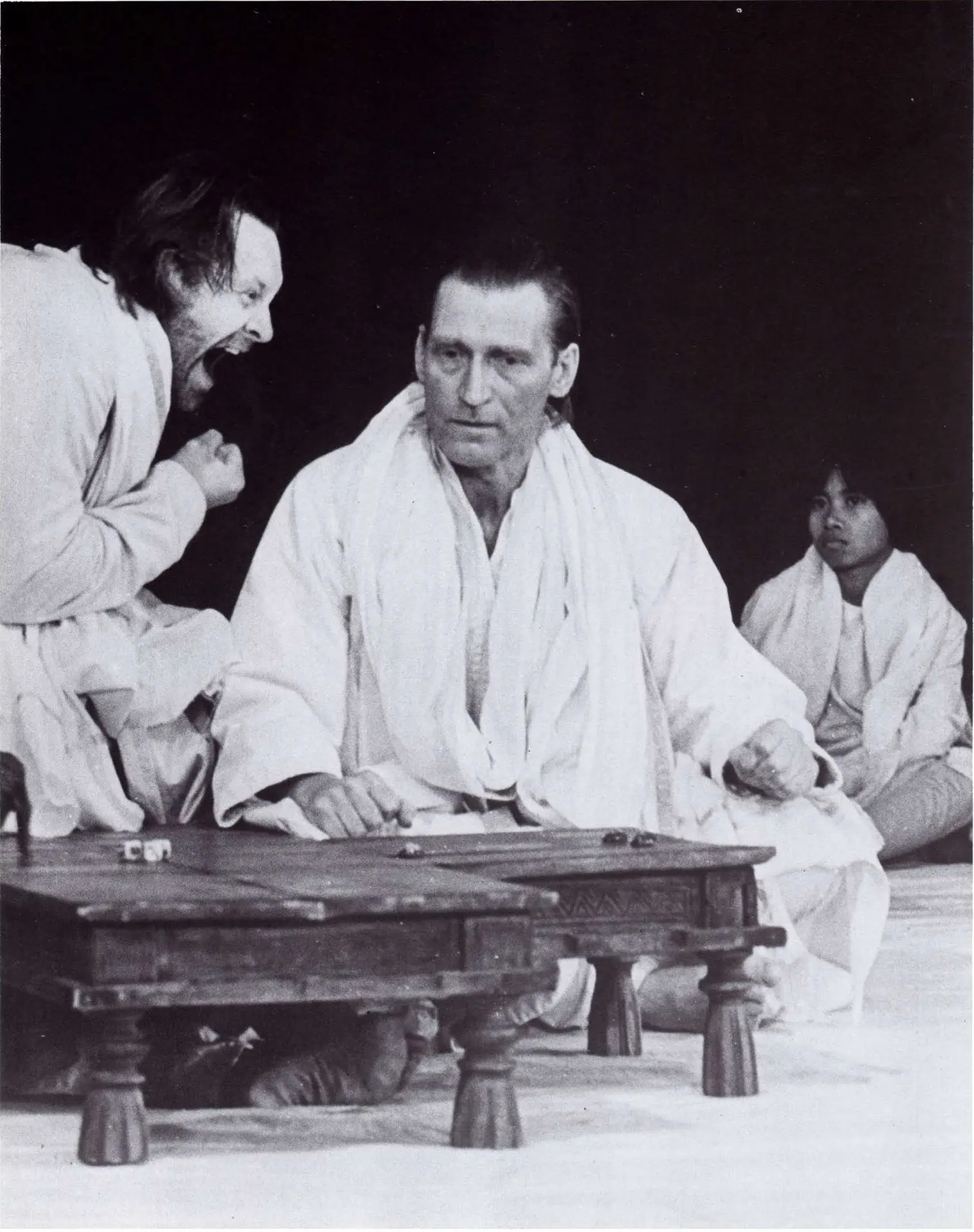
G. B. : La vérité passe par l’histoire qu’on raconte mais aussi par les mots dont on se sert…
J.-C.C. : Sans doute, et leur usage peut révéler énormément de choses. Il y a avec Le Mahabharata une possibilité de colonisation inconsciente par le vocabulaire, car le fait de traduire ou pas les mots indiens traduit notre rapport à toute une civilisation. Dire que l’on peut trouver des équivalents de tous les mots indiens, c’est dire que la culture française peut s’approprier grâce à un mot les notions les plus profondes et les plus réfléchies de la pensée indienne. Je n’ai pas traduit le mot dharma qui revient le plus souvent car on ne peut le traduire à l’aide d’un seul mot, on a besoin de plusieurs lignes. Si je le traduis par devoir -chose imposée de l’extérieur, ce qui n’est pas le cas pour le dharma — par loi, justice ou vérité je réduis le sens du mot, je l’assimile à nos pensées morales et, par là même, je fais œuvre impérialiste.
Je n’ai pas traduit non plus le mot Kshatrya parce que je n’ai pas trouvé d’équivalent dont je pouvais me servir, le plus proche étant chevalier qui, à l’usage, renvoyait au Moyen-Âge. En refusant de traduire certains mots indiens, je veux reconnaitre que la pensée française et sa langue ne peuvent tout couvrir. Mais par ailleurs un tel refus encourt le risque du langage ésotérique, langage d’initié car, combien de fois n’entend-on pas parler des spécialistes du théâtre oriental, par exemple, qui n’utilisent que les mots japonais, indiens et qui, ainsi, éloignent excessivement l’objet théâtral de nous. Alors on a le sentiment qu’il n’y a pas de pont, qu’aucune liaison n’est ni possible, ni envisageable. Nous sommes des étrangers les uns aux autres. Ce risque existe si on abuse de ce type de mots. Alors on perd toute la vie de la langue. C’est l’autre danger.
G. B. : Le Mahabharata, on le sait, s’impose aussi par ses dimensions, dont nous avons du mal à prendre la mesure réelle. Il faut dire aussi que les orientaux ont le génie de la digression, du détour. Forcément, une des questions que tu as dû rencontrer et résoudre c’était : comment traiter ce matériau immense, comment parvenir à lui donner corps, sans pour autant sacrifier son essence. Comment as-tu procédé ?
J. ‑C. C. : Dans cette aventure qui a duré longtemps, nous nous sommes efforcés de ne pas être arrivés avant d’être partis… d’avancer très calmement et de ne faire que ce qui nous paraissait possible.
Le Mahabharata est un poème qui a très abondamment chanté ses propres mérites. Dès le début on dit :«Je suis le plus grand poème du monde et ceux qui vont lire ce poème sortiront heureux, purifiés…». Jamais aucun poète n’a dit ça. On a essayé de prendre cela complètement à la lettre : Le Mahabharata est un poème bienfaisant. Si on raconte et si on écoute ce poème, cela fait du bien. Ça rend meilleur… Je peux dire que c’est vrai et que j’en ai fait moi-même l’expérience. J’ai travaillé énormément, j’ai écrit plus que la longueur totale du poème, mais chaque fois que je m’y suis remis, j’ai éprouvé une sensation vitalisante. Pas une seule fois je n’ai été lassé.
G. B. : Mais, pratiquement, comment as-tu traité ce matériau ?
J. ‑C. C. : Quand on devient familier d’un immense fleuve, on découvre des rapports entre les personnages, des choses dont personne ne s’est rendu compte. Et cette familiarité m’a permis d’imaginer des scènes qui ne se trouvent pas dans le poème, mais qui sont virtuellement possibles. Une fois qu’on connait les personnages, on peut jouer avec eux, et alors on peut prendre un tel et le faire se rencontrer avec un autre. Presque la moitié des scènes n’existent pas dans l’original.
G. B. : Tu as dégagé tout de même l’histoire principale de la masse du poème, tu l’as mise en évidence avec puissance. Si tu as procédé à des éliminations de vocabulaire qui pouvaient engendrer un fantôme étranger à l’œuvre — le fantôme de l’Occident — tu as dû procéder aussi à des éliminations dans la matière du poème.
J. ‑C. C. : D’un commun accord nous avons choisi de raconter l’histoire principale en gardant ses origines fabuleuses. On aurait pu y renoncer, mais on perdait beaucoup et on n’avait plus la lancée fabuleuse, féérique du spectacle. Par contre, on a sacrifié les histoires secondaires. Ce sont des histoires que les personnages se racontent entre eux, en redoublant parfois les évènements de l’histoire principale. On raconte d’une autre façon ce qui est arrivé aux personnages principaux. Et, par exemple, on a éliminé l’histoire célèbre de Nala et Damayanti qui redouble la partie de dès. De la même façon, dans la genèse des personnages, il y a des épisodes qui font double emploi : il y a par exemple un premier passage dans la forêt, puis ils reviennent pour y retourner ensuite. Arjuna est vainqueur dans deux tournois…