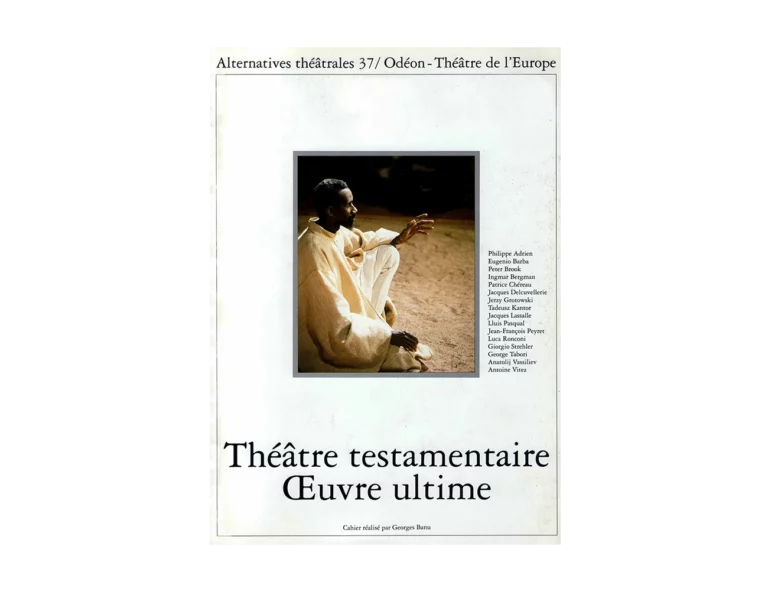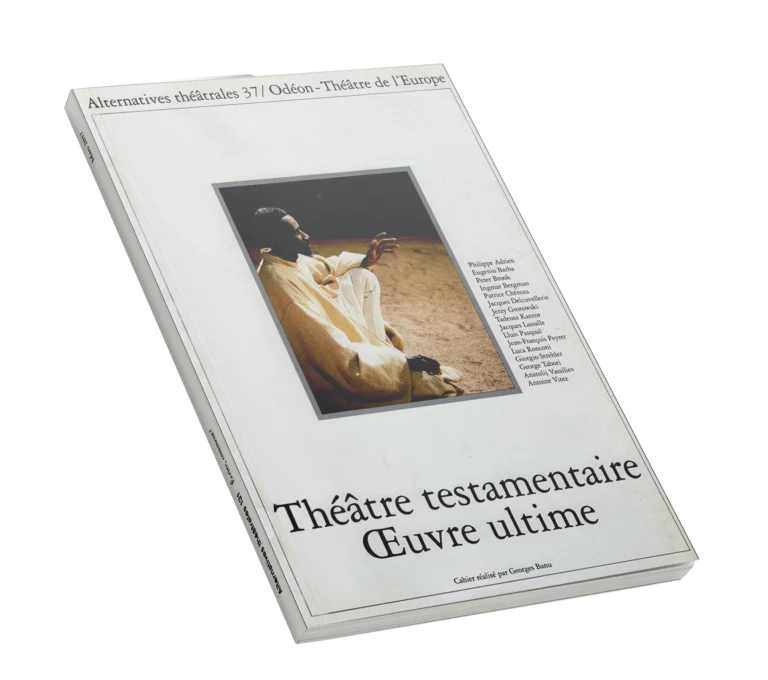LE travail théâtral est ancré clans le présent, attentif à ce qui se passe dans les contrées de l’histoire et dans l’arène du théâtre. Il hasarde une réponse aux problèmes professionnels et personnels qui surgissent jour après jour. Il essaie de réaliser des rêves et des désirs en répondant aux nécessités du moment. Mais ce qui compte avant tout c’est ce que l’on dira après, lorsque nous, qui sommes attelés à cette tâche, aurons disparu.
Eftermaele : ce que l’on dira après. L’homme de théâtre est aussi responsable devant les « spectateurs » qui ne l’ont jamais vu. Son identité professionnelle, telle qu’il l’invente et la vit, est une part de l’héritage qu’il transmet au temps.
Eftermaele : ce terme qui appartient à la culture norvégienne pourrait être traduit en additionnant deux mots : réputation et honneur. Il signifie : « le temps décidera du sens et de la valeur de tes actions ». Mais le temps ce sont les autres, ceux qui viendront après nous. Il y a là un paradoxe : le théâtre est art du présent.
Honneur est un mot qui semble appartenir au passé. Il évoque d’archaïques contraintes sociales. Mais il indique aussi l’existence d’une valeur transcendante. Il implique une obligation, non pas envers nous-mêmes et notre milieu, mais envers ce qui nous dépasse. Molière, si l’on en croit ses contemporains, bien qu’étant gentilhomme de la cour et considéré comme « l’un des plus grands philosophes français », mettait pourtant son point d’honneur à se barbouiller le visage chaque soir et à se présenter au public comme un bouffon. Cette image est-elle excessive et romantique ? Que chacun alors trouve la sienne.
Les contraintes peuvent parfois être des tremplins. Kierkegaard, à propos d’une grande actrice, parle du poids qui la fait voler. « Art du présent », autrement dit un art appelé à se battre contre son destin et sa spécificité de création d’œuvres éphémères. A l’âge de la mémoire électronique, du film, de la duplication, le spectacle théâtral se définit aussi à travers le travail auquel il soumet la mémoire vivante, laquelle n’est pas musée mais métamorphose.
Nous ne pouvons léguer aux autres que ce que nous n’avons pas entièrement consommé. Un testament ne saurait tout transmettre, ni transmettre à tous. Rien ne sert de se demander : qui seront mes héritiers ? Mais il est essentiel de ne pas oublier qu’il y aura des héritiers.
Nous ne pouvons parler à nos héritiers inconnus qu’en faisant passer notre voix à travers ceux qui nous approchent aujourd’hui. Autre paradoxe : parvenir aux héritiers par des détours, en parlant à ceux qui ne sont pas nos héritiers. Ce qui implique une vision du théâtre, une capacité à inventer sa propre identité et une technique minutieuse de la relation acteur-spectateur.
Comment transmettre le message ? Une image puisée dans la vie de Brecht, juste après la guerre et son retour en Europe:— Les jeunes vous attendent, Monsieur Brecht ! Vous êtes un mythe pour nous en Allemagne !— Je trouverai un remède à tout cela.
Certains imaginent le « message » comme une vérité que notre histoire, notre tradition, notre expérience et savoir personnels nous ont fait découvrir et que de ce fait nous communiquons aux autres.
Pour ma part, je l’imagine comme un tableau qu’aurait réalisé un peintre de talent, mais aveugle. A travers les techniques que nous avons acquises, les histoires qui nous fascinent, nos blessures et nos éblouissements secrets, nous devons aboutir à quelque chose qui ne nous appartient plus et qui ne se laisse posséder ni par celui qui le fait, ni par celui qui le voit.
Le véritable message est le résultat non prévu, non programmé, d’un voyage vers une cécité consciente : l’anonymat. Il existe deux types d’anonymat. D’une part l’anonymat qui est le fruit d’un acquiescement à l’esprit du temps, qu’on pourrait appeler l’anonymat du plein : notre voix est étouffée par tout ce que les autres, la culture, la société, la tradition environnante ont déversé en nous. Dans ce cas on est anonyme parce que rempli d’idées reçues. Mais il est aussi un anonymat du vide, qui se conquiert par le chemin inverse, celui de la première personne : non pas ce que l’on sait, mais ce que je sais. Résultat de la révolte personnelle, de la nostalgie, du refus, du désir de se trouver et de se perdre : creuser profondément jusqu’à découvrir les cavernes souterraines recouvertes par la roche et des centaines de mètres de terre compacte.
Y a‑t-il une technique pour réaliser toutes ces intentions ? Oui : la technique de l’appareillage et du naufrage ; autrement dit, projeter son propre spectacle, être en mesure de le construire et de le piloter vers le gouffre où il lui faudra trouver, sous peine de sombrer, une nouvelle nature : des significations que personne n’avait imaginées jusque là et que ses auteurs eux-mêmes observeront comme des énigmes. Sans technique, sans perfectionnisme, sans attention scrupuleuse aux détails, toutes ces métaphores resteraient dépourvues de sens. Mais sans métaphores ou obsessions de cette nature, la technique, le perfectionnisme, l’extrême précision des détails ne seraient eux aussi que du théâtre dépourvu de sens.
Le sens, comme « le sens de la marche » : la direction. Les héritiers sont le Nord. Aucun des spectacles de l’Odin n’est un spectacle-testament. Mais chaque fois, j’ai pensé au spectacle que mes camarades et moi-même étions en train d’élaborer comme à notre dernier spectacle. Impossible de remettre à plus tard. Ce que nous aspirons à faire, il faut le faire maintenant.
Zeami, Stanislavski, Appia, Meyerhold, Copeau, Craig, Artaud, Brecht, Eisenstein … pouvons-nous considérer leurs écrits comme l’expérience qu’ils nous ont laissée en héritage ?Tout se passe comme lorsqu’un homme séjourne longtemps dans un pays étranger dont il ignore complètement la langue. Des milliers de sons inconnus pénètrent dans ses oreilles et s’y déposent. En peu de temps, il acquiert le grommelot de cette langue, il peut l’imiter, il la reconnaît, mais il ne la comprend pas. C’est pour lui une masse confuse de sons d’où émergent çà et là quelques mots déchiffrables. Puis on lui donne une grammaire et un dictionnaire. À travers les signes écrits, il reconnaît les sons familiers et obscurs qui lentement trouvent un ordre, un classement, une justification. Maintenant, il est en mesure d’apprendre seul, il sait comment se faire aider, comment procéder pour apprendre.
On ne peut comprendre les livres des grands hommes de théâtre du passé, rebelles, réformateurs, visionnaires, que si on arrive jusqu’à eux chargé d’une somme d’expériences auxquelles on n’a pas encore su donner un nom. Leurs mots ébranlent notre grommelot opaque et l’amènent à la clarté d’une connaissance organique.
Ce sont tous de bons livres, capables d’intéresser les lecteurs. Mais leur efficacité secrète est cachée sous la surface de la littérature et de la technique, comme un filet capable de capturer les expériences que nous avons faites et dont la signification nous échappe encore. L’héritage va à la pêche de ses héritiers.
« Il y a une hérédité de nous à nous-mêmes ». Cette phrase de Louis Jouvet évoque la cohérence de notre démarche dans le déroulement du temps. Mais elle rappelle aussi la question impitoyable que chacun doit se poser après de longues années d’activité : ai-je encore un héritage entre les mains ou l’ai-je gaspillé ? Sa valeur est-elle encore intacte ou a‑t-elle été entamée par le commerce du monde, par le contact avec la profession ? Cet héritage a‑t-il conservé son sens personnel, intime, incommunicable ?
Seul ce qui est secret nous appartient. Le visible appartient aux autres. Je m’interroge:— Comment se fait-il que la plupart de tes spectacles soient directement liés à l’histoire de notre temps ? Veux tu témoigner de ce que tu as vu ? Des fantômes avec lesquels tu as dialogué ? Tes spectateurs te semblent-ils oublieux ?Je me réponds à moi-même : — Non, nous ne sommes pas oublieux. Il nous faut avoir le sens de l’histoire car elle, en est dépourvue.
Traduit par Eliane Deschamps-Pria.