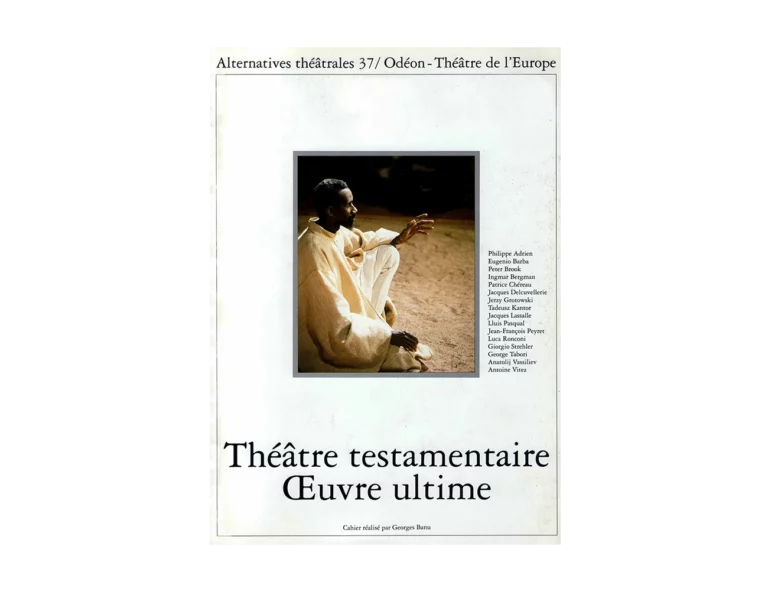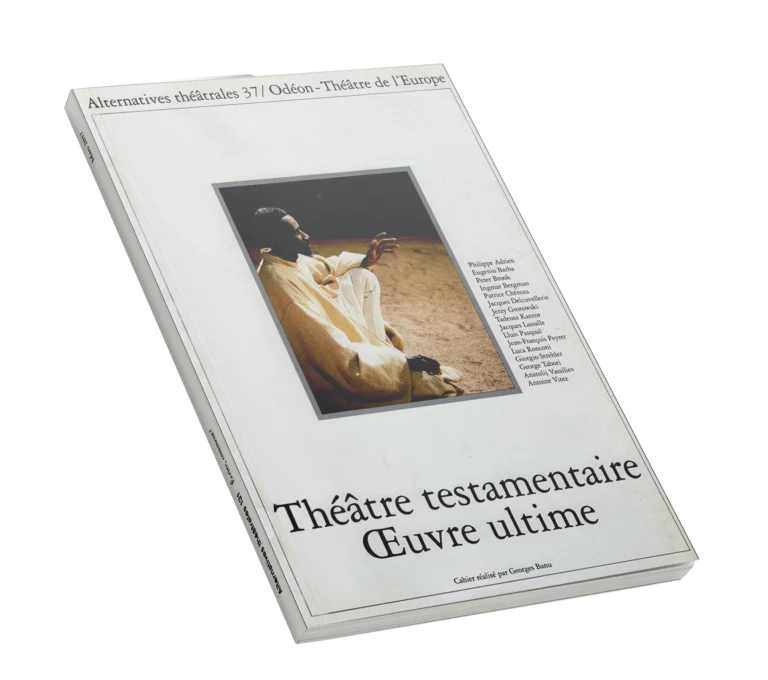LA DÉFINITION la plus commune, celle que donne le dictionnaire, identifie l’œuvre testamentaire à la dernière œuvre d’un écrivain. C’est une définition simple, moins claire pourtant qu’il n’y paraît. Elle signifie par exemple que toute dernière œuvre de n’importe quel écrivain est testamentaire. La définition ne préjuge pas du contenu du testament. Elle stipule seulement que l’œuvre qui se transmet est testament en tant qu’elle se transmet et indépendamment de son contenu. Dès lors pourquoi limiter le testamentaire à la dernière œuvre ? Pourquoi ne pas dire que tout ce qui s’écrit avant nous est testament ? C’est en tout cas ce que pensent (ou ont pensé) toutes les avant-gardes qui se veulent radicalement innovatrices et, en conséquence, refusent l’héritage à cor et à cris (quitte, parfois, à en récupérer quelques miettes en douce).
Mais que signifie au juste l’idée d’une dernière œuvre ? On dira qu’il pourrait s’agir de lier les notions de testament et de mort. Mais de quelle mort parle-t-on ? Sans doute de la mort physique de l’écrivain, mais un écrivain est susceptible de mourir d’une tout autre manière que physique. Il peut s’arrêter brusquement d’écrire sans pour autant cesser de vivre. Il est même des morts littéraires qui n’affichent pas forcément leur visage. Ainsi, il peut arriver que l’écrivain tout en continuant d’écrire s’épuise dans la répétition de lui-même, qu’il devienne à lui-même son propre épigone variant sans fin quelques recettes soigneusement éprouvées. À titre d’exemple, on pourrait ici avancer certains textes d’Ionesco qui, loin de la rupture des années cinquante, répètent sempiternellement un humanisme désespéré.
Il vaudrait peut-être mieux dire : l’œuvre testamentaire n’est pas forcément la dernière œuvre mais celle qui cristallise le mieux à la fois une manière et une problématique. Ainsi, par exemple, on peut certainement soutenir que LA MÈRE ou LA VIE DE GALILÉE sont pour Brecht des œuvres testamentaires bien que l’une et l’autre n’aient pas été écrites à la fin de sa vie. On peut tenir le même raisonnement avec Claudel et son SOULIER DE SATIN. Dans cette optique, n’est-on pas fondé à déclarer testamentaire toute œuvre accomplie. L’œuvre serait testament du fait même de receler en elle les possibilités artistiques à la fois d’un homme, d’un genre et d’un moment historique. Qu’une telle œuvre suppose une maturité et donc l’accumulation d’une certaine expérience de l’écriture, des hommes et du monde, voilà qui est probable. Mais il s’en faut de beaucoup que toutes ces vertus viennent comme par enchantement se nicher dans une dernière œuvre.
Si l’œuvre « bien accomplie » est testamentaire, ce peut être au sens où le testament est un acte par quoi se fait la recollection de tous les biens. Le testament suppose un inventaire accompli où chaque bien est reconnu dans la valeur qu’il possède. Transposée au domaine des œuvres, l’idée de testament suppose que l’œuvre est connue pour ce qu’elle renferme, que ses éléments constitutifs (formes et contenus) sont identifiés. Elle est donc testamentaire en tant qu’elle contribue, par ce qu’elle est, à éterniser sa propre valeur, à la proposer aux générations futures pour que celles-ci lui fassent acte d’allégeance. L’œuvre testamentaire profile ici la maîtrise de son devenir. Elle se présente à nous comme monument fiché, inventorié, fixé (par les savoirs universitaires ou les montages médiatiques par exemple). Tous ces biens issus des générations passées nous adviennent et nous les admirons comme de grands exemples, nous sommes supposés les reparcourir dans l’extase de leur réussite.