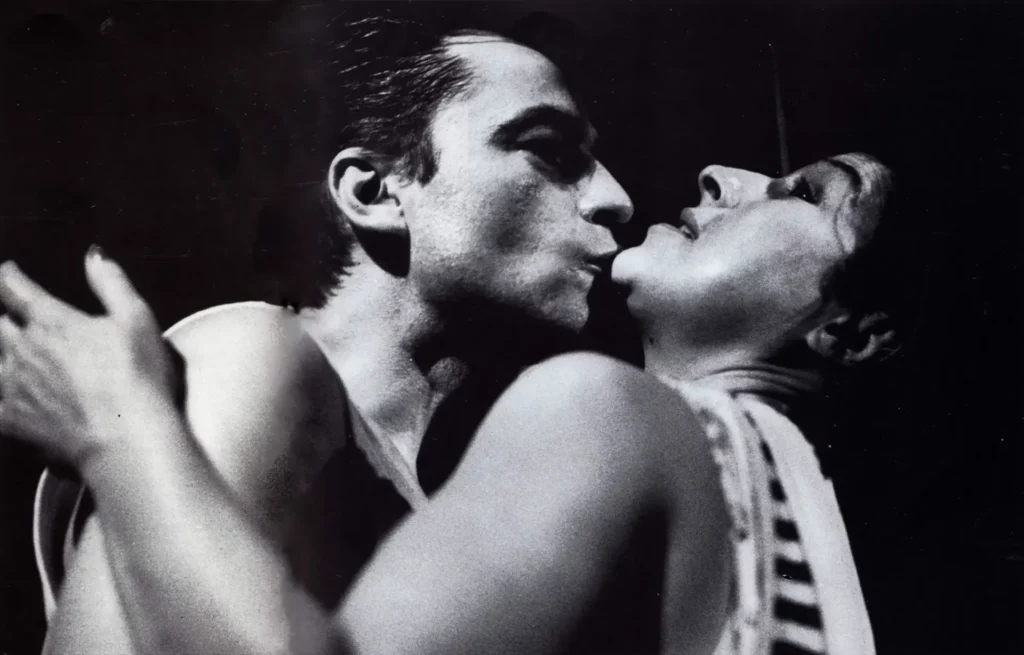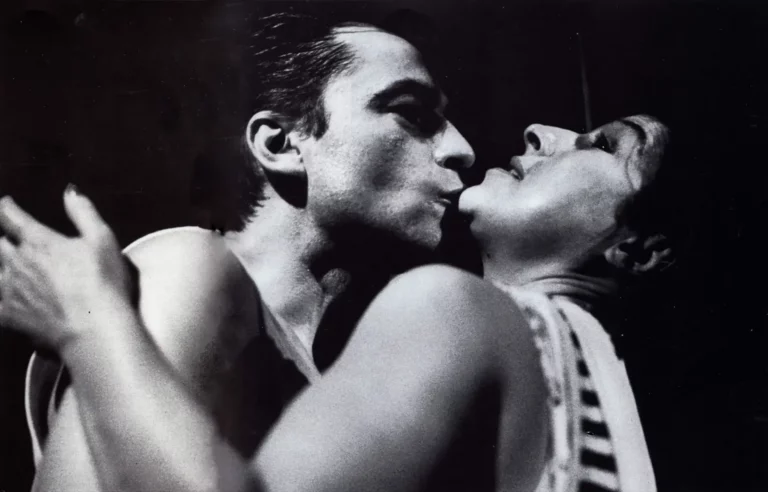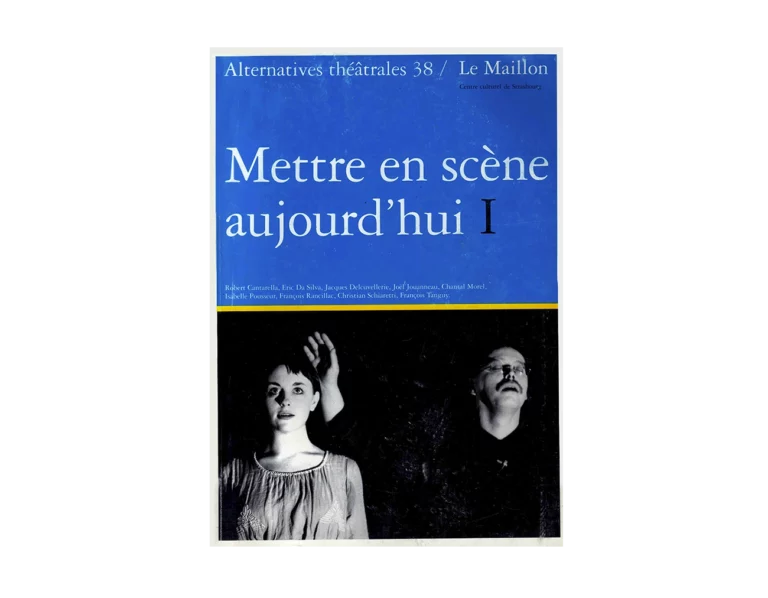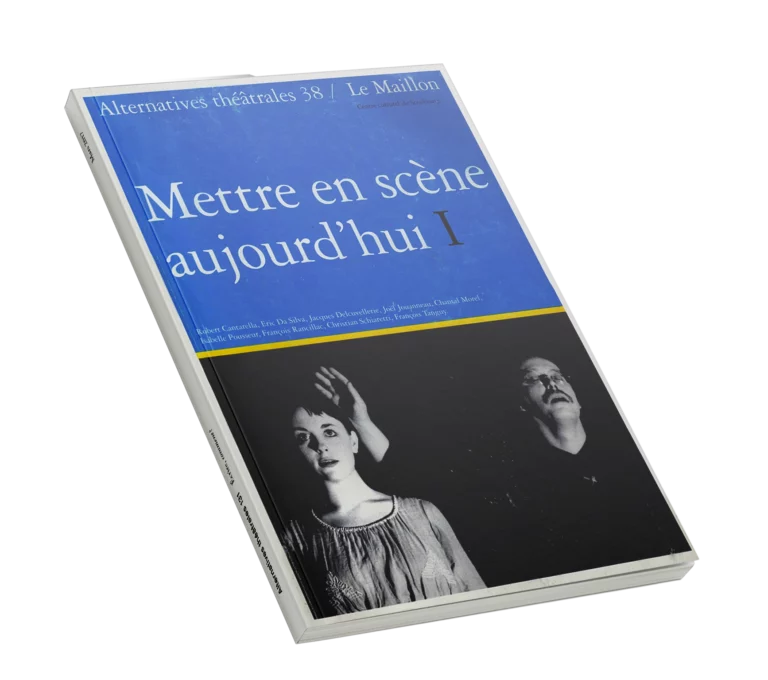I
Revivre,
au début,
là où l’enfance n’a pas encore commencé,
quelque part entre le premier souffle et le premier cri,
ou bien juste avant la fin quand cette vie fausse se brise.
Un vent se lève
qui parle aux arbres
feuille par feuille.
II
Écrire sur le travail de Christian Schiaretti, est difficile pour moi. Cela peut surprendre ; ce n’est sûre ment pas la matière qui manque. Comme le dit un proverbe allemand : « Quand le cœur est bien rempli, la bouche déborde ». Et voilà. Le cœur est bien rempli, — la tête aussi -, et pourtant la bouche ne déborde pas. Serait-ce le trop-plein qui pose problème. Sans aucun doute. Mais c’est aussi par pudeur et par discrétion que les mots hésitent à venir. Un jour nos chemins se sont croisés, dans cette cave à charbon théâtrale, notre forteresse-oubliette : l’Atalante.
Tout être humain est complexe : le travail de Christian Schiaretti a beaucoup de facettes, j’en connais seulement quelques unes. Chaque fois que j’ai travaillé avec lui, j’en ai découvert d’autres. D’ailleurs, chacun de nous a ses solitudes ; elles sont tout autant nécessaires à la création que le travail en équipe, sinon il n’y a pas de bon théâtre.
Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour le silence : je suis incapable de mêler ma voix aux bavardages médiatiques. Contrairement à certaines idées reçues le dramaturge n’est pas la concierge intellectuelle du théâtre. J’espère que ces lignes ne me démentiront pas.
Il y a un temps pour le silence. Je le garderai quand cela me semble convenable. Le théâtre se fait avec des êtres humains ; il est fragile, précaire, il est fait comme eux. Dans sa forme la plus pure c’est un « experimentum mundi », une expérimentation du monde ; il est utopique parce qu’il est radical. Le couvrir de mors inadéquats tend à le détruire. D’ailleurs la distance encre l’échec et la réussite y est fine comme une lame de rasoir. Et le silence est nécessaire pour que nous puissions danser sur cette lame. C’est ce que j’ai appris en travaillant avec Christian. Et puis il y a le silence qui confine à l’énigme, à ce qui ne peut être percé ni saisi par la parole, sauf par celle de la poésie… peut-être. C’est le silence de la création, creuser où se fondent l’art de la mise en scène, l’art du texte et l’art du comédien pour donner naissance à l’œuvre théâtrale. C’est ce silence-là qu’on entend dans les moments essentiels des répétitions. On l’entend. Le silence et la tendresse de Christian sont l’expression conséquence de sa radicalité.
Il y a un temps pour la parole, une parole claire, sincère, conscience, une parole qui dénonce, qui met en douce et qui est hostile à roue faux compromis. Christian possède le don de cette parole. C’est un ennemi juré de toute mystification. Il se refuse à entourer sa pratique d’une aura que l’évolution historique a détruire depuis longtemps — heureusement. Et si quelque part on commençait à lui vouer un certain culte qui dans la plupart des cas relèverait plutôt du marketing culturel, ce culte raterait sa cible : il est tout simplement inadéquat. Nous allons donc parler, de Christian, de son travail. Et d’une manière sobre. Cela est conforme à son esprit.
Il y a la vérité du silence, il y a la vérité de la parole. Entre ces deux pôles jaillit une petite étincelle, de temps en temps : la vérité.
III
Votre destin est assuré toujours
vous étiez sûrs de vos affaires aussi
quand vous êtes montés
dans ces camions
aux grandes croix rouges peinturlurées
pour prendre la douche
derrière le bosquet de hêtres
vous-mêmes aussi
quand vous trouviez
le moyen optimal
de vous transformer en marmelade.
IV
Celui qui connaît le travail de Christian Schiaretti, est frappé par une qualité constante : sa recherche patiente et intense d’une écriture scénique juste. Elle correspond à une exigence fondamentale qui découle de la dialectique subtile et complexe entre la forme et le contenu telle qu’elle a été décrite par Adorno : il faut que la forme d’une œuvre soit
« son contenu sédimenté ». Cette exigence est aussi bien d’ordre éthique que d’ordre esthétique.
Parlons de l’exigence éthique. Le constat de Brecht que la conversation sur les arbres confine au crime parce qu’elle inclut tant de silence sur tant de crimes, est plus valable que jamais. Mais on fait tout pour noyer ce constat dans un flot d’images et de paroles. La surface lisse de la réalité est trompeuse ; les gouffres restent cachés jusqu’au dernier moment. Telle est l’expérience fondamentale de notre siècle qui a trouvé son point — provisoirement- culminant à Auschwitz et Hiroshima. Se méfier du faux semblant de la réalité, comprendre que les apocalypses commencent toutes petites, à peine perceptibles, c’est ce que Christian a appris très tôt. C’est la conscience de cette réalité qui le force à la justesse et c’est en ce sens que celle-ci est une exigence éthique et non seulement une exigence formelle. De tout temps, il a été difficile de faire des images adéquates à son époque ; le « mentir vrai » de l’art théâtral a souvent cédé le pas à l’esthétique de l’emballage. Ne pas trou ver la forme juste, c’est mentir. Cette vérité radicale de l’art qui ne tolère pas la médiocrité, se trouve aujourd’hui démentie par la montée des pratiques théâtrales qui font de l’emballage une valeur en soi, non pas par ce que les faiseurs de théâtre en question seraient des incapables, mais par ce qu’ils ont consciemment capitulé devant la complexité contradictoire de la réalité qui les entoure. Appelons cela triomphe de la raison cynique, eux ils continueront à l’appeler « post modernisme ». La réduction de l’art théâtral à son pur aspect culinaire lui donne le goût du « fast food ».
Tout ce que je connais du travail de Christian Schiaretti, est inspiré de la démarche contraire. Le but de sa pratique de metteur en scène est d’obtenir pour le contenu de chaque œuvre une articulation formelle en profondeur, articulation qui s’étend jusqu’au moindre détail. C’est à travers cette articulation que les effets scéniques, le jeu des comédiens et le texte se constituent en une unité qui est plus que la somme des moyens es thétiques employés. Pour Christian l’articulation et l’unité sont fonction de la vérité qu’il s’agit de trouver sur la scène. L’esthétique est fonction de l’éthique : c’est ce qui explique son in transigeance, sa haine viscérale à l’égard d’un théâtre qui cache sa futilité en multipliant les effets. Un tel théâtre ment, et parce qu’il ment, il devient monotone, aussi importante que soit la quantité ou la qualité des moyens employés
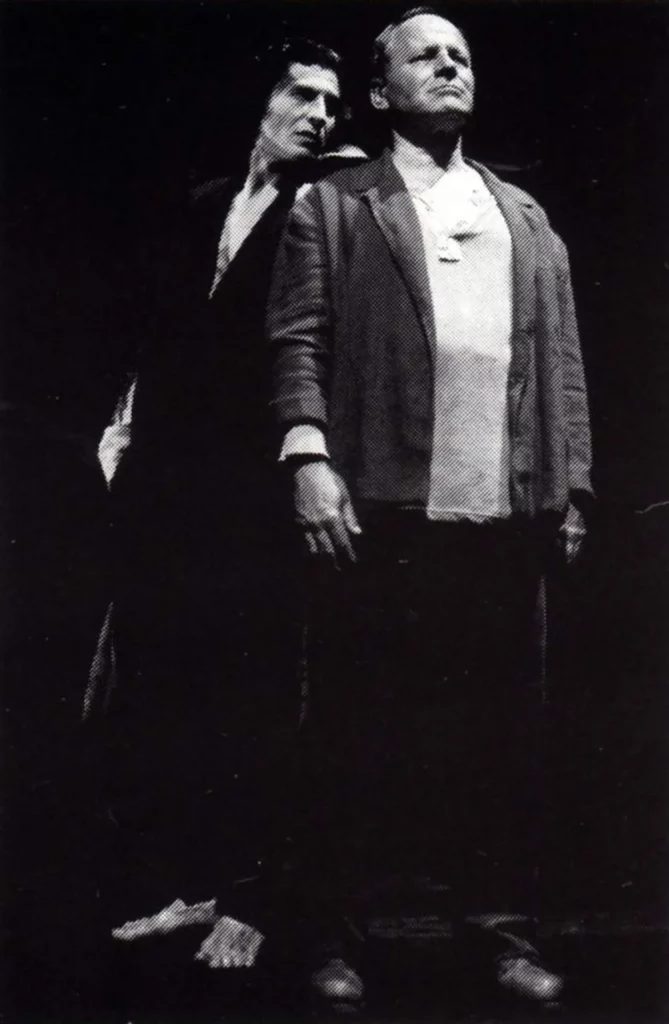
On ne devient pas artiste quand on n’est pas artisan. Et on ne devient pas homme de théâtre en poursuivant une carrière rectiligne : « Dieu écrit droit en lignes courbes », dit un proverbe portugais. Le chemin qui a mené Christian à la mise en scène est tout sauf rectiligne. Certains éléments dans sa biographie me rappellent la trajectoire de ce jeune ouvrier, personnage principal du grand roman de Peter Weiss : L’ESTHÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE. Issu d’un milieu ouvrier, il s’est mis à étudier et à s’approprier avec acharnement une culture qui ne lui était pas forcément destinée, en y cherchant les vérités qui le porteraient plus loin, vers la sienne propre qui ne sera jamais celle d’un bourgeois. Et parce qu’il a toujours été conscient de la nécessité du savoir, il a étudié à l’université la philosophie et la littérature. Pourtant, il reste « métèque » comme il a l’habitude de dire, étranger dans son pays même. Sa marginalité n’est pas un jeu narcissique mais l’expression constante d’une attitude critique.
Un jour à l’Atalante je l’ai vu travailler avec son père. Ils étaient en train de construire les décors métalliques pour ROSEL et DOUCE NUIT. Christian avait un chalumeau à la main et il soudait le métal avec la même patience, le même acharnement tranquille, la même concentration sereine qu’il montre quand il étudie un texte ou quand il dirige les comédiens. S’il dit de lui-même qu’il est d’abord artisan, ce n’est pas un vammot, c’est la vérité.
Metteur en scène, ouvrier, technicien, scénographe, comédien, pédagogue, — aussi jeune qu’il est, Christian a une profonde connaissance des possibilités matérielles du théâtre : c’est un artisan polyvalent qui a fait son apprentissage souvent d’une manière douloureuse. Il est difficile de cirer la charrette en marge des institutions, mais pour avoir suivi aussi des chemins marginaux, je pense que cette expérience a été indispensable. Elle nous donne une endurance, une soif de liberté qui ne mourront pas cane que nous garderons le souvenir de nos origines.
Il est temps de parler du lieu de nos angines artistiques communes : l’Atalante. C’est là, dans ce théâtre minuscule situé dans les sous sols du Théâtre de [‘Atelier que Christian a développé, au fil de ses mises en scène, sa conception du théâtre, tout comme Agathe Alexis et Alexis Barsacq la leur, tout comme moi la mienne. Est-ce au hasard qu’on doit notre rencontre) Quant à moi, pauvre chleu en rade, je ne le sais pas. Mais il est sûr que malgré la diversité de nos origines, nos points de départ étaient proches. Chez tous ceux qui ont fait partie de l’équipe, il y avait le même désir d’expérimenter le monde en osant expérimenter sur le plateau, la même volonté de lutter contre une pratique théâtrale affadie par les compromis et les compromissions mondaines, la même intention de sauve garder les dimensions sociales, politiques, éthiques du théâtre. Nous étions pauvres, beaucoup d’encre nous le sont toujours, mais cette pauvreté a été notre richesse : elle nous a obligés à être ingénieux. C’est la ruse de la raison. On aurait bien voulu y faire aussi du théâtre pour les pauvres, mais les pauvres ne sont pas venus. Nous n’avons peut-être pas assez employé de ruses pour les faire venir. En cout cas nous n’avons pas échappé au dilemme fondamental qui caractérise de celles entreprises : l’Atalante était notre bastion, mais aussi notre ghetto, un lieu qui neutralisait les effets de notre travail. Ou comme le disait Christian dans une interview accordée à une revue de théâtre allemande : « l’Atalante est mon lieu de résistance, mais je ne sais pas très bien à quoi je résiste. Tout est si mou. »
Pourtant, rien au monde ne nous coupera de ce lieu. Il est comme le petit creux de mes deux mains jointes : je souffle dedans et j’ai chaud.
Né le 28 août 1955.
Études universitaires de 1973 à 1980 :
Licence de Philosophie.
Maîtrise de Philosophie sous la direction de F. Chatelet, sujet :
« Culture et contre-culture et sous-culture »
Licence de Lettres, Université de Censier Paris III, cours de B. Dort, J. Lassalle, A. Pavis, A. Tissier, R. Monod.
Maîtrise d’Études Théâtrales dirigée par B. Dort, sujet :
« Conservatoire national, quel projet théâtral)».
Formation théâtrale de 1975 à 1983 :
Assistance technique et administrative au Festival d’Automne à Paris.
Permanent au Théâtre École de Montreuil, animateur, comédien, metteur en scène et gestion de la troupe, organisation de stages pour adultes.
Responsable d’ateliers pour enfants, et action d’éducation théâtrale dirigée vers les enseignants de la Seine Saint Denis.
Organisation d’échanges culturels avec d’autres villes françaises et étrangères.
Auditeur libre au Conservaroire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, classe d’Antoine Vitez, Jacques Lassalle, Claude Régy.
Enseignant au C. D. N. de Reims, direction Jean-Pierre Miquel.
Enseignant au Théâtre National de Strasbourg.
Cocréateur de l ‘École-Théâtre « La Belle de Mai » , Maison de la Culture de Créteil.
Assistant de J. C. Grinevald, D. Romand, A. Bénichou.
Écritures, adaptations :
Adaptations diverses de Vitrac, Artaud, Lorca.
Écriture : LA NUIT DU TAUREAU, 1982, LA TERRASSE, 1984, LE SERMENT D’ALDEBERT, 1985, LÉON LA FRANCE, HARDI VOYAGE VERS L’OUEST AFRICAIN, 1989.
Mises en scène :
1983
Création d’ARIAKOS de Philippe Minyana, au Théâtre du Quai de la Gare, Paris.
1984
Création de MONSIEUR VITRAC, d’après R. Vitrac, à la Maison de la Culture de Créteil.
Réalisation à la demande de la Maison de la Culture de Créteil, d’un spectacle d’élèves : LA CHUTE, d’après LE MOINE d’A. Artaud ; décor et mise en scène de C. Schiarecci.
1985
Création de la Compagnie Christian Schiaretti.
Création du JOURNAL D’UN CHIEN, d’après Oskar Panizza, au Théâtre de l’Atalante, Paris. Ce spectacle est sélectionné au printemps 85 par le Festival International de Parme, joué dans plus de vingt villes, il est accueilli au Théâtre National de Strasbourg, à l’automne 85.
1986
Mise en espace de SAPPA de Stéphan Schutz, Rose des Vents, C.A.C. de Villeneuve d’Asq.
1987
AJAX-PHILOCTÈTE de Sophocle, La Rose des Vents, Villeneuve d’Asq.
1988
ROSEL d’Harald Mueller à l’Atalante, tournée nationale et internationale.
ROSEL, film.
1989
LE ROMAN DE FAUVEL d’après Gervais Du Bus, Théâtre du Crous — Reims.
ÉPAVE d’Harald Mueller, Théâtre de la Tempête, Paris.
GÉNÉRATION DÉSINVOLTE d’après Alfred de Musset, Théâtre en Acte Paris.
LÉON LA FRANCE, HARDI VOYAGE VERS L’OUEST AFRICAIN de Christian Schiarecci et Philippe Mercier, C.D.N. Angers, Paris et tournée nationale.
1990 :
LE LABOUREUR DE BOHÊME de Johannes von Saaz, C.D.N. de Reims, T.G.P. de Saine-Denis, tournée nationale. ESQUISSE POUR UN CHŒUR EUROPÉEN de Jean-Pierre Sarrazac. Mise en espace. Festival d’Avignon
1991 :
MÉDÉE d’Euripide à Saine-Quentin en Yvelines puis à la Comédie de Reims.