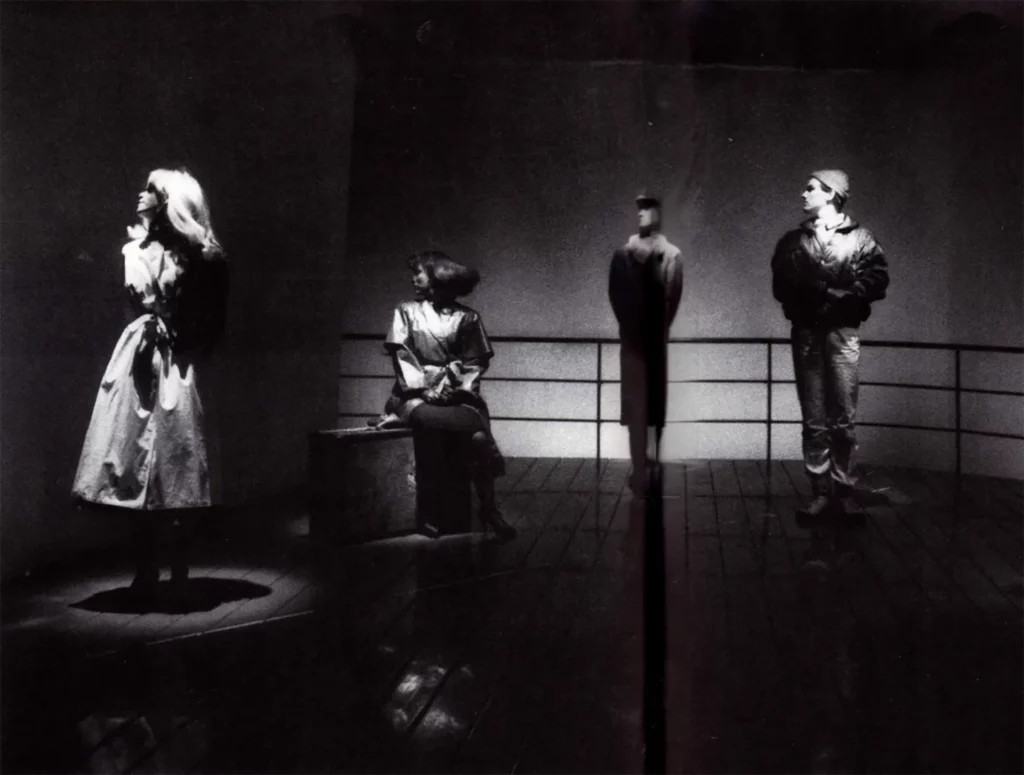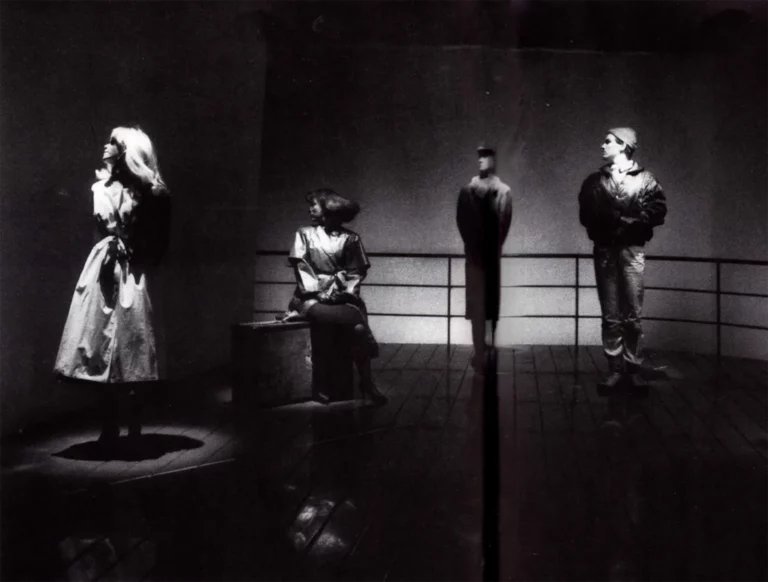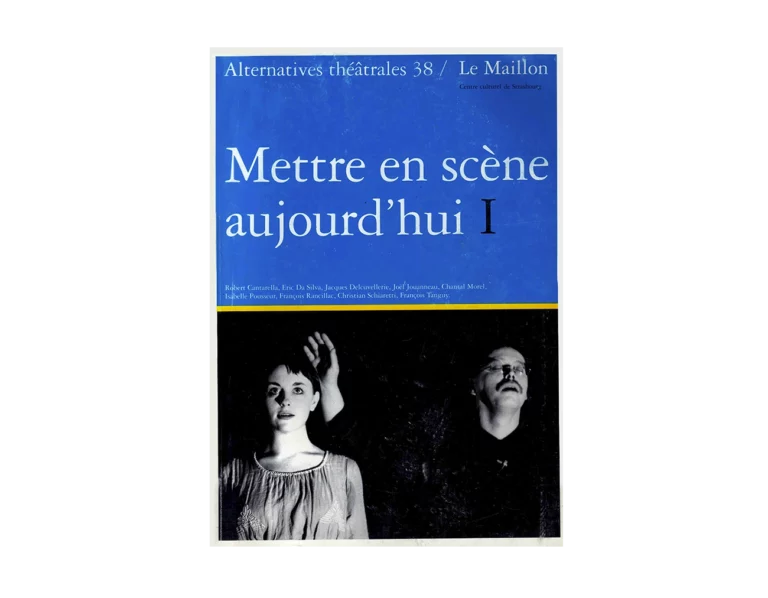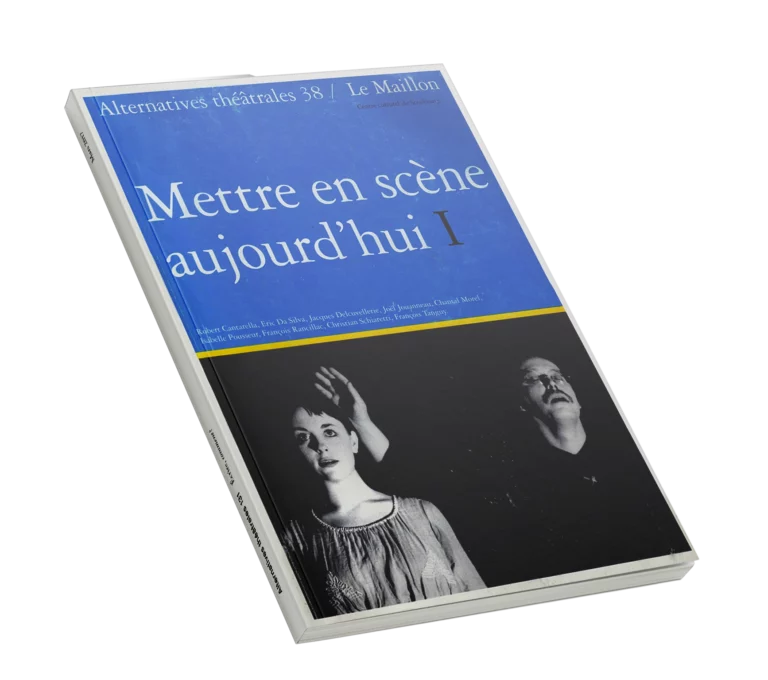Fin juillet 1990, le Centre dramatique national de Reims vit son existence mise en péril. La Ville de Reims et l’État semblaient, quant à son devenir, sur un point de non-retour. Consulté à ce sujet, je déposai, début août, un projet, suivi quelques mois plus tard de l’annonce effective de ma nomination. Ce projet était composé de considérations sensibles sur le métier de théâtre et d’une analyse plus technique de la situation rémoise.
J’offre en lecture aujourd’hui les considérations sensibles de ce projet : quelques mois ont passé depuis sa rédaction, beaucoup de pratiques déjà, un sentiment de vieillissement profond, et, parfois, la peur d’être devenu ridicule
Christian Schiaretti
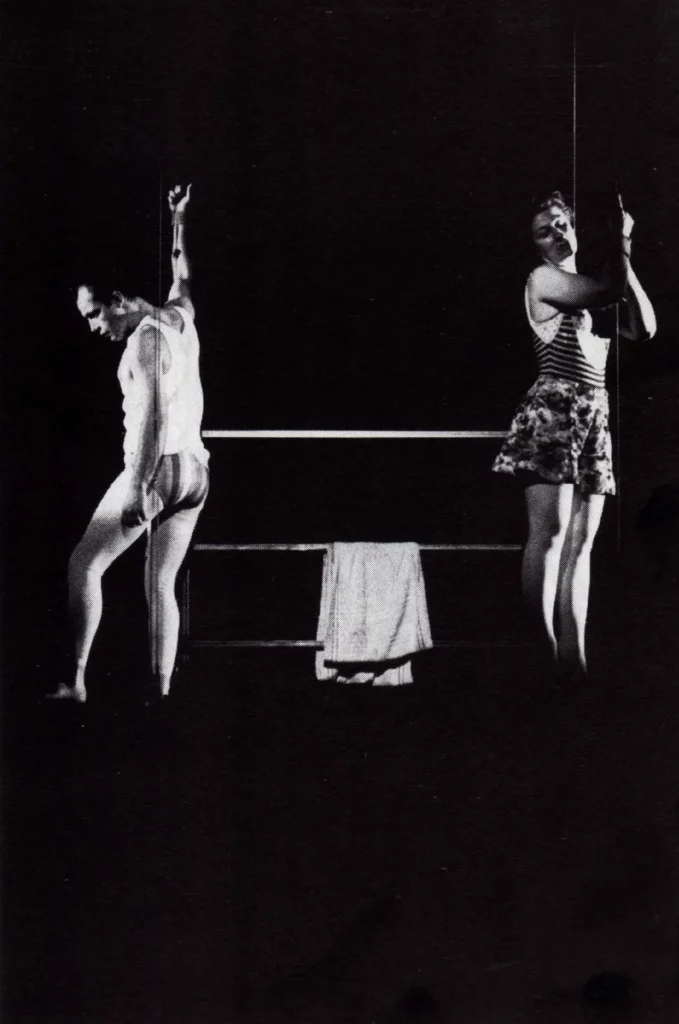
Lettre à Monsieur Bernard Faivre D’Arcier, Ministère de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire
Ma candidature à la direction d’un Centre dramatique national peut apparaître à la profession et à moi-même comme un acte inattendu et précipité ; cette perception est déterminée par un moment de notre métier où l’attentisme domine, où le renouvellement des propositions semble absent. Spectateurs de notre seul désarroi nous ne pouvons envisager à la tête des institutions nationales que des compétences largement confirmées. La profession n’a pourtant pas manqué de produire chaque année des talents nouveaux, mais ces talents, force est de le constater aujourd’hui, n’ont jamais constitué une véritable relance. Cela voudrait-il dire qu’entre la conscience profonde de la mission théâtrale et la reconnaissance ponctuelle de talents nouveaux il y aurait un gouffre que le temps n’a fait qu’agrandir et dans lequel maintenant nous risquerions tous de tomber).
Tout se passe aujourd’hui comme si ce métier, et avec lui ses institutions, n’avait su préparer son avenir, c’est-à-dire le former, c’est-à-dire y être attentif, c’est-à-dire replacer chaque création dans un mouvement plus général mais aussi plus essentiel, celui de l’histoire théâtrale. Qui aujourd’hui dans ma génération considère sincèrement les centres dramatiques comme un héritage historique.
Il me semble que le théâtre des dix dernières années s’est plus posé le problème des carrières que des histoires théâtrales ; nous nous sommes plus préoccupés de l’esthétique de nos productions que de l’esthétique de nos gestes théâtraux. Nous étions plus inquiets de nos carrières que de nos légendes.
Ces dix années de théâtre passées ont vu la lente mise en place d’une création de plus en plus centralisée. Paris et ses dépendances festivalières devenant la seule référence possible, l’idée de décentralisation s’achemina ridicule, le mot de province de vint amusant, celui de Paris absolu. À l’intérieur même de la capitale il y avait les Parisiens de Paris et les autres, la création allait se reconnaissant non pas selon ses contenus, mais selon ses contenants ; l’important n’était plus ce que l’on parlait mais là où l’on parlait, nous en arrivions à ce paradoxe qu’il valait mieux subir un échec dans un lieu fréquenté qu’une réussite dans un lieu méprisé. Bref l’époque était au médiatique, ce qui était à voir était vu, nous nous perdions en verdurinesque conscience, les services allaient se développant, un spectacle était avant tout une machine stratégique, un lieu une base, un C.D.N. de l’argent et la profession par je ne sais, ou je ne sais que trop bien, quel esprit suicidaire encourageait les envies de compétition contre les envies d’émulation ; rois d’une saison, mendiants d’une autre, nous lisions LA DÉFAITE DE LA PENSÉE et voulions être de tous les coups.
De la formule « Élitaire pour tous » nous comprenions fort bien le premier terme mais refusions de nous poser la question de ce que pouvait signifier le second, et la formule se transformait pour certains en un implicite « Élitaire pour moi » acheminant le pays, c’est-à-dire la capitale, vers une culture à deux temps, un cercle restreint s’auto-choisissant et se réjouissant de spectacles fort bien mais sans projet, et une masse inter dite vers laquelle se tournait un théâtre inspiré de vedettes de films simplets comme si l’apparition de ce résidu télévisuel sur les planches assurait la légitimité de notre volonté théâtrale.
Cette démission du théâtre et du sens, cette inflation du spectaculaire ramena l’ambiance théâtrale au plein XIXe siècle. Devant l’absence de discours on proclamait l’ère des metteurs en scène abolie, l’ère des acteurs revenue, quelques noms faisaient les succès, quelques lieux la re nommée. La génération née de la contestation accouchait d’une génération médiatique, il fallait pour garder son authenticité accepter le silence, inventer ses propres certitudes, inventer sa résistance, inventer ses propres armes.
Et c’est ici que ma candidature peut apparaître inattendue, mon parcours théâtral à ce jour se définie par une attitude constamment réactive au processus modal donc je viens de parler ; issu du théâtre amateur et universitaire je n’ai jamais vraiment pu m’inscrire dans le concert clinquant des coups théâtraux, j’en fus exclu de fait. J’appris mon métier sur le tas, souvent dans la difficulté, apprenant peu à peu que l’artisanat est la seule réponse possible au galop des productions, que le théâtre est aventure humaine, que le mépris ne peut être vertu au théâtre, qu’un metteur en scène est aussi un patron et que sa fonction (qui n’est qu’une fonction) ne s’épanouit vraiment que dans une connaissance irisée de tous les métiers qui rendent un spectacle possible.
On pourrait d’ailleurs imaginer que le système des compagnies subventionnées aurait dû développer ce type d’apprentissage et surtout sa reconnaissance ; allant du « en commission » au « hors commission » , les directeurs de ces compagnies auraient dû constituer la relève qui semble manquer aujourd’hui, mais l’écart entre les pratiques institutionnelles et les pratiques de compagnie accentua au contraire l’incompréhension et le mépris réciproque, développant soit la recherche de la coproduction à tout prix, soit le renfermement sur soi, un peu comme s’il manquait une marche au processus. Assumer avec rigueur morale la continuité du travail de compagnie s’accordant mal avec les exemples de dérives morales nationales, j’ai bien failli pour ma parc cé der à l’abandon pur et simple si la rencontre avec d’autres compagnies et notamment celle des Matinaux ne m’avait donné la confiance nécessaire, l’exemple, et surcout le moyen, une salle, de partager une politique, politique modeste, mais politique tout de même.
Quand je parle de politique à l’Atalante je ne veux pas dire que les pratiques que nous y avons inventées étaient la conclusion d’une réflexion préalable, ce fut un fruit pragmatique, nous appliquions réactivement notre sensibilité à la situation précédemment décrire ne sachant pas vrai ment où nous voulions aller, sachant toujours ce que nous ne voulions pas imiter.
Bien que parisien, ce petit lieu faisait partie des lieux hors-Paris et c’est en nous enfermant sur notre pratique, en défendant des venus que d’aucuns nous déconseillaient que ce lieu était devenu exemplaire. La profession dans son hystérie définissant chaque saison, dans ses embruns que sont cafés, restaurants et soirs de première, des stratégies obligées à coure terme ; notre expérience ne voulue y souscrire. Notre attitude relevant du long terme, l’Atalante prit ces stratégies à contre pied affirmant ses fidélités, ses scrupules, et s’y tenant ; quine à y perdre des coproductions, sachant, et c’est là le fond de sa politique, qu’un spectacle n’est pas une performance mais l’expression ponctuelle d’une morale continue, et que les spectateurs professionnels ou non applaudissent autant le travail ponctuel que la tenue morale d’ensemble. La morale ne peut s’accommoder de la stratégie à court terme, elle ne peut calculer ; la morale est exigence, c’est une sensibilité.
Pratiquement l’Atalante était le regroupement d’individualités mettant en commun leurs forces de travail, leurs capacités, leurs subventions au service d’un lieu et non d’un public, nous n’en avions pas ; ce lieu, petit, détermina notre style, notre écriture scénique. Je pense, et cela est aussi affaire de morale que la mise en scène doit partir des moyens offerts et les négocier avec intelligence, c’est cela un spectacle, il ne s’agit jamais d’être génial, toujours d’être ingénieux ; la mise en scène devient alors un travail, le metteur en scène un artisan, le terme de créateur à l’Atalante ne pouvait se régaler d’un égocentrisme prétentieux car la présence de l’autre et la gestion de tous les postes qui rendaient chaque soirée de représentation possible était une limite obligée à l’affirmation débordante de soi. Et c’est cela, qui n’est rien d’autre que la définition du métier théâtral, qui devine exemplaire et conquit un public. L’aventure de l’Atalante de vint alors notre capacité, malgré succès et sollicitations, de rester fidèles à nos définitions.
Les sollicitations furent nombreuses, achats, coproductions, résidences fleurissaient mais ce fut un combat de tous les jours que d’affirmer que la reconnaissance de nos productions était aussi la reconnaissance d’une éthique de travail partagée et que cette éthique supposait la fidélité, se couper de cette réalité était se tuer ; certains comprirent d’autres pas.