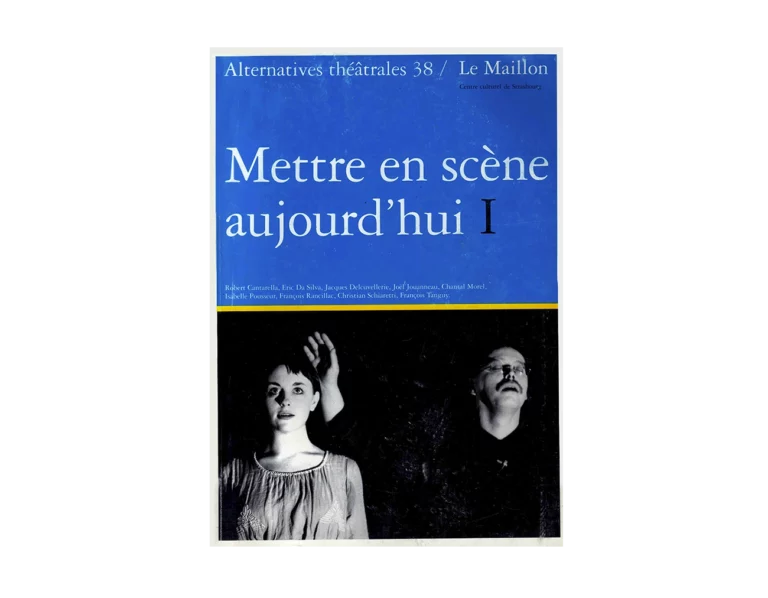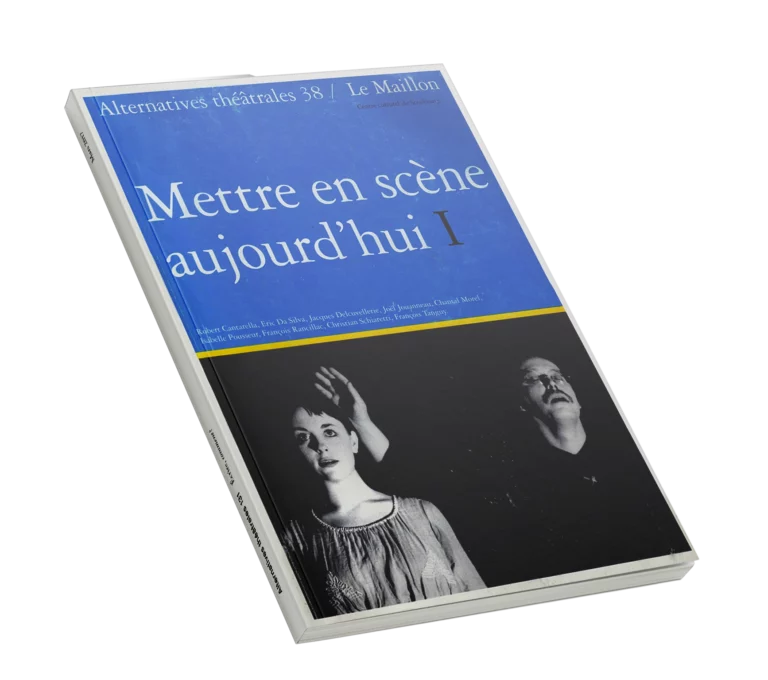Des tribus d’artistes ont fait du théâtre et proposé des univers et des spectacles tellement différents qu’il serait vain de chercher à les rapprocher. Parfois, il semble se dégager des couleurs communes, une cohérence morale, mais les années 80 ont plutôt donné naissance à des spectacles composites, multiformes, et non à des courants, des mouvements ou une esthétique dominante. Ce sont des langages très personnels qui ont émergé.
L’alternance des modes de représentation désoriente le spectateur qui, pour percevoir l’objet artistique sous un nouvel angle et sans grille de comparaison, doit laisser monter en lui une naïveté active. Elle donne au spectacle une légitimité intacte, sans forcément devenir la légitimité de la nouveauté. Il y a de l’influence partout ou nulle part, des dosages secrets d’une surabondance de références, le talent de certains metteurs en scène consiste justement à brouiller la piste dès qu’elle s’ébauche.
« Nous vivons avec quelques arpents de passé, les gais mensonges du présent et la cascade furieuse de l’avenir. Autant continuer à sauter à la corde, l’enfant-chimère à notre côté. » René Char
Un artiste attiré par le vide marche sur une scène où tout est à refaire, à transformer et peut-être encore à créer. Il commence à parler d’énergie de l’acteur, du plateau, de la lumière, à constituer des couples qui deviendront des duos.
Même s’il a la mémoire qui flanche, son théâtre est encore animé par une étincelle, une idéologie, un rapport au social. Cependant, sans occulter la nécessité du théâtre dans la cité, le moteur de sa créativité n’est plus issu d’une réaction, d’une colère, d’un dialogue avec les mises en scène précédentes. Un rapport dialectique s’est perdu.
Il a grandi dans un monde théâtral où le metteur en scène était la figure qui comptait le plus, il a vu des acteurs se trémousser dans des sacs de pommes de terre et des danseurs trouver dans la comédie un nouveau domaine de liberté et de danger.
Dès lors, à l’aube des années 80, il a fallu se demander comment étonner encore, comment se positionner politiquement, comment relancer la conversation quand la dispute était finie.
La provocation s’épuise et, quand tout a été déstructuré, il est difficile de trouver une expression qui cherche encore à contredire, à déstabiliser. Après l’explosion des formes, quand le théâtre a été dynamité de toutes parts, quand l’espace de liberté créatrice s’est réduit à peau de chagrin, beaucoup d’artistes se sont demandé s’il restait encore des moulins à attaquer, des chevaux de bataille, ou s’il fallait prendre le maquis et clamer sa différence.
Pour faire du théâtre, ils devaient composer avec une histoire, des lieux qui n’étaient pas forcément les leurs, ils avaient été imaginés et bien imaginés par d’autres.
Sans se déterminer historiquement différents, ils se sont placés en rupture de culture volontaire et ont refusé de porter l’usure d’un terrain miné. Il ne s’agissait pas de prolonger des traditions, de considérer le théâtre dans sa pérennité, mais de parvenir à trouver l’accord avec son propre itinéraire artistique, politique, esthétique, sans plaquer la référence, sans singer la révérence, ou alors la montrer du doigt, la pointer dans l’harmonie d’un spectacle.
La terre tremble toujours, on se réchauffe encore des relents de la déflagration, mais on peut aussi parler d’autre chose.
Dans ce contexte, le fait d’être metteur en scène n’était ni réducteur, ni valorisant, même si cette fonction confère un statut et une autorité qu’il est encore difficile d’échanger ou de partager.
Certains metteurs en scène voulaient que leurs spectacles conservent une part d’insolence, de hardiesse, d’impertinence, sans proclamer le triomphe des formes somptueuses ou des déliquescences, sans que l’art de la scène soit inconscient de sa fonction d’éveil ; ils refusaient que le théâtre devienne un épiphénomène idéologique, construit en kit. Ils voulaient conserver coûte que coûte une rébellion farouche, un fond primitif d’engagement politique, tout en sachant qu’il s’exprimait plus clairement dans le cadre d’une répétition qu’une fois confronté à un public qui n’attendait plus forcément de réponses venues de l’art.
Un soir, un comédien m’a dit : « Comme tout est évidemment réussi quand on l’effectue en répétition ; on a l’impression qu’on va présenter le plus beau spectacle du monde ; une fois devant un public à l’aise et moqueur, tout ce qui dérange s’assoupit, l’impertinence lasse aussi. »
Le pire de ces lendemains était sans doute de sombrer dans une esthétique de la morgue et du déchet, du néon ou du carreau de faïence. Aussi, c’est en retrouvant un rapport charnel aux éléments du spectacle, c’est en tentant de rimer avec l’acteur qu’une grande sincérité s’est transmise.
On n’assiste pas forcément à l’avènement de l’acteur mais à la célébration d’un travail de recherche auquel participent les comédiens qui, dans un rapport de convivialité et d’interactivité, s’emparent des propositions du metteur en scène.
Dans LES PARISIENS1 de Pascal Rambert, les acteurs se déplacent comme des zombies, ils meurent enfin puis ne cessent de renaître. Quand il n’y a plus rien à dire, il reste encore une parole-sursis qui traverse le comédien et l’incite à se relever. C’est une véritable danse de mort qui, dans le jeu de l’acteur, n’intégrera jamais la nature environnante. L’acteur a volontairement peu d’appui ; au présent de la représentation, il profite joyeusement de cette indépendance.
Dans leur itinéraire artistique, plusieurs metteurs en scène ont senti la nécessité de travailler sur des petites formes et d’y revenir souvent – MONSTRE VA2, LÉON LA FRANCE3, LE BOURRICHON4… – en se disant que le public apprendrait à préférer un beau moment de théâtre à un grand ensemble signifiant avec un seul traitement de lumière, une seule image : « Je suis content, dit Robert Cantarella, de diriger trois actrices dans un spectacle où il n’y a pas d’effet de lumière, où la séduction ne passe pas du tout par la fascination de l’image. INVENTAIRE(S)5, c’est volontairement simple, j’ai eu envie de compliquer les choses, de les rendre plus intelligentes, avec Philippe Minyana on s’est dit qu’il fallait faire une chose extrêmement simple même si c’était une nouvelle étape. »
Ainsi, beaucoup de metteurs en scène ont tenté d’évacuer la notion d’objet artistique, de résultat, d’œuvres achevées ou en préparation ; elles étaient déjà inscrites dans un probable avenir ou la bibliothèque de Borges. C’était préférer un beau croquis de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine, la course vertigineuse de l’eau au moment précis où elle se glace. Ils se sont ainsi focalisés sur le processus créatif, la rencontre entre l’iode et le benzène plutôt que le précipité qui en résulte.