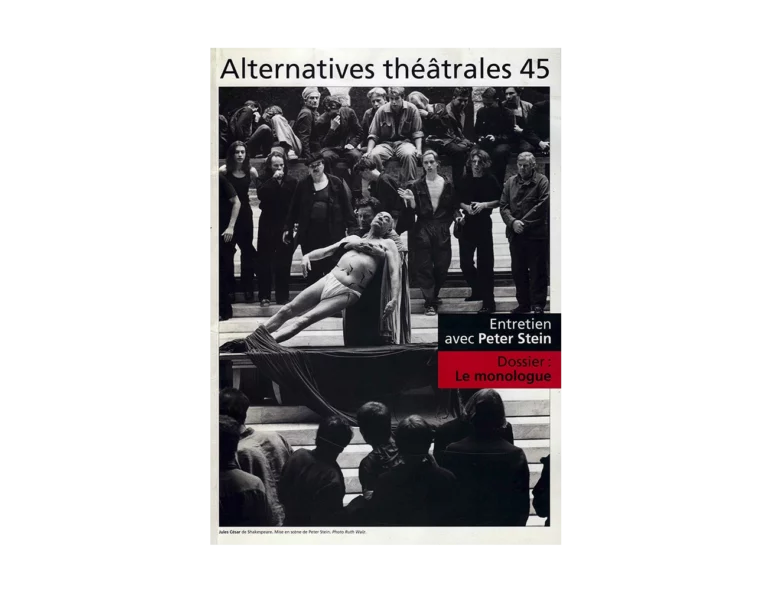PARFOIS, entre deux projets réalisés avec plusieurs interprètes, je prends le maquis dans des studios de répétition, pour laisser émerger des formes d’impudeur solitaire, avec quelque chose à dire qui doit se cacher avant de s’énoncer. Qui doit se préparer en douce… Des soliloques que Patrick Bonté et moi modèlerons ensuite, en les décantant, en leur forgeant un langage autonome, qui puisse être reçu dans le noir de la salle.
Cette fois, ne voulant pas projeter une image esseulée sur le plateau, et fascinée depuis toujours par les poupées, les marionnettes, les représentations anthropomorphes de tout poil, j’ai embrigadé dans l’histoire quelques mannequins articulés, liés à mon corps dans des positions siamoises diverses.
Je voulais évoquer avec eux le sentiment de démultiplication de l’être, donner vie à toutes les fripouilles qui encombrent notre moi, qui squattent nos gestes, l’une disant oui et l’autre non avec la même évidence.
Je retrouve donc régulièrement les « mannequins » dans le studio qu’ils habitent, je me glisse parmi leurs présences latentes. Troublant leur sommeil, je leur demande de provoquer en moi les gestes qui leur donneront crédibilité, qui rendront compte de leurs histoires enfouies.
Je peux, seule avec eux, prendre ce luxe : laisser des blancs, tourner en rond, ne pas savoir, croire trouver, faire mousser les quiproquos et les contradictions naissantes. Prendre du temps, du temps perdu, du temps qui stagne, du temps qui fait apparaître, qui sait, qui ne sait plus, du temps de solitude…
Les mannequins étaient censés être mes doubles, mais je me suis vite rendu compte que c’était moi qui devenais le leur : le rapport de force s’est inversé.
Car pour qu’ils vivent, il me faut retirer de mon jeu toute velléité volontariste, me vider, dirait-on, de ma substance, pour la laisser glisser dans leur peau. Suivre leurs cheminements, en absente écouter leur présence.
Notre association siamoise n’a rien d’évident. Ils s’emparent de mon épaule, de ma jambe, de ma tête qu’il me faut pourtant garder, nous devenons monstre à deux têtes, à trois jambes, à combien de mains ?
Ils me tiennent, ils mangent mes forces, n’ont aucun scrupule : ils donnent forme à ce que je n’osais évoquer, ou à ce que mon corps seul ne suffirait pas à engendrer.
Mais chaque acteur ne vit-il pas quelque chose de cet ordre quand il se prête à un rôle, quand il découvre la vie du personnage qui l’envahit ? Il a à créer des prolongements, des ramifications, des démultiplications variées selon l’œil du spectateur. À ouvrir l’image à des ailleurs qu’il ne maîtrisera jamais tout à fait, pour que « l’autre » irradie, qu’il existe pardevers lui.
Nous voulions intégrer clans le spectacle un deuxième personnage (un acteur enfoui sous une grande marionnette). Nous avions besoin d’un élément transitoire pour boucler une continuité, permettre des changements parfois longs entre les scènes. Peine perdue. Il s’est avéré nécessaire que le point de vue du spectacle demeure celui d’une solitude. De même, nous avons ôté du décor tout élément qui situerait l’action, qui définirait un espace où rentre, d’où l’on sort. Tout se déroule dans une seule tête, comme tout devrait défiler dans la tête d’un seul spectateur, de chaque spectateur isolément qu’il quitte sa position d’observateur, qu’il puisse projeter ses propres rêves et cauchemars, et que les marionnettes deviennent les excroissances de sa propre vie.
Un monologue, un solo, plus que toute autre forme de représentation, peut ne pas rester la parole de l’autre, là, sur le plateau. Le spectateur alors s’en empare, la fait sienne, s’y reconnaît, jusque dans la méconnaissance, la « mal connaissance » de lui-même. Il faudrait qu’il ne sache plus qui est en train d’agir, qui manipule qui, qui est à l’origine du mouvement — d’âme et de corps — , et qu’il ne perçoive plus ce qui produit la lumière et l’ombre : le faisceau des projecteurs ou le battement de ses paupières.