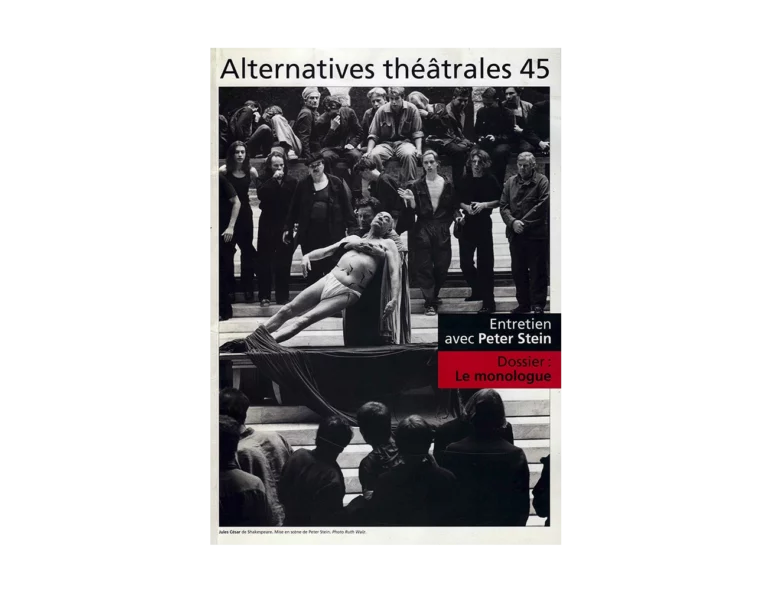On peut nommer cela horreur, ordure,
prononcer même les mots de l’ordure
déchiffrés dans le linge des bas-fonds :
à quelque singerie que se livre le poète.
cela n’entrera pas dans sa page d’écriture.
Philippe Jaccottet, À LA LUMIÈRE D’HIVER (Poésie/Gallimard, 1994)
MERCÉDÈS, le personnage principal d’UNE FLAMME DANS MON CŒUR (mais sans doute faudrait-il dire plus, Myriam Mézières, qui interprète le rôle, ayant elle-même écrit et proposé le scénario du film au réalisateur Alain Tanner), est comédienne de théâtre. Comédienne en répétition. BÉRÉNICE de Racine. Et sur la scène, la panne la plus improbable a lieu. « Que le jour recommence et que le jour finisse, / Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, / Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ? » L’alexandrin connu entre tous effacé incompréhensiblement et sans remède de la mémoire. Fêlure. Sous la voûte du crâne, la pierre a été ôtée qui en constituait la clé, c’est l’écroulement de la baliverne (j’emprunte ici le titre d’une nouvelle de Buzzati). Car plus qu’un blanc, voile opaque qui soustrait sans ruine l’objet à la perception, c’est une béance, la trouée obscure où s’abîme soudain l’édifice entier du théâtre.
Effondrement psychique de Mercédès et faillite du théâtre se répondent métonymiquement. Une exclusion symétrique (une expulsion plutôt, comme l’on dit d’un corps qu’il rejette une greffe discordante) sanctionne la défaillance et la déficience, le doute et le tremblement : Mercédès quitte sans retour le lieu où s’élabore le théâtre selon Racine, drame et dialogues. Et l’institution n’esquisse aucun geste pour retenir ou, plus tard, ramener à soi l’égarée. Comme si, entre théâtre et acteur, un lien pouvait seul s’établir sur ce qui, ailleurs, entre médecin et patient, entre amants, fonde la relation et l’échange : une confiance partagée. Mercédès, toutefois, foulera une autre scène.
Strip-teaseuse sur l’estrade d’un bouge de Barbès. Le partenaire de jeu, un gorille en peluche, dégradé en simple accessoire du plaisir, asservi aux égarements d’un corps qui puise dans le reflet de trente paire d’yeux ahuris la jouissance de son propre spectacle. L’obscénité fascine et éloigne tout à la fois. ( « On sent un remugle de vieux dieux » , écrit Philippe Jaccottet.) Ce que confirme, s’il en était besoin, le mouvement alterné de la caméra, champ / contrechamp, plan fixe sur le corps extasié s’exaltant, par delà l’illusion, à la rhétorique des « glissements progressifs » , plan fixe sur les regards médusés des spectateurs. (Une scène ultérieure du film proposera de cette séquence une lecture définitive : Mercédès se masturbant devant l’œil brouillé, affolement électronique, d’un téléviseur allumé très avant dans la nuit.) Sur les visages masculins tendus vers la scène, la crispation est la seule grimace aperçue. Des gestes, rires ou sourires qui scellent ordinairement en ces lieux une communauté énervée et salace, nulle trace, nulle ébauche. S’il est une sensation qui rassemble ici le public debout au parterre (comme c’était l’usage autrefois clans le théâtre à l’italienne), c’est l’effroi seulement, la stupeur devant la violence que scandent les pulsations, inouïes aussi bien, de tambours rythmant la dénudation du corps : le spectateur assiste terrifié à un culte auquel il ne participe plus que par son évidente exclusion, une manière d’acte cérémoniel a lieu qui ne lui est plus destiné, outrepassant, outrageant les limites anodines de sa lubricité tôt éteinte. Entre les planches mal ajustées de la baraque de foire, le monologue du désir a convoqué l’obscène.
L’innommable. La mort. Dieu peut-être. Théâtre encore ? Mercédès l’affirme.
« Jouer Racine, faire du strip-tease pour les immigrés de Barbès, il n’y a pas de différence. » S’il y a identité des deux termes, on sera autorisé cependant à déchiffrer derrière le choix de Mercédès (le gorille de préférence à Titus, le strip-tease plutôt que la tragédie classique) l’aveu d’une déception.
Le monologue (et je veux considérer le strip-tease de Mercédès comme l’un de ses avatars, sa forme quintessenciée peut-être, la variété qui s’oppose au récit du conteur), le monologue dénoncerait-il en quelque façon l’échec du théâtre bien plus qu’il n’en proclamerait (ou n’en hâterait, selon Peter Stein) la mort Mais s’il révèle une attente déçue, quel échec objectivement ? Sans doute serait-il plus opportun d’avancer que le monologue établit ses quartiers aux marges où vient s’échouer un projet (comme le projectile, le projet peut manquer son but), aux lieux de l’inadéquation d’un moyen (le théâtre) et d’une fin (le dit d’un moi que dévaste le désir infini).