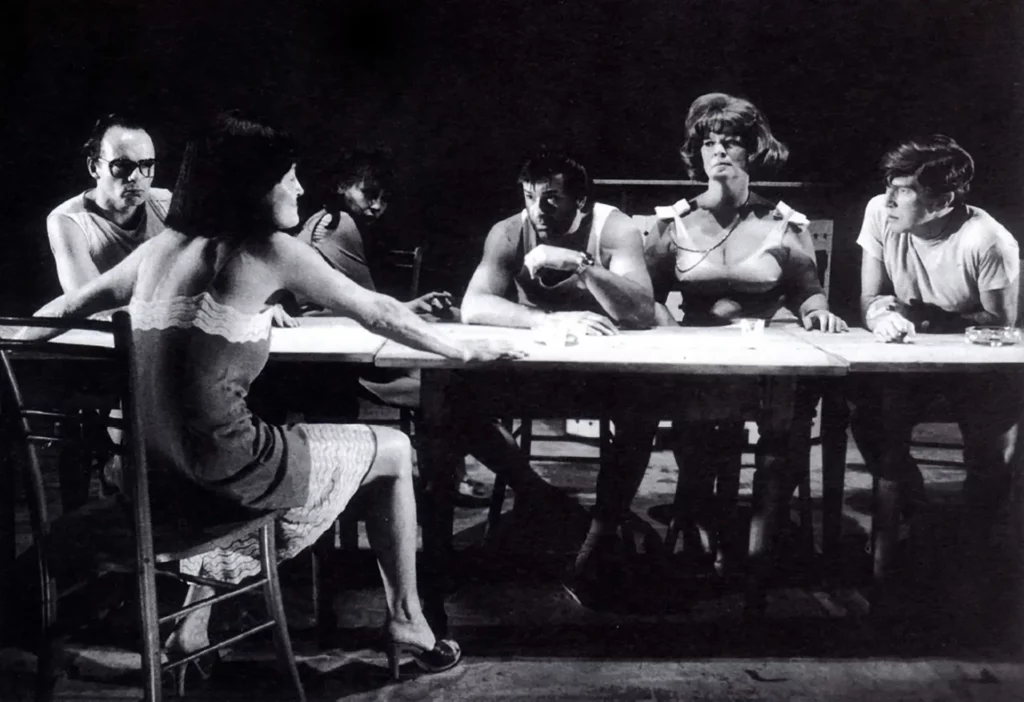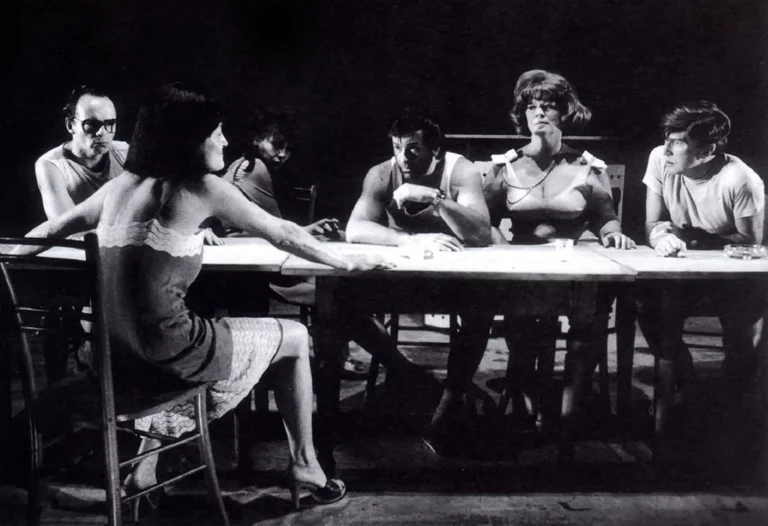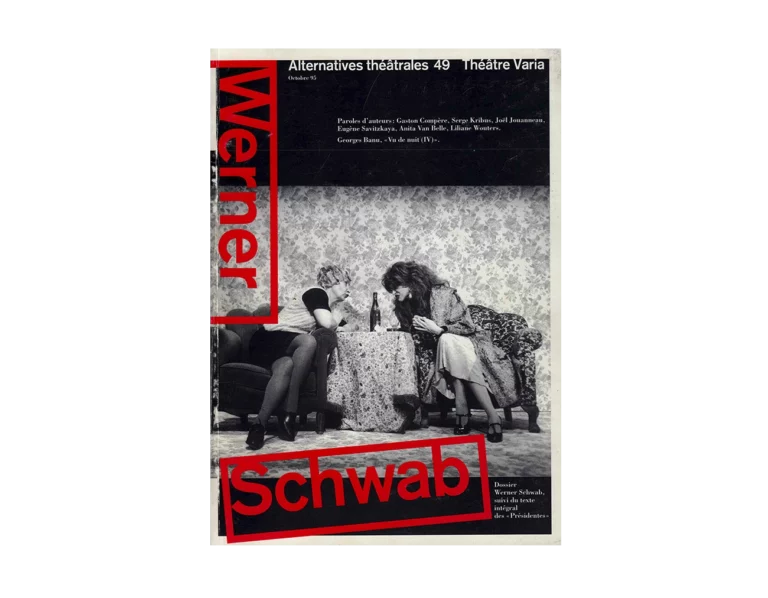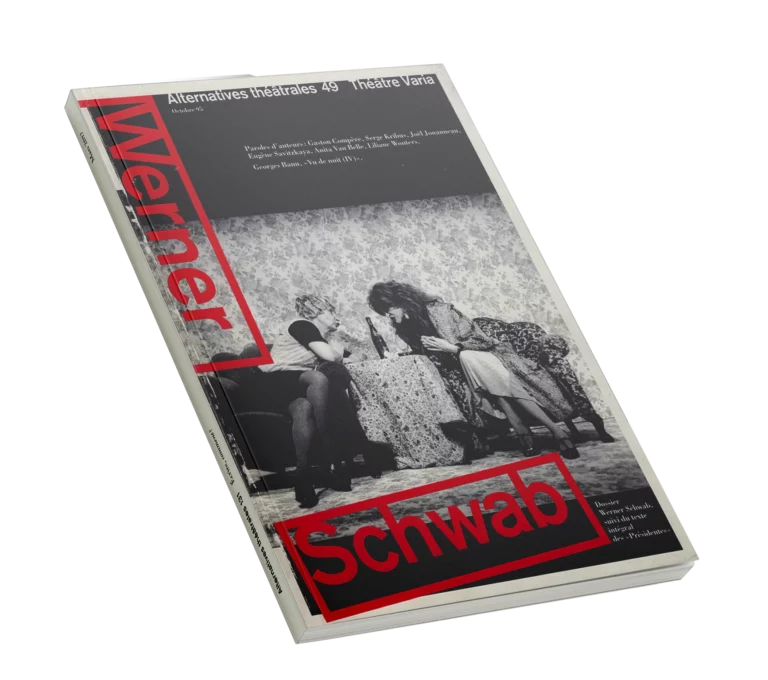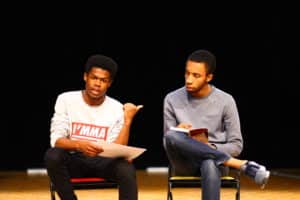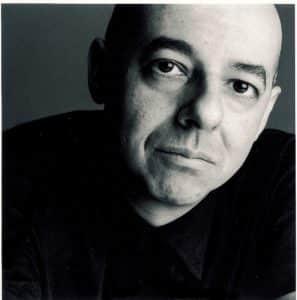INGERBORG ORTHOFER : J’ai rencontré Werner en 1976 à l’École des Arts Appliqués de Graz, un pôle d’attraction pour les artistes en herbe. Werner avait alors 18 ans, moi j’en avais 16. Werner m’intriguait car il y avait en lui un curieux mélange. Il avait des qualités intellectuelles certaines, il savait bien mener le débat, argumenter ; ce qui lui a valu pas mal d’ennemis. En même temps il était très maladroit, c’était un ours mal léché. Il était dans la section « sculpture », et moi dans la section « métal ». Puis il a quitté l’école de Graz pour étudier pendant deux ans à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne.
Une fois que nous avons appris à connaître le milieu artistique, nous avons décidé de ne pas jouer à ce jeu-
là. Alors nous avons cherché une petite maison à la campagne, en Styrie de l’Est, et nous avons rompu tous les ponts avec le monde extérieur. La littérature et la musique étaient les seules choses qui nous restaient.
C’était un choix radical. Nous avons beaucoup parlé du fonctionnement de la langue, de la philosophie, car là-bas les gens travaillent et pensent de manière totalement différente : ils n’ont pas du tout la même notion du temps et de la vie en général. C’était nouveau et fascinant pour nous. Par exemple, un jour, un paysan nous a rendu visite et nous a parlé de l’âge des arbres. Il n’a pas dit : « cet arbre a tant d’années », mais : « cet arbre est vieux de trois vies ».
Pour Werner la langue était comme un bloe de pierre dans lequel il faut tailler. C’est à la campagne qu’il a réellement développé l’aspect constructiviste de son écriture. Il a pour ainsi dire dépouillé la langue de sa chair. Il l’a « purifiée » pour exprimer l’essentiel. À un moment donné il a également renoué avec la sculpture des matières périssables. Il pulvérisait des os et gardait les déchets de viande, des abats de poules, vaches.
cochons, certaines parties du lièvre. C’était en même temps hautement esthétique et naturel.