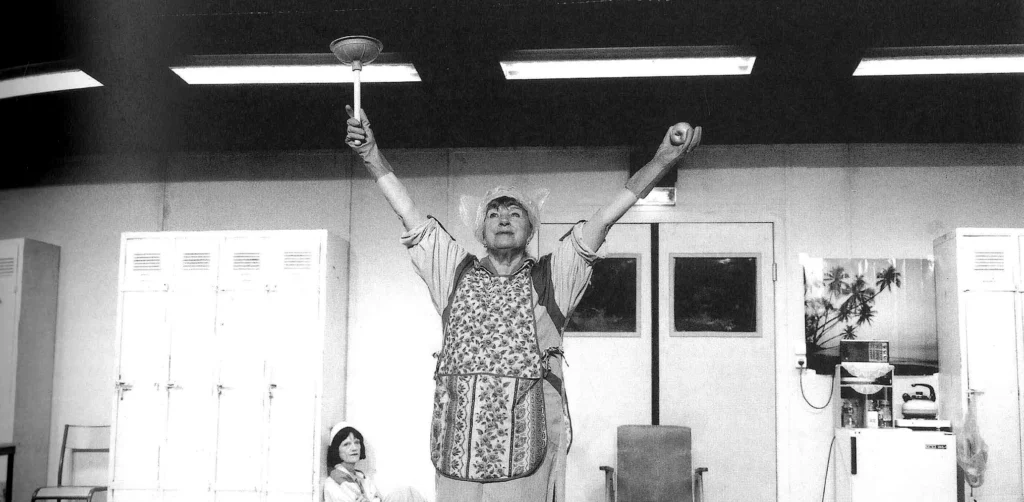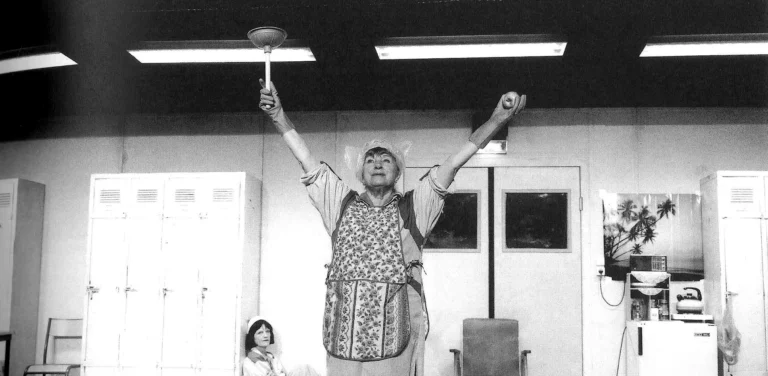BARBARA ENGELHARDT : Dans les années quatre-vingt, on a souvent dit, dans la revue Theater der Zeit notamment, qu’il y avait en Allemagne de l’Est une série de jeunes auteurs dont les pièces n’étaient jamais jouées, et qui risquaient de céder au découragement et de se résigner à rester dans l’ombre. À côté des noms de Hein, Bez, Seidel, Koerbl, etc., on trouvait aussi le tien. À cette époque, tu avais déjà écrit plusieurs pièces, tu n’étais donc plus un débutant. Comment vivais-tu le fait que tes pièces ne soient pas jouées ?
Lothar Trolle : Ne pas être joué n’était pas un vrai problème. Quand j’étais à l’école, je voulais déjà devenir écrivain, je me suis assis et me suis dit : maintenant, je dois écrire. Pourquoi ce sont des pièces que j’ai écrites, je ne le sais pas moi-même. À vrai dire, je n’y connaissais rien, alors même que je travaillais comme machiniste — et je ne sais pas non plus comment j y suis arrivé — depuis un an au Deutsches Theater.
Être monté dépassait ce que je pouvais imaginer, je ne l’envisageais même pas.
Ça avait quelque chose à voir avec une sorte de dégoût : nous étions au fond tous contre tout, en même temps membres de la FDJ1, mais en fait toujours contre l’État.
B. E.: Ton rejet de tout ne consti-tuait pas pour autant une prise de position politique résolue ?
L. T.: Non, au début, c’était plutôt un rejet primaire : ce n’est que plus tard que nous nous sommes mis à lire.
Pour notre génération, le théâtre avait depuis longtemps perdu le contact avec la réalité parce que, entre autres, il ne jouait pas les pièces des nouveaux auteurs. Tout au plus Helmit Baierl ou Joachim Knauth, mais eux mis à part, nous n’imaginions pas voir nos pièces jouées un jour.
B. E.: Tes pièces ont été créées lors de ces spectacles typiques de la fin du régime (organisés par exemple par Wolf Bunge à Gera, ou à Schwerin, plus tard à la Volksbühne de Berlin) en même temps que celles d’Heiner Müller.
Ces manifestations sortaient de la programmation normale, on les nommerait aujourd’hui « events ». On y « ficelait » plusieurs jeunes auteurs que l’on montait ensemble. Cela a‑t-il créé chez toi le sentiment d’appartenir à une génération de « jeunes auteurs » ?
L. T.: Nous avions tous ce senti-ment. Je n’ai longtemps écrit que pour des amis dont le jugement me suffisait.
Mais on ne montait pas les pièces que nous écrivions. Heiner Müller est sorti le premier de ce cercle plutôt douillet, quand il fut joué. Cela créa quelques connections avec l’ouest qui nous apportèrent un peu d’argent. En 1979, pour l’anniversaire de Heiner Müller, Wolfgang Storch coordonna une publication à l’ouest qui comprenait quelques-uns dé mes textes. Grâce à elle, mon travail a alors vraiment pénétré dans le milieu littéraire, cela comptait plus que tout. Mais mes pièces n’étaient toujours pas jouées. Quand ensuite de nombreux amis partirent subitement, j’ai pour la première fois été complètement perdu. Parce que je n’avais plus de public. Ma famille se trouvait là-bas, je devais alors vraiment m’appliquer, et j’étais naturellement très heureux que ces spectacles aient lieu.
B. E.: Dans les années quatre-vingt, tu as tenté, avec d’autres, de créer une nouvelle manière de diffuser la littérature, et tu as lancé une revue : MIKADO. Combien de temps avez-vous pu exister en marge de la presse officielle ?
L. T.: Quatre ans, cela s’est terminé en 1987.
B. E.: Dans le dernier numéro vous avez écrit une préface qui développait un concept de la contre-diffusion qui ne reposait pas sur des motivations politiques. Le but était de faire circuler ce que vous écriviez, et qui n’aurait autrement pas trouvé de public, dans un petit cercle de lecteurs établis principalement dans le quartier de Prenzlauerberg à Berlin.
L. T.: La visée n’était pas d’être politiquement actif, mais en décalage, et de produire selon nos critères des textes qui possédaient une qualité littéraire. Il nous importait de ne pas nous laisser guider par ces contraintes. Plutôt jeter à la poubelle nos écries, que de se soumettre aux courants dominants.
B.E.: Tu as donc vécu comme contrainte le « politiquement correct » dans un sens double, à la fois dans un esprit officiel et dans une attitude d’opposition manifeste.