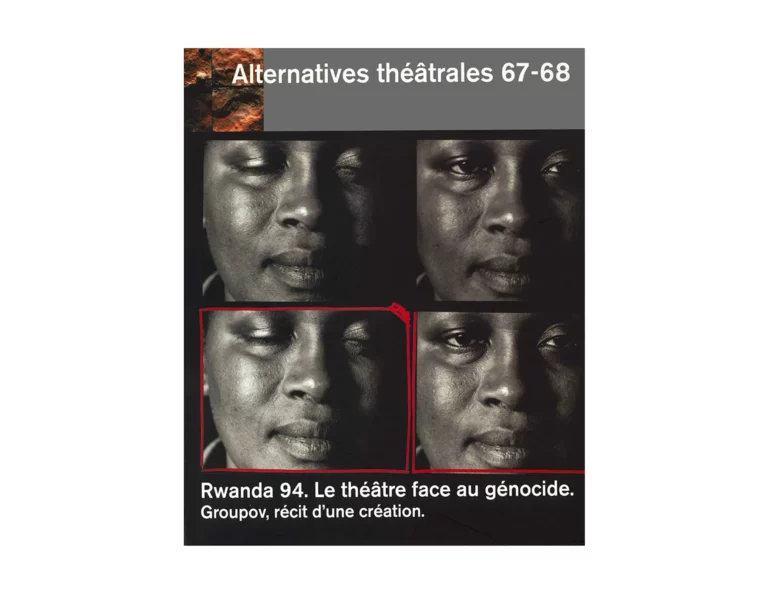DIMANCHE 19 JUILLET 1998.
Première rencontre avec Tharcisse Kalisa. On remonte toute la route « Kadhafi » (avec la mosquée en perspective) jusqu’au Collège Saint-André. Tharcisse est un des rares hommes de théâtre africain à disposer d’une salle permanente ; une belle et grande salle genre paroissiale, avec un plateau de belle taille, un dispositif d’éclairage modeste mais suffisant, une capacité de public de trois cent à quatre cent places. On la découvre au bout d’un chemin, à l’intérieur même du vaste domaine du Collège (sept cent-cinquante étudiants, mais moitié moins que ce qu’il a pu héberger dans le passé), jouxtant de vastes entrepôts devant lesquels stationnent d’énormes camions transporteurs venus de Tanzanie ou du Kenya (durant toute la durée de notre séjour, ils chargeront des centaines de tonnes de denrées alimentaires destinées, nous explique-t-on, à un ensemble de collèges et d’institutions religieuses du pays). Le recteur du Collège, le Père Jean-Chrysostome fait partie du comité d’accueil qui est d’une grande cordialité. Quant à l’accueil de Tharcisse, il est tout simplement princier, c’est un patriarche au milieu de sa troupe ; beaucoup l’appellent « grand père », signe de respect ; il fait passer d’emblée un courant de puissante sympathie.
Dans la salle, on s’affaire, sous la conduite de Jeanne1, collaboratrice directe de Tharcisse, manifestement cheville ouvrière de la troupe.
C’est un jour réservé aux femmes (chaque jour se succèdent aux répétitions des groupes d’hommes, de femmes ou de groupes mixtes qui travaillent sur des répertoires de danse, de chant, de poèmes ou de textes différents).
Le groupe de douze à quinze actrices est disparate tant en âge qu’en qualité. Certaines en sont au début de leur apprentissage et donnent à l’ensemble un aspect quelque peu amateur. Les physiques sont extrêmement différents (impossible d’y distinguer Hutu, Tutsi ou Twa). On remarque cependant d’emblée deux jeunes filles qui portent leur art à un haut niveau ; or la danse qui s’effectue demande un engagement et une implication physique très aigus.
L’une de taille relativement petite, au physique très solide, cheveux courts, très crépus, coupés strictement, danse cependant avec une grâce particulière, une certaine majesté, en tout cas beaucoup de sérieux : « elle est là », tout le temps, d’une présence remarquable, tout semble « juste », fait avec soin, d’une grande beauté scénique. L’autre, plus élancée, plus élégante, chevelure défrisée et travaillée, joue remarquablement sur la séduction de la danse, les ruptures de rythmes, d’audacieuses avancées sur l’avant-scène.
Sur les premiers sièges de la salle, un groupe de femmes plus âgées et d’hommes d’âge mûr soutient les chants, rythme des mains ou bat le tambour.” “On y décèle aussi deux femmes aux voix d’une très grande qualité. Souvent, pendant l’exercice, Jeanne, impériale, vient à l’avant indiquer et soutenir le mouvement, le rythme, le chant.
Retour au repas d’accueil, brochettes de bœuf et cuisses d’un poulet ferme et goûteux, cordialité ; Jean-Chrysostome est revenu avec une bouteille de vin de banane, fabriqué par sa mère et réservé aux grandes occasions.
Puis imperceptiblement, Tharcisse sort « le grand jeu » ; « jeu » certes, mais en prise directe avec le cœur même des réalités qui nous préoccupent et où deux heures durant, il déploie la vraie éloquence du coryphée, où la dispute n’est rhétorique que pour mieux préserver le caractère aigu et acéré des attaques. Dans notre direction d’abord, pour tordre le cou – sait-on jamais ? – au mythe des ethnies et nous renvoyer, par le récit, aux clans anciens, aux généalogies connues, à la tradition orale et aux documents qui décrivent les lignages et les anciennes chefferies qui, constituées au siècle dernier, persistent au-delà du premier tiers de ce siècle, composées autant de Hutu que de Tutsi, d’agriculteurs et de pasteurs ; le récit passe en revue les liens qui unissaient les différentes classes de la société, les rapports subtils et complexes qui organisaient un équilibre entre elles ; choses que nous avons approchées par nos recherches, mais magnifiées ici par le verbe et la narration.
Puis, subtilement, l’attaque se déplace de façon très pointue vers Jean-Chrysostome, comme représentant de l’Église, dont l’action mêlée à celle du colonialisme a détruit la civilisation existante et porte toute la responsabilité de la confection d’une idéologie raciale et génocidaire.
Les premières attaques fusent sur l’appropriation des terres par l’Église (qui en possède encore aujourd’hui quelque 15%), qui y a fait ériger la plupart de ses biens par une population corvéable à merci. Toute la casuistique ne peut venir au secours du recteur pour défendre le bien-fondé de l’utilisation actuelle de ces terres, qui n’ont en tout cas aucune utilité pour les veuves et les orphelins du génocide, non plus que pour les réfugiés qui ont toutes les difficultés à retrouver un lopin suffisant à assurer leur existence. Chaque attaque à l’adresse de Jean-Chrysostome est cependant tempérée par la référence à ses actes exemplaires pendant le génocide : Tharcisse rappelle qu’il est allé jusqu’à soigner les blessés avec le vin de messe quand il n’y avait plus rien d’autre ; il a caché les rescapés et s’est caché lui-même dans le plafond de la salle où nous sommes pour échapper aux machettes des milices. Impossible de décrire par le menu tout le récit, où le génocide est au centre, sinon pointer quelques formules saisissantes que les études connues ne relèvent pas souvent.
« Il n’a pas fallu attendre 1990 pour voir débarquer les Français » : les Pères blancs sont là depuis le début et ont tout installé par leurs exactions vis-à-vis de la population. Le premier acte du génocide a été de « manger le veau ». Lorsqu’en 1916, les 25 000 soldats de la Force publique congolaise ont pénétré au Rwanda et se sont installés à Kigali, la population était rançonnée de 300 vaches par jour pour les nourrir ; elles étaient abattues en un lieu qu’on appelle encore aujourd’hui l’Abattoir ; et pour les officiers blancs, on sacrifiait des veaux. Or le roi lui-même n’avait pas le droit de manger du veau ; « on ne mange pas son propre enfant, son nouveau-né ». C’était aussi la première fois qu’on prenait la vache pour soi. Le roi, un chef, un propriétaire de troupeau pouvait reprendre une vache à quelqu’un qui avait démérité, mais c’était toujours pour la donner à quelqu’un d’autre qui l’avait méritée.
Ainsi, le récit du choryphée Tharcisse déroule-t-il toute la destruction de la culture rwandaise pour aboutir à la construction de l’ethnisme d’où sort le génocide, et où l’Église est impliquée jusqu’au cou. La hiérarchie catholique qui organise les conférences et les colloques sur « Des prêtres s’interrogent, des prêtres s’accusent » n’obtient de Jean-Chrysostome qu’une maigre défense ; pas moyen de déterminer de quoi au juste les prêtres s’accusent ; on comprend que leur préoccupation est plus proche de celle d’un Guy Theunis qui s’interroge sur la manière de structurer « une nouvelle pastorale »2.
Lundi 20 juillet 1998.
Nouvelle rencontre avec Tharcisse Kalisa.
Il revient d’une tournée dans le pays avec un groupe d’écrivains africains auxquels, notamment, il fait visiter les sites du génocide. On sait combien le gouvernement actuel est attentif à ce que la mémoire y soit préservée, notamment par l’édification d’ossuaires. Tharcisse est encore bouleversé par l’incident qu’ils ont vécu sur le site de Nyarubuye, où des prisonniers en uniforme les ont pris violemment à partie : « Vous êtes comme des chiens, nous avons pris la chair, maintenant vous venez flairer les os ».
L’atelier s’organise ; chaque jour nous rencontrons un groupe différent : hommes, femmes, hommes et femmes mélangés. Toute la première semaine sera davantage consacrée aux danses et à ce qu’elles expriment.
Progressivement, au-delà des impressions esthétiques fortes, nous essayerons d’en décoder le sens inscrit fonda- mentalement dans la société rwandaise dominée par la vache qui y constitue une valeur socio-politico-culturelle.
Dans le langage, tout ce qui est noble, utile et beau est comparé à la vache. Dans la danse, toutes les phases et les termes qui y sont relatifs se rapportent à la vache : nom d’un troupeau – Ntagishyika –, nom rappelant telle couleur de la vache : Ibihogo, Indangamagaju (brun, brun marron, etc.). Bien sûr, nombre d’appellations de danses imihamirizo rappellent la guerre et les hauts faits guerriers : Incogozabahizi, Inditirwabahizi, Incamihigo, Ishyaka… (Affaiblisseurs des ennemis, l’Émulation…).
D’une manière générale, on peut dire, tout en sachant qu’on est loin d’en traduire la richesse et la complexité, que chaque danse comprend trois phases dont les appellations rappellent évidemment la vache.
Gutanga Inka : « Introduire la vache ». C’est la phrase qui annonce la danse, vocalement d’abord ; un des danseurs cite d’une voix forte le nom de la danse qui
va suivre, puis indique les pas qui vont suivre ; les pas sont repris par un duo ou par un trio. Ce groupe donne ainsi le rythme, en exécutant quelques pas initiaux
de la danse annoncée.
Kwakira Inka : « Recevoir la vache ». Il s’agit de recevoir et de reprendre les pas de la danse annoncée ; toute la troupe des danseurs présents sur la scène reprend le motif exécuté par le soliste, le duo ou le trio et enchaîne avec toute la danse jusqu’à sa conclusion.
Kugwa Mu Nka : « Tomber au milieu des vaches ».
Cette dernière partie est généralement constituée par des pas percutants qui constituent le summum de la danse. Cette fin tombe souvent avec force et de façon inattendue au moment où les tambours et les chants se déchaînent.
Nous avons pu voir, au cours des semaines, la plupart des danses guerrières imihmirizio dont globalement le répertoire est limité à cinq, et ce y compris la danse d’entrée sur scène qui se fait sur le rythme de l’Ikondera. Nous avons même eu droit, chose très rare, à la danse d’entrée qui se fait sur le rythme Umusambi ( la grue couronnée) joué sur les trompes Amakondera.
Ces danses sont : Umuthhano ou danse d’introduction du verbe Gutuha, rentrer, rentrer sur scène ; Ruhame : « Force et virtuosité » ; Ntagishyuka : « Nous n’avons peur de rien » ; Murebunyurwe : « Regarde le et apprécie » ; Gusohoka : exhibition en solo.
Cette dernière danse nous a notamment permis de voir la performance d’un danseur Twa, exécutant des bons prodigieux (au vu de sa petite taille) au-dessus des tambours.
D’autres séances de travail ont été consacrées à l’interprétation de textes, en français et en kinyarwanda. D’autres encore nous ont permis d’entendre des chants – chants traditionnels ou créations contemporaines notamment sur le génocide ou sur le spectacle des conséquences du génocide – en solo ou en groupe ; certains d’une très haute qualité et d’une grande force d’émotion. D’autres enfin, ont été consacrées à la répétition des textes d’intervention filmés, de ceux que nous appelons dans le spectacle « les fantômes électroniques ».
BERNARD DEBROUX : Alors que depuis une douzaine d’années tu écris au théâtre une œuvre singulière, pour le projet RWANDA…