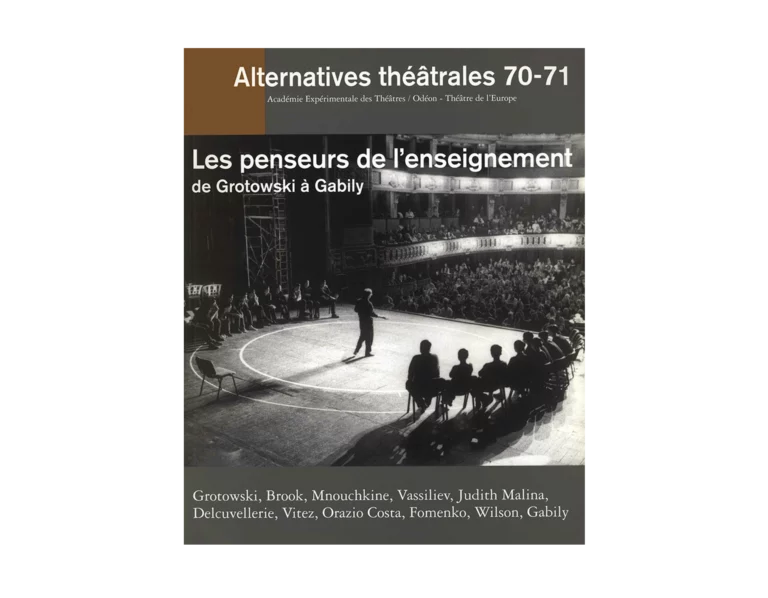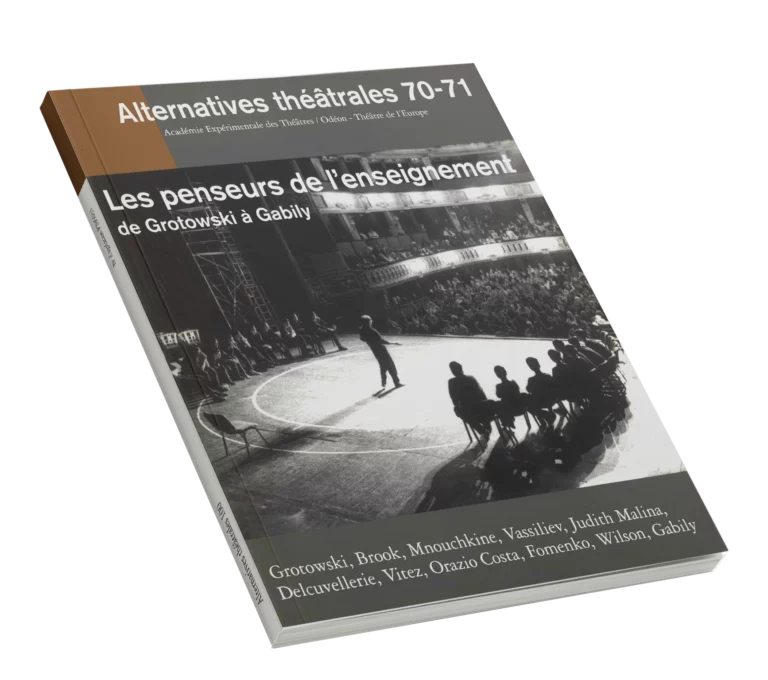GEORGES BANU : Sans doute, le théâtre européen ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, tant sur le plan de la technique corporelle que de la pensée, sans la série de grandes rencontres avec l’Orient qui a commencé au début du siècle, s’est poursuivie dans les années trente et enfin dans les années soixante. On peut aussi parler d’échange, car il ne faut pas négliger en retour l’impact qu’a exercé l’Occident sur le paysage théâtral oriental.
« Le théâtre est oriental » proclamait Artaud. Nous savons tous à quel point nous aura marqué la phrase, reprise à son tour par Ariane Mnouchkine. Tu as toimême été acteur au Théâtre du Soleil, puis tu es devenu pédagogue et, aujourd’hui, avec Lucia Bensasson, tu diriges ARTA. C’est un lieu d’école et de recherche très spécifique puisqu’il est ouvert aux grandes écoles de jeu du théâtre à travers le monde et qu’il se consacre tout particulièrement à la rencontre avec les traditions de l’Orient
Jean-François Dusigne : Ma démarche découle en effet du constat qu’en France tout au moins, la formation initiale de l’acteur était et me paraît encore beaucoup trop étriquée : tantôt on néglige le langage du corps, tantôt on néglige le plaisir du texte, le souffle, le rythme et la musicalité de la parole. Par contre, dès qu’on sort des frontières européennes, la définition même du théâtre s’élargit considérablement : faut-il parler de danse ou de théâtre-dansé indien, d’opéra de Pékin ou de théâtre traditionnel chinois ? Par-delà les différences culturelles et la multiplicité des formes, la découverte des techniques traditionnelles peut conduire à un entraînement non cloisonné où l’expression prend par exemple appui sur le chant, le parlé-chanté, la danse, l’acrobatie ou les arts martiaux. Durant mon parcours au Théâtre du Soleil, j’ai pu bénéficier d’une sorte d’apprentissage permanent au sein de la compagnie car celle-ci invitait de grandes personnalités, issues notamment du théâtre oriental, pour aider les acteurs à mieux se préparer à telle ou telle création, en enrichissant leur palette de jeu. À leur contact, l’acteur pouvait développer son imaginaire, aiguiser sa sensibilité en éprouvant son corps.
Aujourd’hui, avec la raréfaction des compagnies, il me paraît crucial d’aménager pour l’acteur des temps de mise en question du savoir-faire, où il puisse au cours d’un atelier réfléchir concrètement sur sa pratique et s’exercer collectivement auprès d’artistes-pédagogues tels Pei Yanling et Guo Jingchun, à mon sens les plus grands maîtres actuels de l’Opéra de Pékin. Eux-mêmes sont héritiers d’une tradition longuement mûrie par l’expérience de plusieurs générations d’acteurs.
G. B.: J’aimerais justement te demander quel enseignement peut tirer un acteur occidental de ses différentes rencontres avec les maîtres orientaux. Nous savons que le travail oriental est fondé sur la transmission de maître à disciple. Ce mode de relation ne soulève-t-il pas chez l’acteur des problèmes de soumission ?
J.-F. D.: Il est certain que le concept de « maître » prête parfois à confusion. Je crois du reste qu’on utilise le terme de façon abusive. Une maxime chinoise dit pourtant : « le maître te conduit jusqu’à la porte, le chemin de pélerinage est à faire par soi-même ».
Contrairement à l’imposteur — ils sont nombreux‑, le maître d’art ne s’impose pas, on le reconnaît. Dans les théâtres traditionnels orientaux, on apprend à jouer comme l’enfant apprend à parler, par imitation. Certes, on peut être reconnu comme artiste sans avoir pour autant la moindre fibre pédagogique ; toutefois, pour Pei Yanling1, seul le grand acteur peut passer maître car il aura alors son expérience personnelle de la scène à partager.
On reconnaît tout d’abord le maître par l’impression d’évidence qui émane du travail auprès de lui, comme si le plaisir communicatif de jouer filtrait à travers son aisance à montrer, à esquisser un geste. Kelucharan Mohapatra qui, en Inde, a contribué à la résurgence du style Odissi (représentation dansée de la féminité), donne au quotidien l’impression de traîner péniblement son vieux corps. Or sa parfaite maîtrise lui permet précisément d’entrer en un éclair dans un jeu d’une étonnante vitalité. À la fois homme et femme, tour à tour Krishna et Rada, il peut suggérer à l’instant la vision de la divinité par sa façon de mêler force masculine et sensualité féminine. Sa faculté de métamorphose est du reste tout aussi fascinante que sa rapidité à se détacher du rôle, avec la plus grande désinvolture apparente…
Mais le sentiment d’admiration n’induit pas forcément pour autant une attitude de soumission envers le maître, qui attendra cependant qu’on vienne le trouver. Ce dernier donne toujours l’impression préalable, sans doute trompeuse, de ne pas être pressé. Ce jeu de patience est en fait un prélude indispensable à l’instauration d’une relation durable d’accompagnement, car le contrat tacite qui sera ensuite passé entre maître et disciple s’appuiera sur l’élection et le consentement mutuels. Guo Jingchun2 parle à ce sujet de « sphères d’exigence ». Tant qu’il ne sent pas que l’acteur est prêt à travailler avec lui, Guo affiche la plus grande tolérance. Ce qui ne l’empêche pas d’observer son éventuel disciple à son insu pour déceler son potentiel et ses faiblesses. Tandis que ce dernier se sent parfois désemparé par le mutisme, voire l’indifférence feinte du maître, Guo attend que l’acteur ait manifesté dans son travail une réelle demande avant de pouvoir exiger quelque chose de lui. Dès lors, tout en s’engageant à accompagner son élève jusque dans le prolongement même de sa vie professionnelle, Guo reconnaît qu’il deviendra paradoxalement de moins en moins indulgent au fur et à mesure qu’ils se connaîtront mieux : son exigence se fera plus vive chaque fois qu’ils franchiront ensemble une nouvelle « sphère de leur intimité ». Mais j’ajouterai que Guo Jingchun est maître de Pei Yanling depuis l’âge de quatorze ans ; aujourd’hui, ils dirigent ensemble leur propre troupe, et quand Pei se prépare pour un spectacle, il est troublant de voir le vieux maître devenir alors son assistant…
G. B.: Tu parles d’exigence. Celle-ci ne suppose-t-elle pas une perte d’esprit critique, afin d’intégrer de la meilleure manière possible l’enseignement ?
J.-F. D.: « S’agit-il d’apprendre à jouer des rôles ou d’apprendre à être acteur ?3 » demandait effectivement Vitez en 1968. Il opposait alors l’enseignement de « la civilisation mandarine » où « l’acteur apprend à jouer des formes connues » tels le Guerrier ou le Lettré de l’opéra chinois, à l’enseignement de la « civilisation moderne » où l’acteur, conscient, « apprend à jouer avec des formes connues ». J’avoue que j’ai longtemps été séduit par cette idée, en tant que programme : encore faut-il connaître ces formes traditionnelles qui appartiennent au patrimoine universel. Or je suis aujourd’hui convaincu que nous encourons le risque de l’amalgame culturel si nous réduisons notre intérêt pour les traditions de jeu à un éventail de registres ou de techniques dont l’étude se ferait conformément à nos propres conceptions de l’exercice. Il est vrai que l’esprit européen, qui a pour vertu la spontanéité, a souvent du mal à concilier tradition et liberté de création. Soucieux de pouvoir retrouver l’émotion des premières répétitions, l’acteur passera d’abord par l’analyse et l’improvisation avant de fixer son jeu. Or le mode de transmission oriental se fonde quant à lui sur le modelage corporel et le pétrissage. (À ce propos, il y aurait beaucoup à dire sur le lien entre souffrance et esthétique…) Puisque la mémoire corporelle, ou plutôt l’intégration par l’entraînement d’automatismes, y joue un rôle déterminant, la formation commence souvent dès l’enfance. Il est donc peu probable qu’un acteur européen déjà professionnel devienne un jour acteur de kyôgen, de kathakali ou d’opéra chinois. Par contre, il peut tout à fait parvenir à jouer à merveille quelques scènes du répertoire de ces traditions en en respectant les règles. En fait, cela m’importe moins que la manière dont cette confrontation pourra imprégner son travail artistique futur, parfois même — et ce sera peut-être le plus probant — de façon inconsciente. La découverte de modes de travail hérités de pratiques souvent ancestrales aura, par le questionnement qu’ils suscitent, favorisé la mise à distance de ses propres habitudes.
C’est pourquoi, nous invitons les acteurs à profiter de ces moments d’atelier pour prendre le temps d’éprouver une relation de travail qui, de prime abord, les dérangera peut-être. Dans le même temps, il me paraît utile, pour leur propre évolution personnelle, de les inciter à s’intéresser au mode d’apprentissage auquel ils se trouvent confrontés, jusqu’à prendre conscience des différentes stratégies de passation utilisées par le maître, dans la mesure où tous ces processus reflètent en soi l’esprit de l’art ainsi transmis. Je constate en retour que le fait d’intervenir ponctuellement auprès d’acteurs de formation occidentale initiale conduit les maîtres à repenser leur enseignement pour en faire ressortir les leçons essentielles.Je citerai pour exemple notre recherche d’atelier menée durant tout cet été 2001 dont l’objectif aura été d’expérimenter comment certains aspects de l’enseignement traditionnel chinois pourraient contribuer à l’invention d’un théâtre vivant, susceptible de concerner le public européen d’aujourd’hui. Il s’agissait d’explorer à la lumière de l’Opéra de Pékin une oeuvre épique du répertoire occidental LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN, pièce elle-même inspirée d’une vieille légende chinoise. Cette proposition était bien sûr guidée par le fait que Bertolt Brecht a conçu son théâtre épique après avoir été subjugué en 1935 par l’art du comédien chinois Mei Lanfang. En plus de l’entraînement intensif aux techniques de l’acteur chinois, nous avons proposé pour aborder la pièce, de suivre chaque jour en parallèle, deux démarches de travail spécifiques :
- La première méthode, qui nous est plus familière, était fondée sur l’analyse et l’improvisation de situations. Les scènes étaient élaborées à partir des propositions d’acteurs qui bénéficiaient de nos conseils et retours.
- La seconde méthode était fondée sur l’observation, l’imitation et l’entraînement. Elle consistait à se glisser dans le jeu sous la direction rigoureuse de Pei Yanling et Guo Jingchun en commençant par suivre précisément la partition musicale et gestuelle préalablement conçue par les maîtres selon les règles et codes de jeu de l’Opéra chinois. « Apprenez les percussions », disait Pei, « cela rythmera votre jeu. Les percussions vous propulseront dans l’essentiel : en vous donnant l’énergie juste, elles vous feront comprendre ce qui se passe intérieurement dans le personnage d’un bout à l’autre de la pièce. Quand votre gestuelle s’accordera avec le rythme des percussions, ajoutait-elle, ce qui vous nourrit intérieurement viendra se graver dans vos regards… »
La richesse de cette expérience m’a conforté dans l’idée qu’on peut aussi apprendre à être acteur en apprenant à jouer des rôles…
Par ailleurs, il était étonnant de mesurer à quel point les propos des chinois pouvaient parfois rejoindre les préoccupations de Brecht, quand bien même ils n’ont jamais lu ses écrits théoriques.
G. B.: Brecht avait bien perçu Mei Lanfang…
De ces situations pédagogiques inhabituelles pour nous occidentaux, quelles sont celles qui t’ont le plus marqué ou qui ont eu un effet déterminant sur ton expérience aussi bien d’acteur que de pédagogue ?
J.-F. D.: Je dirai tout d’abord que ces multiples rencontres avec des maîtres de cultures aussi différentes m’ont permis de mesurer combien de leçons sur l’art de l’acteur peuvent passer non seulement par le discours mais aussi, et surtout, par le comportement.
Avant de devenir chef de famille, Nomura Kosuké4 avait entrepris de fonder une école de kyôgen. Pour choisir ses élèves, il conviait les candidats à déjeuner. Suivant un tour de table, chacun lui exposait ses motivations en y mettant bien sûr le plus de conviction. En fait, Nomura prêtait moins attention à la teneur des propos qui étaient alors échangés qu’à la manière de se comporter des candidats au cours du repas, observant leur manière de commander un plat ou de l’apprécier.
En retour, il est parfois très instructif d’observer le travail conjoint de deux maîtres. Lors d’un atelier « Mohini Attam, danse de la séduction »5, nous avions fait venir, pour une intervention commune, Kalamandalam Kshemavathi et Kalamandalam Leelamma. Celle qui paraissait la plus jeune (en fait l’écart d’âge n’était que de quatre ans) donnait à sa gestuelle toute sa finesse et son amplitude. Ce faisant, dans son attachement à suivre précisément le style, elle faisait d’abord passer son sens de la perfection technique ; la seconde, au corps plus potelé, travaillait avec plus d’économie et semblait se contenter d’esquisser seulement ses intentions : du même coup, elle donnait une interprétation plus personnelle. Comme les acteurs d’âge mûr, elle gagnait en intériorité ce qu’elle perdait en virtuosité. Assurément, de la façon de canaliser ses énergies dépend la qualité sensuelle, émotionnelle du rôle.
G. B.: À ce sujet, et à propos du regard qu’on peut avoir sur les orientaux, tu connais la fameuse histoire de Grotowski en Chine : il assiste à une représentation d’un spectacle de l’Opéra de Pékin où le rôle principal est tenu par un jeune acteur. Le public l’applaudit modérément. Plus tard, Grotowski voit le même spectacle interprété par le père du jeune acteur. Tandis que lui n’y voit aucune différence, le public est en extase et applaudit le vieil acteur à tout rompre. Grotowski demande alors à un spécialiste : « Mais qu’elle est la différence ? » et le spécialiste lui répond : « Le jeune transpire ».
J.-F. D.: Guo Jingchun dit à peu près la même chose en précisant : « le bon acteur transpire, mais il ne sue pas » …
Concernant le recours abondant aux aphorismes, je rapporterais cette expérience personnelle où, lors d’une création, nous butions sur l’interprétation d’un récit tragique où il était question de massacre. Il s’agissait d’une histoire contemporaine où un père rapporte qu’il vient de perdre sa femme et sa fille. Kalanidi Narayanan, maître d’abinaya6, assistait à la répétition. Venue par curiosité, elle ne disait rien. Plus tard, autour d’une tasse de thé accompagnée de pâtisseries, alors que nous étions réunis pour honorer notre invitée, Kalanidi, voyant que nous étions toujours préoccupés par la séance du matin, nous demande à brûle-pourpoint : « Ne peut-on distinguer l’émotion du rôle de l’émotion du spectateur ? » Formule laconique. J’avoue que sur le coup je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire par là. Mais, dans la nuit, cette remarque a déclenché en moi une série de questions : « crois-tu que le personnage se laisse aller dans les pleurs dans une telle situation) L’émotion du personnage n’est pas forcément la même que celle que toi, acteur-spectateur, tu éprouves pour lui en découvrant son histoire ». Je réalisais alors que Kalanidi me suggérait de résister aux pleurs, plutôt que de chercher à les provoquer ou de m’y complaire…
G. B.: Je vais te raconter une autre histoire qui m’a marqué aussi personnellement. C’est un grand maître japonais, Tamasaburo Bando, qui m’a fait comprendre l’essence même du Kabuki, par une phrase. Je lui avais posé cette question : « J’ai lu qu’au début du siècle, sous l’influence de l’Occident, les plus célèbres Onnagatas (les acteurs qui jouent des femmes) avaient mis des seins postiches pour donner l’impression d’être véritablement une femme. C’était évidemment sous l’influence de l’esthétique vériste occidentale. Qu’est-ce que vous en pensez ? » Il a alors répondu : « Mais c’est extraordinaire, c’est une idée extraordinaire. Je ne savais pas, c’est très bien de faire cela, mais à condition qu’à la fin on enlève les seins. Il faut les jeter en l’air pour dire : tout est faux, tout est faux ! » Je crois que, par ce raccourci, Tamasaburo résumait l’essence même de l’Onnagata : l’art du faux poussé à son comble. Et comme tu le dis, l’enseignement passe effectivement par de telles formulations, concrètes et concises. L’aphorisme est d’ailleurs le propre de la pensée orientale.
J.-F. D.: Et c’est pourquoi nous veillons, Lucia Bensasson et moi-même, à ce que la maison d’ARTA soit un lieu de vie, où de tels échanges puissent avoir lieu. Car les plus grandes leçons ne sont pas toujours données de façon magistrale au cours du travail. Parfois même furtifs, les conseils peuvent surgir comme à l’improviste en diverses occasions de la vie quotidienne, dans la cuisine, autour d’une table. On pense aux fameux Dits d’Ayame, ces propos sur l’art de l’acteur Kabuki recueillis dans des circonstances analogues au travers d’anecdotes ou de considérations sur la vie apparemment sans rapport. Nous attachons donc une grande importance à ce que les maîtres que nous invitons puissent loger sur place, de sorte que le temps d’atelier soit un temps absorbant de mûrissement, où l’on vient vers le maître, sachant que celui-ci est disponible pour vous recevoir.
G. B.: ARTA se transforme ainsi en ashram, comme en Inde …
J.-F. D.: Et aussi en datcha, ou en maison tchekhovienne quand nous invitons les Russes … Mais la perspective de faire couleur locale ne m’attire guère. Ce qui prévaut par contre, c’est de faire en sorte que le contexte puisse favoriser un autre type de parole que le discours analytique qui nous est familier. Nomura Kosuké a par exemple été beaucoup sollicité en Europe du Nord ainsi qu’aux États-Unis. Son intérêt l’a donc conduit à adapter intelligemment son enseignement à nos modes de pensée. Pour trouver la fameuse démarche glissée du Nô ou du Kyôgen, il invitait tout d’abord les acteurs à gravir une pente fortement inclinée, tout en chantant. Lors de leurs premières tentatives, les acteurs ne cessaient de glisser en arrière, et leur voix sortait difficilement, toute éraillée. Nomura Kosuké leur faisait alors prendre conscience de l’importance de bien placer son « Koshi », son centre de gravité. Après différents exercices, il leur demandait à nouveau d’escalader la pente, un bâton-témoin cette fois attaché dans leur dos pour mieux sentir leur colonne : les acteurs franchissaient alors la pente avec aisance, et leur voix sortait de façon bien timbrée. Shime Shigeyama7 se contente quant à lui d’évoquer les esprits maléfiques qui se trouvent sous la scène : l’acteur doit veiller à les contenir sous ses pas. Pour trouver le frappé des pieds, il tentera par contre de réveiller l’énergie des génies qui se trouvent en ce lieu… Qu’est-ce qui parle en fin de compte le plus à un acteur : l’analyse physiologique ou la métaphore ? J’aime personnellement cette deuxième manière de procéder car elle évite l’assèchement de l’explication didactique, à une époque où l’on est par trop friand de livres d’exercices…
Par ailleurs, le souci de bien appliquer l’exercice amène parfois les jeunes acteurs, à en oublier leur objectif essentiel. La confusion entre imitation (dans le sens d’imprégnation), et pâle copie extérieure suscite parfois le malentendu de ne plus se préoccuper que de questions formelles. Faisant sans doute un tel constat, Sadanam Balakrishnan, maître de Kathakali, racontait ainsi aux stagiaires l’histoire du maître de tir du MAHABARATHA : celui-ci présente un arc à trois disciples en leur disant : « j’aimerais que vous visiez l’oiseau qui se trouve sur cet arbre ». Il demande au premier : « qu’est-ce que tu vois ? » Le premier disciple commence par décrire minutieusement dans tous leurs détails le ciel, l’arbre, les feuilles. Le maître l’interrompt : « ne tire pas ». Il demande au second : « qu’est-ce que tu vois ? » Le second disciple s’énerve et répond : « je vois une branche et un oiseau sur la branche ». Le maître dit : « ne tire pas ». Il demande alors au troisième disciple, qui n’est autre qu’Arjuna : « qu’est-ce que tu vois) ». Alors Arjuna s’apprête, bande son arc et dit : « je vois l’oeil de l’oiseau ». Le maître dit : « tu peux tirer ». Après avoir raconté cette histoire, Balakrishnan ajoutait : « s’il y a une chose à retenir de tout l’enseignement, c’est ça ».

G. B.: À cette histoire, on peut répondre par une autre histoire. À l’issue des journées que nous avions menées autour du secret de l’acteur, nous étions sortis avec Udo Samel, qui avait notamment interprété Woyzeck dans le spectacle de Stéphane Braunschweig. Il jouait dans le fameux spectacle de Klaus Michaël Grüber, L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE. Ce soir là donc, Udo Samel me raconte ses répétitions avec Grüber : il devait jouer un personnage qui pense avoir tué une vieille femme, après avoir beaucoup bu dans la nuit avec son compagnon. Grüber qui avait du reste une forte expérience de ce côté là, lui donne alors une indication, comme tu dis, métaphorique. Grüber est un artiste et il sait utiliser la métaphore. À Udo Samel qui devait donc jouer cette situation, Grüber a fourni une situation, une seule : « Tu marches comme quelqu’un qui se réveille le matin et qui, sans avoir ouvert les fenêtres, sort dans la rue ; et la rue est couverte de verglas ». Samuel me disait que cette indication était si poétique qu’elle traversait la totalité du spectacle, et qu’il n’avait pas eu besoin d’une autre indication. Cette histoire de l’homme qui marche sur le verglas répond au fond au même type de fonctionnement, c’est-à-dire l’utilisation de l’imagination pour résoudre les problèmes techniques.
J.-F. D.: Et je trouve cela formidable car de telles indications peuvent non seulement fonctionner à l’instant mais aussi agir dans le temps en trottinant dans la tête comme un rébus. D’un atelier à un autre, dirigé par des maîtres de mondes parfois très différents, des histoires semblent ainsi se répondre, en écho. C’est peut-être en écoutant parler le maître chinois Guo Jingchun que j’ai enfin compris l’histoire du maître de tir du MAHABARATHA. Guo Jingchun est un fin gourmet et ses références sont souvent culinaires. Il est d’ailleurs parfois difficile de suivre Pei Yanling et Guo Jinchun dans leurs conversations car ils passent constamment, et sans transition, de propos sur le plat qu’ils sont en train de préparer ou de manger à des propos sur le jeu des acteurs qu’ils sont en train de diriger. « Si pour cuisiner, je n’ai que du poisson et rien d’autre, je ne peux rien faire » dit Guo. « Ce n’est pas uniquement avec ma volonté que je peux jouer : il y a différents ingrédients à réunir. Si par contre, vous avez acheté sur le marché un beau poisson, bien frais ; si vous avez pris soin de préparer, de moudre, de griller toute la variété d’épices que vous vous êtes procurée, si maintenant vous suivez scrupuleusement et pas à pas les consignes d’un bon livre de recettes, vous ne ferez pas forcément pour autant un excellent plat : tout le secret de l’art de l’acteur, poursuit Guo, réside dans sa manière d’utiliser harmonieusement, de lier personnellement les 101 techniques qu’il a préalablement acquises ».
Et, poursuit-il : « Nous sommes au pied d’une même montagne, réalisait Pei au cours du travail. Les acteurs occidentaux sont au pied du versant ouest, les orientaux au pied du versant est. À ce stade, au pied de la montagne, les uns et les autres ne se voient pas, ils ne le peuvent pas : ils sont aux antipodes. Chacun commence par établir à sa manière son camp de base, acquiert les indispensables techniques fondamentales qui lui serviront pour l’ascension. Ensuite, plus on gravit les étapes pour affiner le jeu, pour préciser à chaque instant ses motivations intérieures, plus on découvre la cordée opposée. On s’aperçoit alors non sans étonnement que celle-ci se pose les mêmes questions essentielles concernant l’art intérieur de l’acteur ». l’acte même de transmettre vivifie la tradition.
- Actrice et maître de l’Opéra de Pékin. ↩︎
- De l’Opéra de Pékin, lui-même maître de Pei Yanling. ↩︎
- Antoine Vitez, « Si le théâtre s’apprend », ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, l, L’ÉCOLE, Paris, P.O.L, 1994, pp. 59 – 60. ↩︎
- Acteur de Kyôgen, Nomma Kosuké est descendant direct d’une des plus grandes dynasties de cette forme de théâtre traditionnel japonais. Signifiant « paroles folles », le Kyôgen se joue le plus souvent entre deux scènes de Nô, pour en libérer la tension tragique par un intermède humoristique ou grotesque. ↩︎
- Danse de l’Inde du Sud. ↩︎
- Dans le théâtre-dansé indien, l’abhinaya recouvre tout ce qui concerne le jeu des émotions. Le travail plus spécifique sur l’abhinaya vise à dépasser la technique dansée ou chantée pour tendre vers ce que les indiens nomment la création du Rasa, expérience esthétique partagée par le public. ↩︎
- « Important bien culturel vivant », Shime Shigeyama est issu d’une autre famille de kyôgen, qui réside à Kyoto. Il est intervient également à ARTA. ↩︎