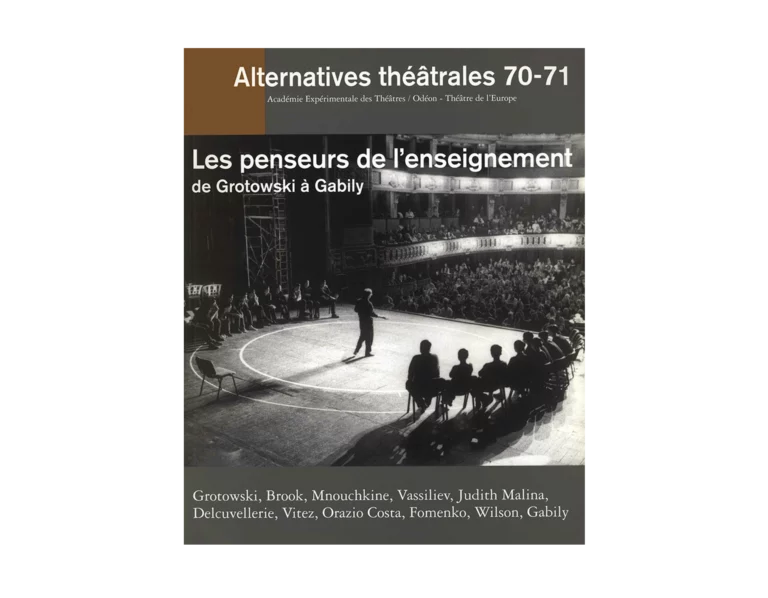EN MARGE des journées publiques des « Penseurs de l’enseignement », l’Académie Expérimentale des Théâtres organisait, au Petit Odéon, trois chantiers de réflexion sur les enseignements de théâtre et les formations aux pratiques théâtrales dans des cadres institutionnels en France, à savoir, successivement, l’enseignement secondaire, l’Université et les écoles supérieures de théâtre. Plus de soixante participants y prirent part, responsables d’écoles professionnelles, 118 artistes, universitaires, enseignants et partenaires institutionnels.
La première de ces matinées était lancée par une intervention de Marcel Bozonnet, directeur du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, sur le thème « Enseignements du théâtre ou enseignant spécialisé ? ». C’est toute la question de la formation des formateurs de théâtre qui était en jeu, et derrière elle celle de la formation continue — cette dernière question prit d’ailleurs le pas sur celle, initiale, de l’enseignement du théâtre dans les lycées. Marcel Bozonnet faisait le constat de la nécessité d’un plan d’ensemble de formation de l’acteur pédagogue, et suggérait l’idée que des élèves du Conservatoire (et d’autres) puissent, après quelques années d’activité professionnelle, revenir dans cette institution pour y recevoir une formation, diplômante, à la pédagogie théâtrale. Si cette idée ne reçut pas un écho très favorable, en particulier pour ce qui est du principe de la création d’un diplôme de formateur de théâtre, et provoqua une réaffirmation presque globale de l’attachement au principe du partenariat qui régit actuellement l’enseignement du théâtre dans le secondaire, le constat de départ était par contre bien plus partagé. De fait, la discussion s’attacha aux multiples questions soulevées par la nature de la formation théâtrale. Qui forme ? Qui forme les formateurs ? Comment concilier la conception d’une formation continue structurée et pensée globalement et la souplesse nécessaire pour maintenir la diversité des approches de l’art et se prémunir d’une modélisation systématique forcément réductrice et préjudiciable ?
Derrière la nécessité imprescriptible d’une pédagogie liée à l’art, le constat était général de l’existence forte d’un désir et d’un besoin d’une formation continue, qui ne serait pas un simple apprentissage de techniques mais qui serait également liée à la nécessité de recherche qui caractérise l’activité des praticiens. Si l’apprentissage des techniques est évidemment fondamental, la formation artistique ne doit pas pour autant prendre un tour trop patrimonial, ni se constituer en milieu très clos comme la profession en recèle déjà tant ; il ne s’agirait pas tant de former des enseignants spécialistes que de pouvoir alterner des périodes de formation très précise et d’autres de véritable recherche. L’enseignement étant également un lieu d’interrogation pour l’artiste, l’espace idéal de la formation serait un espace où pourraient dialoguer savoirs, techniques et recherche, théorie et pratique, savoir-faire et méthodes de travail ; lieu d’acquisition de techniques mais aussi d’ouverture de champs ; lieu d’expériences et de rencontres. S’il est bien une aspiration forte qui se dégageait de toutes les paroles de cette matinée, c’était bien le désir partagé de formation complémentaire ou continue (à condition qu’elle ne se constitue pas en système clos). Quels lieux alors pour cela ? Un des lieux suggérés était… les universités.
L’Université était l’objet de la deuxième matinée, ouverte par Denis Guénoun qui avait, sous l’intitulé « L’étudiant, amateur éclairé ou professionnel en herbe ? » abordé préalablement la situation des étudiants en théâtre dans les universités par rapport à la distinction entre amateurs et professionnels et posé la question du rapport entre théorie et pratique. Ces points ont été largement discutés au cours de la matinée : la question du public étudiant et de ses attentes, à travers en particulier le constat d’un désir de professionnalisation croissant, à travers le constat, également, de sa très grande diversité ; la question du rapport entre théorie et pratique, avec la reconnaissance de leur hétérogénéité, mais également du fait que l’une n’allait jamais sans l’autre, et que l’étrangeté de leur coexistence ou de leur partenariat, formant un arbre aux ramifications diverses plutôt qu’un corps constitué, était à conserver.
La réflexion interrogeait la nature même de l’enseignement des arts du spectacle au sein de l’enseignement universitaire, avec les défis qu’une telle inscription implique. Ainsi, qu’en est-il, étant donné que l’institution universitaire est caractérisée par une double visée d’enseignement et de recherche, de l’Université comme lieu de recherches artistiques (pour ce qui est de la recherche pratique qui peut y être faite, comme pour ce qui est de l’influence éventuelle de ce qui se passe à l’Université sur la profession et les pratiques artistiques) ? Comment, dans le cas du théâtre, face en particulier aux enjeux posés par la professionnalisation et face à l’institution culturelle, garder l’équilibre principiel de l’Université entre ses capacités d’ouverture et ses capacités de résistance (à l’air du temps et aux modes, aux demandes du public…) ? Quels types de relation peuvent et devraient entretenir les universités avec les institutions théâtrales ?
Concernant le cas précis de la première année de DEUG, on a souvent l’impression que les études théâtrales, qui étaient jusqu’à un certain temps un domaine très particularisé, seraient devenues des études générales (ou les prolongeraient) pour des étudiants encore très indéterminés, et prendraient ainsi pour le premier cycle le tour, plus que d’une formation spécialisée, d’une formation universitaire générale par le biais du théâtre (l’analyse de spectacle, par exemple, y deviendrait d’une certaine manière plutôt une incitation à la réflexion à partir d’un pôle artistique). Le problème premier que la jeunesse, le nombre et l’hétérogénéité des étudiants de DEUG semblent en tout cas poser est celui de savoir s’ils sont capables, dans les deux premières années, de « trouver un fil ». En effet, il est significatif que les étudiants actuellement les plus à l’aise à l’Université ne sont pas ceux de 18 ans, mais ceux qui reviennent après un parcours professionnel ou qui sont en formation continue, qui, eux, trouvent ces « fils » assez vite. La question est alors : comment aider les étudiants à cela, quels programmes construire de manière à ce qu’ils puissent (re)trouver pourquoi ils sont là ?
Nombreuses sont les inadéquations techniques entre les pratiques de l’institution universitaire et les exigences des enseignements artistiques : ainsi le problème de l’équipement et des infrastructures, celui du nombre excessif d’étudiants par groupe de pratique, celui des heures complémentaires ( dont les départements d’études théâtrales font, par nécessité, un grand usage), et, plus largement, celui, administrativement très problématique, de l’emploi, l’embauche, et la rémunération d’intermittents du spectacle dans les universités — à plusieurs reprises est revenu le problème des statuts de ceux que les enseignements artistiques à l’Université emploient. À l’évocation de ces difficultés multiples, se sont manifestés — et ce n’est pas le moindre des acquis de cette matinée — le désir et la nécessité de créer un vrai lieu d’échanges, un lieu de coordination, national, qui pourrait être un véritable interlocuteur pour les Ministères, et qui serait également, plus largement, le moyen de poursuivre et développer une réflexion indispensable sur les enseignements de théâtre à l’Université1.
La dernière question qui a donné lieu à une discussion suivie a concerné les relations entre les universités et les écoles professionnelles. Peut-on envisager des échanges plus soutenus et pérennes (entreprise dont les exemples passés des avortements de projets mettant en relation Paris III et le Conservatoire, ou encore Paris X‑Nanterre et le T.N.S., viennent rappeler la difficulté) ? Quelle est, par exemple, la place des enseignements théoriques dans les écoles professionnelles ? Et surtout : qui, en fin de compte, a besoin de qui ? Quel mode de collaboration est-il possible, et quel mode est-il souhaitable ? Entre le partenariat, la complémentarité et la charité, la question des relations entre l’Université et les écoles est complexe, et ce d’autant plus que l’on ne peut pas mener à ce propos de discussion féconde sans tenir compte des différences spécifiques entre ces deux types d’institutions, de pédagogies et de publics (ne serait-ce que du fait des recrutements et des visées professionnelles). Les prises de parole et les enjeux sont bien différents dans les deux cadres, et ce serait une erreur que de faire semblant de l’ignorer ; cela ne change rien à l’intérêt, voire à la nécessité, d’un échange entre les deux, dans lequel chacun aurait certainement beaucoup à gagner.
C’est justement aux écoles professionnelles d’acteurs que la troisième matinée était consacrée. Didier Abadie, délégué général de l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, l’ouvrit autour de la problématique « Les ateliers : outil pédagogique ou tentative spectaculaire ? », en présentant, après avoir souligné que chaque école fait des choix qui lui sont spécifiques, l’exemple de l’ERAC. La spécificité de la démarche pédagogique de l’ERAC est en effet d’organiser son enseignement principalement sous la forme d’ateliers (ateliers de cinq à six semaines en première et deuxième année, deux ateliers de plusieurs mois en dernière année), menés par des professionnels extérieurs, permettant de reconstituer rapidement les conditions d’un professionnalisme pour les élèves, permettant également de prendre en compte la multiplicité des courants artistiques. Face aux deux inconvénients majeurs de ce principe d’ateliers (la « cristallisation » des élèves par une succession d’ateliers très différents, et le risque d’empilement artistique), l’école s’efforce de créer un véritable groupe avec les élèves, et de mettre en oeuvre un programme pédagogique qui puisse constituer un cursus qui soit comme une colonne vertébrale, facteur de stabilité et d’évolution. Ainsi, l’intervenant est choisi en fonction, en plus de sa méthode pédagogique, du thème choisi pour l’atelier, lui-même défini par le programme pédagogique précis et évolutif mis en place par le dramaturge qui suit la structure. Le risque de fragmentation qu’entraîne le choix des ateliers comme principe de l’enseignement à l’ERAC est donc contrebalancé par l’existence de périodes de travaux plus personnels laissés aux élèves pour leur permettre de revenir à eux-mêmes et d’avoir des périodes d’assimilation personnelle des ateliers, par un programme pédagogique structuré et évolutif, et par leur jeu de ces ateliers avec les cours techniques continus : il s’agit de faire en sorte que les cours permanents constituent une machine extrêmement stabilisante, une ossature, avec la présence d’une équipe pédagogique soudée pour qu’il existe une véritable unité. Ainsi, les disciplines liées au texte, la dramaturgie, l’histoire du théâtre, sont complètement intégrées dans l’unité du programme pédagogique, dans l’intention que le travail sur les textes, le travail sur le corps et l’interprétation soient au mieux synthétisés par l’élève comédien.
Le choix d’une telle pédagogie privilégiant les ateliers pose évidemment de nombreuses questions — sur lesquelles la discussion s’est engagée — à la formation de l’acteur, et la volonté de l’ERAC d’une grande unité pédagogique en témoigne. Les ateliers ont en effet parmi leurs nombreux avantages celui de préparer plus concrètement les élèves à la pratique professionnelle, au travail avec des metteurs en scène différents ; ils peuvent également présenter le risque de créer des illusions, de projeter trop vite les élèves dans une exigence d’efficacité (au détriment de l’apprentissage ? ou au détriment de l’égalité ?), dans la recherche de l’utile ; on peut se demander également s’ils ne constituent pas des temps d’apprentissage trop courts, alors que la nature de l’école amène souvent à prendre conscience de la nécessité de la lenteur dans l’apprentissage (sachant, d’autant plus, que les trois ans d’école constituent une séquence courte dans l’ensemble de l’évolution de l’acteur). Une autre grande question impliquée par les ateliers est celle du choix, ou non, de leur présentation publique : autant il est nécessaire pour les élèves de faire à certains moments l’épreuve du regard extérieur (sans compter la nécessité de se présenter, comme en troisième année, à des employeurs potentiels), autant le travail théâtral doit également prendre en compte l’indispensable intimité et le secret constitutifs de la pratique, de la répétition, de la recherche et de la pédagogie : entre les deux, il s’agit donc de mettre en oeuvre des dispositifs équilibrés.
La question des ateliers soulevait en fait les principales questions qui se posent aux écoles professionnelles d’acteurs : comment être à la fois des écoles d’art et des écoles professionnelles, comment construire une pédagogie alternée conciliant des interventions extérieures et ponctuelles et une continuité donnant une stabilité et un référent (un substitut de père, pourrait-on dire…), comment préparer les élèves aux exigences de la profession tout en les formant véritablement, en leur donnant une certaine éthique et les accompagnant dans leur propre recherche esthétique ? Questions fondamentales pour l’École, et donc fondamentales pour le théâtre ; on sait le lien indéfectible qui existe entre les deux, et leur consanguinité.
Une pratique critique

Au cours des chantiers de réflexion de ces trois matinées, tandis que les manifestations publiques des « Penseurs de l’enseignement » témoignaient dans la grande salle de l’Odéon de certaines des plus grandes expériences atypiques et non-institutionnelles de la pédagogie théâtrale, la question de la formation se reposait, à propos de divers cadres institutionnels cette fois. Or ce déplacement la reposait, en un certain sens, comme plus à nu. En effet, que ce soit à l’Université, dans les projets de lieux de formation continue, ou dans des écoles institutionnelles considérées dans leur permanence (et non dans leur seule coïncidence avec la présence en leur sein d’un artiste singulier, comme on peut parler de Vitez au Conservatoire ou de l’école de Chéreau aux Amandiers), cette question se pose sans qu’elle soit associée à la personnalité d’un maître, ou à la conscience d’appartenir à une expérience unique, qui lui apporterait l’identité forte et singulière d’une esthétique et d’un projet personnalisés. Hors de cet ancrage — et c’est le défi de l’institution -, dans la nécessité d’établir des programmes et un cadre indépendants, ou tout du moins plus larges que la personnalité de l’artiste autour duquel elle serait constituée (même si l’on sait que cela ne peut jamais être absolument le cas), qu’est-ce que former à la pratique théâtrale ? Comment former dans des institutions qui accueillent des artistes en leur sein, mais qui ne sont pas indissolublement liées (en principe tout du moins ; en tout cas, l’école continuera à exister après leur départ) à la personnalité singulière d’un d’entre eux ? Alors que l’on sait que, par nature, l’enseignement théâtral fonctionne sur des relations privilégiées et fortement personnalisées, qu’impliquent des particularités comme l’exigence d’égalité et l’établissement de cursus très normés pour l’Université, ou l’accueil, dans la perspective d’une « formation continue », de praticiens aux expériences très diverses et déjà largement engagés dans la vie professionnelle, ou encore, pour les écoles professionnelles, la ligne de mire d’un milieu professionnel extrêmement divers (là où les cours privés, par exemple, se définissent très souvent par l’objectif des concours d’entrée à ces écoles) ? Dans la durée, seul cadre véritable de formation, quel processus global définir ? Là où le « maître » définit et justifie par sa personnalité et sa présence même, par le lien fondamental qui l’unit à « son école », les choix esthétiques de son enseignement, et les choix éthiques qui lui sont liés, là où il donne une vision du monde, ou plutôt — préférons cela — aide l’élève à déployer sa pratique en s’ouvrant sur le monde, qu’en est-il lorsque le cadre de l’enseignement n’est pas lié a priori à une démarche artistique personnelle, mais doit se définir sans cela, presque (si cela était possible — cela ne l’est bien sûr pas) « objectivement » ; se définir comme lieu de transmission de connaissances et de compétences, bien sûr, mais aussi, puisqu’il s’agit de pratique artistique, comme lieu de formation à une pensée de sa pratique.
S’il y a, évidemment et indiscutablement, des fondamentaux qui s’acquièrent, des techniques qui s’étendent et s’approfondissent, la formation de l’acteur ne se limite pas à cela. Il ne s’agit pas simplement, pour lui, d’augmenter et de diversifier son arsenal de techniques, des techniques dont il peut même être dangereux de les considérer comme autonomes, se suffisant à elles-mêmes. La complexité des formations théâtrales, quelles qu’elles soient, vient de leur nature double : elles sont des formations professionnelles et artistiques, et non simplement des formations professionnelles, au même titre que, par exemple, les écoles de commerce… Elles sont les lieux d’une transmission de savoir faire, assurément, mais aussi d’un éveil de la conscience à son art, qui doit veiller à préparer l’élève à ce qu’on lui demandera dans le marché de la profession mais aussi à lui donner les moyens de ne pas être qu’un pion futur aux mains de metteurs en scène successifs qui ne seraient perçus que comme des employeurs (« Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je te le fais ; tu veux que je te le joue comment ? »), ou un de ces « enfants gâtés » contre lesquels Stanislavski s’emporte dans quelques pages de ses Notes artistiques2. Il s’agit de lui donner les moyens de penser sa pratique, d’avoir un regard critique et pleinement conscient de ses enjeux sur sa démarche condition sine qua non de son développement. Une démarche artistique, c’est-à-dire qui n’a de sens qu’à se situer et s’inscrire : dans le cadre de sa pratique, tout d’abord, son actualité et son histoire, et enfin — et surtout — dans le monde.
Ce qui n’est pas forcément évident, car, en plus des impératifs de « rentabilité » professionnelle (exigence fondamentale pour les écoles, domaine souvent de complexes pour les universités), la jeunesse des étudiants tout comme celle de certains élèves des écoles est parfois porteuse d\m désir d’efficacité et d’utilité immédiate. Une telle urgence est d’ailleurs belle, et fortement productrice, elle est également généralement accompagnée d’une force de proposition extrêmement dynamisante. Mais elle a son revers, et peut aussi être le moteur d’une fuite en avant et d’une perte d’humilité. Car en fin de compte, « l’École est inutile. Elle ne promet nul débouché ; elle n’est ni une pépinière ni un vivier. Son objet est l’exercice », écrivait Vitez3 ; ce qui veut dire, en fait, que sa véritable utilité est là, et que si « l’exercice est un frêle barrage contre les tentations commerciales et le tumulte de la vie professionnelle ; il doit être maintenu comme un bien sans prix »4, ce n’est qu’en cela que l’École pourra véritablement irriguer le théâtre. Former un acteur n’est pas former comme à n’importe quel autre emploi, n’est pas former un professionnel qui, de spectacle en spectacle, pourrait être un intérimaire permanent ; « l’acteur n’est pas un instrument. ( … ) L’acteur est un artiste conscient du jeu de leurres qu’il propose »5. Et c’est bien cette conscience qui est fondamentale, une conscience de sa pratique,
C’est là que fait retour le serpent de mer, la dichotomie, sur-connue mais jamais résolue, entre théorie et pratique, ou plutôt — un tel déplacement de termes peut se révéler utile pour en clarifier les enjeux — entre pratique et critique. Sans que la dernière ne paralyse la première, mais au contraire pour qu’elle l’ouvre et la meuve : il s’agit bien de former à une pratique qui soit consciente, fondée et prête à sans cesse se remettre en situation et en question, à une pratique critique.
Car penser ce qu’on appelle « théorie » et ce qu’on appelle « pratique » sur le mode de la scission n’est pas d’un grand intérêt. S’il y a différence, différence de lieu d’inscription du regard en particulier, il s’agit plutôt de les penser sur le mode de leur consanguinité, plus que d’une simple « complémentarité ». Tous les savoirs rapidement catégorisés comme « théoriques » (et souvent, par conséquent, considérés comme simplement universitaires et comme cantonnés à la Faculté — ce qui est en partie faux, certains de ces enseignements existent dans les écoles professionnelles, reste à savoir comment, et cela varie) ne sont pas de simples « autour » du théâtre, en marge de la pratique, en amont ou en aval, et qui ne seraient pas du ressort du travail du praticien sur le plateau. Ils s’en nourrissent, de la même manière qu’ils peuvent le nourrir, même si leurs temps ne sont pas forcément toujours les mêmes. Cela est évident pour la dramaturgie, mais également, en fin de compte, pour l’esthétique et toutes les démarches analytiques… Outils pour comprendre ce que l’on joue, pour construire un indispensable regard sur les spectacles des autres et sur son propre travail, il s’agit de démarches qui sont autant de voies permettant au praticien de considérer, fonder et constituer sa pratique.
Alors, on sait bien que trop de distance peut paralyser, qu’il faut par moments abandonner le regard critique pour produire, qu’une certaine inconscience est souvent nécessaire ; mais l’on sait également que trop d’inconscience se révèle souvent facteur d’une autosuffisance et d’une auto-satisfaction stériles, et que le narcissisme est à la fois cet étrange moteur indispensable de la pratique de l’acteur et son aveuglement, son écueil le plus dangereux ; entre les deux, c’est un équilibre que le praticien doit trouver ; sa formation doit lui donner les outils pour cela.
« Tout doit se travailler et avoir du sens. Je ne suis pas contre l’innocence, mais quand on est praticien — j’emploie ce terme à dessein — on doit penser sa pratique. On doit la mettre en mots. Et cela se « voit » sur le plateau », disait récemment Frédéric Fisbach6 — parole de metteur en scène, mais qui concerne l’activité de tous les praticiens de l’art théâtral. Penser sa pratique, ce qui implique l’inscrire parmi les autres pratiques et dans le monde, là est bien la question, et un enjeu fondamental de la formation.
Une intervenante du chantier des matinées des « Penseurs … » évoquait de jeunes metteurs en scène qui se révélaient par un ou deux spectacles très brillants, puis dont les spectacles suivants décevaient, comme un soufflé qui retombe. Elle donnait comme explication à cela le mangue de métier soutenant le talent. Ne pourrait-on pas inverser la conclusion, et parler de mangue de quelque chose qui soutiendrait et fonderait la virtuosité dans un métier qu’ils ont appris, dont ils ont su exploiter tous les acquis à leur sortie de formation, mais auquel il mangue un fondement réflexif ? Un mangue de pensée de leur pratique et de l’inscription de celle-ci dans le monde, un mangue de rapport critique à leur travail, de saisie de leurs propres enjeux. Un mangue de métier, certes, mais alors au sens où l’apprentissage d’un métier ne va jamais sans le déploiement d’une pensée centrée de son travail, permettant son renouvellement et empêchant gu’il ne s’endorme dans le ronron de la reproduction d’un savoir-faire.
Il est un désarroi qui n’est pas souvent pris en compte chez certains jeunes acteurs, et qui n’est généralement pas reconnu car il survient lorsque ceux-ci ont terminé leur apprentissage institutionnel et ont déjà connu (pour les plus chanceux d’entre eux) l’enchaînement des contrats dans des spectacles subventionnés. Après quelques années de pratique professionnelle resurgit alors la question : pourquoi fais-je cela ? Qu’est-ce que je fais là ? Comment renouveler et fonder mon travail ? le succès des stages AFDAS, le désir régulièrement exprimé à tous les niveaux de la profession d’une formation continue, plus indirectement le désir nouveau des troupes permanentes, parlent de cela ; celui de l’existence de lieux et de temps en marge du système de production, qui permettent d’affiner et d’élargir ses compétences, mais surtout de penser, à plusieurs, sa démarche, également. Et les écoles n’ignorent pas cette nécessité de fournir à ceux qu’elles forment les moyens de se responsabiliser car, en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Didier Abadie évoquait ainsi le désir de l’équipe de l’E.R.A.C. d’avoir un véritable programme pédagogique, d’articuler savoirs et pratiques, de relativiser le désir des élèves d’une simple utilité et efficacité professionnelle ; et le choix des intervenants dans les écoles (et dans les universités aussi, la plupart du temps) témoigne également de la volonté de confronter les élèves à des pratiques liées à des pensées fortes de l’art théâtral — ainsi, faire travailler les élèves avec des artistes aux esthétiques si affirmées, et si différentes, que Claude Régy et Matthias Langhoff, comme l’a fait l’école du T.N.B., n’est pas anodin (là, la figure du maître fait d’ailleurs, évidemment, retour…).
Lors d’un récent colloque sur la formation de l’acteur, un acteur qui avait participé à l’aventure du T.N.S. des années 70 s’exclamait : « Pas d’école ! ». Il ne s’agissait bien sûr pas d’un déni de la formation dans l’absolu, mais bien d’une affirmation que la prise de conscience en commun d’enjeux de pensée (politiques, mais aussi poétiques, dans le cas du TNS des années 70) et le travail de s’efforcer à « dire les mots du poète dans l’ordre et en rythme »7 étaient, en fin de compte, les véritables fondements de l’éducation du praticien de théâtre : se saisir de son matériau et en mesurer les enjeux, chercher en permanence le fondement d’une pratique, en traquer l’inscription dans le théâtre et dans le monde.
Former à une pratique qui soit une pratique critique. Il ne s’agit pas seulement d’un vieux rêve brechtien (même s’il faudrait un jour traduire les notes de mise en scène du Berliner Ensemble, ou si les quelques pages sur Laughton travaillant le rôle de Galilée8 sont un portrait d’acteur à l’oeuvre trop peu lu). C’est ce qui permet de rendre l’acteur le plus libre possible, lui donner les moyens d’être maître de la construction de son parcours de praticien, lui fournir des outils et non une « valise »9 bouclée ; un éveil au monde, donnant non pas un « centre » acquis ou hérité une bonne fois pour toutes mais la conscience de toujours interroger le fondement de son activité artistique. Cela suppose, en fin de compte, que l’école ne cesse jamais, mais que le principe même de la pratique théâtrale est d’être perpétuellement (sans que cela implique forcément table rase) remise en mouvement. La formation théâtrale serait donc avant tout ce qui donne le goût du questionnement et de l’insatisfaction, le désir perpétuel de son recommencement.
- L’intérêt de certains des problèmes soulevés lors de cette journée et le constat du désir de beaucoup d’universitaires de réfléchir ensemble à la question des pratiques théâtrales à l’Université sont une des raisons qui ont mené l’Académie Expérimentale des Théâtres à mettre en oeuvre, tout au long de l’année 2001, un vaste chantier de réflexion sur « Les arts de la scène à l’Université », donnant lieu, à la suite de plusieurs séminaires, à cinq journées publiques dans cinq universités françaises (Rennes 2, Franche-Comté, Lyon II, Aix-en-Provence, Paris X‑Nanterre) entre le 22 octobre et le 13 novembre. ↩︎
- « Aujourd’hui, l’acteur et les autres travailleurs du théâtre ont grandi artistiquement, mais ils ont gardé toutes leurs habitudes d’enfants gâtés. Ils n’ont pas appris à être autonomes, ils ont peu d’initiative créative, ils sont pauvres en matériau artistique, donc ils attendent une aumône du metteur en scène comme des mendiants, ou l’exigent comme des gens gâtés. les metteurs en scène montrent toujours tout aux acteurs ( … ). Ces derniers ne savent que cultiver, faire la récolte et la partager aclroi tement avec le public. ( … ) Nos acteurs viennent aux répétitions pour contempler la création du metteur en scène ». C. Stanislavski, NOTES ARTISTIQUES, trad. M. Zonina et J.-P. Thibauclat, Circé / TNS, 1997, pp. 62 – 63. ↩︎
- « Douze propositions pour une École », 6, in ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, l, L’ÉCOLE, P.O.1., 1994, p. 217. ↩︎
- « Douze propositions pour une École », 7. ↩︎
- « Douze propositions pour une École », 8. ↩︎
- Entretien avec R. Cantarella et J.-P. Han, Frictions n°2, p. 15. Frédéric Fisbach est d’ailleurs porteur d’un très beau projet pour le Studio-théâtre de Vitry, à la direction duquel il vient d’être nommé, celui d’un lieu qui serait à la fois un laboratoire et un lieu de transmission — un tel projet est d’ailleurs révélateur du désir de beaucoup praticiens. ↩︎
- La formule est d’André Wilms. ↩︎
- Préface (à : Construction d’un rôle)», in ÉCRITS SUR LE THÉÂTRE, L’Arche, tome II, pp. 432 – 440. On trouve quelques notes de répétitions du Berliner Ensemble traduites et commentées dans : Irène Bonnaud, BRECHT METTEUR EN SCÈNE, Vacarme n°10, hiver 1999, pp. 51 – 56. ↩︎
- Pour reprendre l’expression employée par Ariane Mnouchkine dans ce même numéro. ↩︎