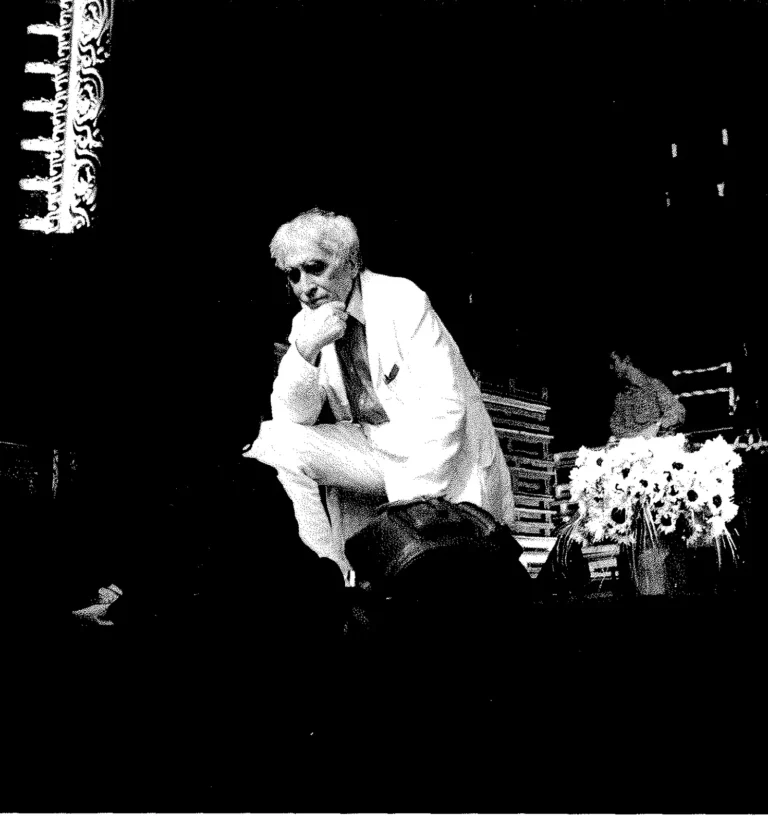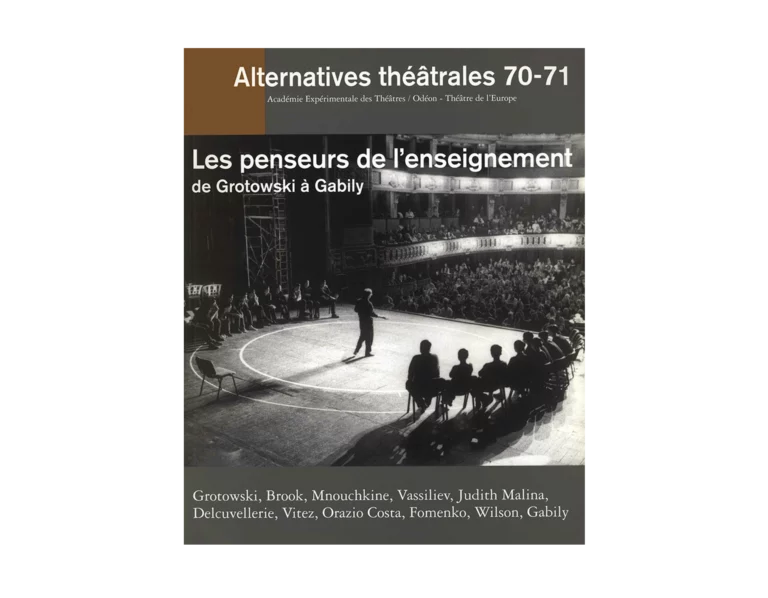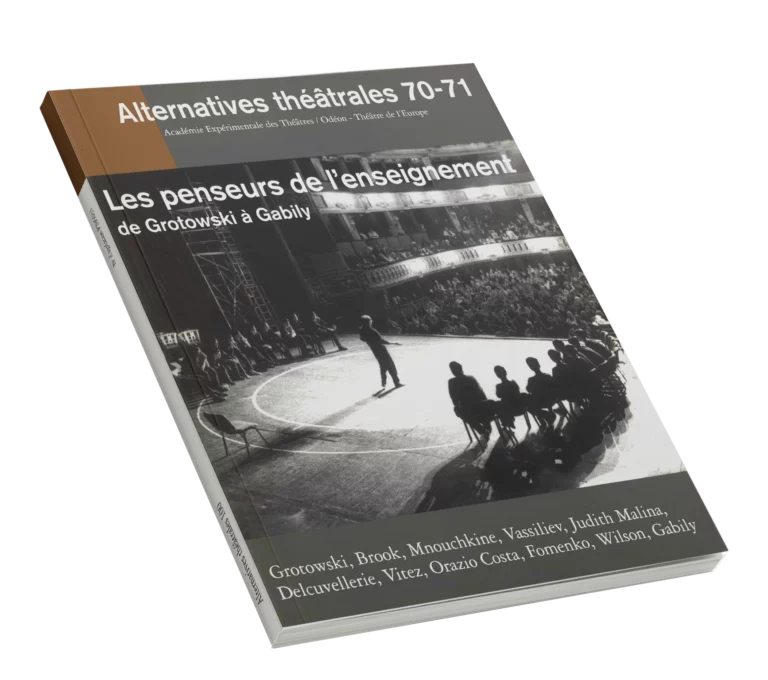« Vous avez crée une grande école, toute une culture »
C. S. Stanislavski à Max Reinhardt, le 24 mai 1930.
Mise en scène et pédagogie
À QUELQUES EXCEPTIONS PRÈS, l’enseignement du théâtre émerge en même temps que la mise en scène qui lui accorde un rôle prééminent. Ceci parce que la mise en scène fonde son projet de renouvellement du théâtre sur l’élaboration d’un acteur différent dont le metteur en scène se charge d’assurer la formation. La pédagogie, dans le sens moderne de cet exercice, est entièrement instrumentalisée : son rôle consiste à forger un outil à même de satisfaire les exigences du metteur en scène. Si, en France, le Conservatoire préparait les élèves pour et dans l’esprit d’une institution, la Comédie-Française, commanditaire et récipiendaire unique, l’apparition de la mise en scène va entraîner un déplacement radical. Désormais c’est la démarche originale d’un metteur en scène et non pas l’esprit d’une maison traditionnelle qui détermine le sens et le type de formation. La pédagogie cesse d’être généraliste. Elle se personnalise. Peu importe que cette annexion à un programme individuel soit, explicitement, assumée ou non car, illusion nécessaire, chaque metteur en scène, tout en préparant un comédien pour soi, prétend engendrer un comédien autonome. Le programme d’études de Stanislavski diffère du programme de Meyerhold ou de Copeau : les exemples peuvent se multiplier. Le metteur en scène s’adjoint le statut du pédagogue au nom de la radicalité de son entreprise : désormais il ne peut plus hériter des comédiens, il doit les produire. « Ne parle pas, formes les acteurs » conseillait Max Reinhardt
Cette pédagogie inspirée par un programme peut emprunter deux voies distinctes. Les metteurs en scène qui se réclament du théâtre d’art, presque tous, ouvrent des espaces de formation, contigus à la structure centrale : cela explique la multiplication des ateliers, des studios, des laboratoires. Là, lui-même et ses collaborateurs se consacrent à l’accouchement du comédien nécessaire. Il doit porter la marque de l’esprit qui anime ces directeurs de conscience que sont les directeurs du théâtre d’art, Stanislavski, Copeau, Jouvet … Le travail se présente comme spécifique, préliminaire indispensable au travail ultérieur, réclamé par l’imminence du spectacle. Cette pédagogie pourrait être définie comme une pédagogie frontalière. Et la plupart des metteurs en scène qui l’appliquent vont s’employer à rendre poreuses, perméables, les frontières entre la salle de cours et la salle de théâtre. Pour Antoine Vitez, accomplie sur les conseils d’une étudiante, cette transgression servit même de déclencheur libérateur. « Pourquoi es-tu si novateur dans la pédagogie et si conservateur dans la pratique théâtrale ? » lui demanda-t-elle. Confronté à la lucidité de ce constat, Vitez décida de supprimer toute séparation et d’instaurer entre l’école et le théâtre le principe des vases communicants.
D’autres metteurs en scène, également sinon plus préoccupés par l’élaboration d’un autre acteur, vont adopter l’autre voie, réfractaire à l’autonomie de l’outil pédagogique, fût-il étroitement affilié à leur propre outil de travail. Certes, ils ne se réclament pas du théâtre d’art avec la ferveur de leurs collègues, ils veulent même le dépasser par la réforme du jeu. À eux, créer et former, indissociablement, leur apparaît comme étant un processus unique, anime par un projet commun. Longtemps Brook, Grotowski, Mnouchkine ont rejeté l’approche bicéphale, création-pédagogie, au nom de l’importance accordée aux répétitions assimilées à une pédagogie de l’intérieur. Cette fois-ci il n’y a plus de frontières, même commodes à franchir, puisque le théâtre lui-même est pensé comme un site pédagogique. C’est au sein même de l’équipe théâtrale que s’accomplit l’effor’t de préparation. Il suffit d’interroger les comédiens, de voir les films consacrés aux Exercices de Grotowski ou aux Secrets de Carmen de Brook pour se convaincre de la réalité de cette approche.
Mais écartons toute extension abusive du concept de metteur en scène-pédagogue : il ne recouvre pas l’intégralité de la profession. Interroger le refus de certains, leur réticence à l’égard de la pédagogie, permet de dresser un vaste catalogue de motivations. D’abord il y a ceux qui ne disposent pas de l’eros pedagogicus car ils considèrent pouvoir s’accomplir dans le seul exercice de l’art de la scène et s’avouent indifférents à l’artisanat de la pédagogie. Le fait de travailler avec des acteurs étrangers dont ils peuvent se servir sans préparation préalable ne leur semble pas être un obstacle. Sceptiques à l’égard de la pédagogie, ils privilégient la confiance faite à l’acteur comme matériau artistique aux dépens de l’espoir, en quelque sorte proche de l’esprit des lumières, propre aux partisans de la formation. Ce type de metteur en scène s’épanouit dans le contexte de la parité avec ses partenaires et non pas de la fascination qu’exerce le maître reconnu sur l’acteur en germe. Peter Stein pour expliquer son refus citait la phrase d’Homunculus, dans FAUST, lorsqu’il est appelé à devenir le roi des nains : « On n’est grand qu’avec les grands ». Le metteur en scène, laisse-t-il entendre, est flatté par la séduction narcissique exercée auprès de ses élèves.
À ces hypothèses préliminaires de l’accord ou du scepticisme à l’égard de la pédagogie s’en ajoute une troisième que je me refuse de prendre en compte : la pédagogie culinaire. Pédagogie justifiée seulement par un salaire qui explique la dispense d’un enseignement prêt-à-porter. Enseignement moyen qui assure la vie de bon nombre de professeurs et d’institutions. La pédagogie culinaire se contente de fournir un enseignement généraliste coloré de la teinte d’une identité incertaine d’artiste mércenaire. Tout dépend de la relation à l’argent : pour certains il sert d’excitant euphorique, pour d’autres, plus cyniques encore, il est la seule raison d’être d’un contrat pédagogique.

La pédagogie-processus
Elle s’appuie sur la richesse d’une identité d’artiste et elle s’accorde comme principe, pour reprendre une phrase célèbre, de « donner du temps au temps ». Cette pédagogie qui se développe dans la durée n’est sur le plan mental que le double rêvé du programme des répétitions à long terme, formulé dès ses débuts par Stanislavski. Les deux activités cherchent à modifier les habitudes occidentales à partir des mêmes exigences : la personnalisation d’un discours et la maturation progressive. Répéter et enseigner, deux activités qui se soumettent aux mêmes exigences car ce sont les deux versants de la décision commune de changement.
Cette pédagogie affirme la signature d’enseignant. Il se charge d’une classe et assure sa progression. Cela exige une coexistence prolongée : la classe et le professeur partagent leur temps pendant la durée d’un cycle. Cela mène à une conaissance réciproque, avec ce que cela engendre comme aprofondissement et ressentiment : c’est d’un mariage limité dans le temps qu’il s’agit.
Le processus exige du temps car ainsi seulement l’évolution peut s’engager et la transmission s’effectuer. Cette pédagogie finit par instaurer entre le professeur et l’élève une relation particulière qui mène presqu’à une connaissance réciproque. Elle finit en pédagogie de l’intime.
La pédagogie-processus fait sienne les valeurs du cheminement qui mène du plus simple vers le plus difficile. Le professeur accompagne l’élève tout au long de ce parcours supposé ascensionnel, et cela grâce au travail commun développé dans la durée. Cette approche s’appuie sur la confiance faite à l’éducation : elle est supposée à même de dilater progressivement la créativité de l’élève. Pédagogie socratique convaincue de pouvoir accoucher la créativité du futur comédien.
La pédagogie-processus implique une connaissance partagée et, parvenue à son terme, elle fonde ce qu’on appelle en France « les familles » de jeunes comédiens réunies autour du metteur en scène-pédagogue. Celui-ci, après avoir suivi durant un laps de temps prolongé ses élèves, invite certains à se joindre à lui pour des spectacles à venir. Cela produit, par la nature des choses, de l’effervescence autant que de la déception au sein du groupe rendu « homogène » par la durée. Le choix opéré engendre des blessures plus vives. La « famille » se constitue sur les ruines de « la classe ».
La pédagogie-processus, qui a Stanislavski pour chef de file, ne se justifie à mon sens que pratiquée par un artiste qui exerce ou a exercé pleinement son métier car ainsi il se charge de répondre par son enseignement aux besoins éprouvés et aux voeux formulés dans le travail. Sans cette expérience, la pédagogie se contente de satisfaire à une définition générale du théâtre, dépourvue de la réalité d’une approche personnelle nourrie par le travail en dehors de l’école, dans la perspective du spectacle public.
La pédagogie-processus fait du temps la valeur première, mais, justement, le revers de cette intimité prolongée peut produire une contamination abusive de jeune comédien qui, au terme de son parcours, se présente comme un acteur formé pour une esthétique bien précise, celle de son maître. l’identification à lui peut lui permettre d’intégrer vite « la famille » ou, sinon, d’être repoussé car trop marqué par l’esthétique de son pédagogue. Au fond, à travers le temps, tout se joue entre l’imprégnation et la résistance, sur cet équilibre fragile ; sur cette alternative de l’élève comme double du metteur en scène ou comme créateur rattaché à une esthétique. Le succès du maître autant que du disciple dépend de la réponse juste à cette confrontation. Enjeu de la pédagogie-processus.
Un danger moins fréquent pointe, mais il mérite tout de même d’être relevé. C’est l’oubli de la durée au nom d’une perfection utopique. Alors l’école finit en propre but du travail aux dépens de la scène car, alors, l’accomplissement pédagogique ne se mesure plus à l’aune d’une activité théâtrale, mais à celle d’une maniabilité absolue des ressources de l’élève. Celui-ci devient l’oeuvre à accomplir — voici l’horizon de quelqu’un comme Anatoli Vassiliev qui renverse les données habituelles afin d’ériger la formation en pratique qui se suffit à elle-même. Ce qui motive le travail, c’est l’acteur comme instrument absolu. Assimilé à un Stradivarius du corps il se constitue en horizon d’attente pour la pédagogie-processus. Elle procède à l’immersion dans le travail sans fin qui se dérobe aux exigences de la production théâtrale et s’interdit l’achèvement d’un spectacle. Le faire pédagogique occulte l’oeuvre scénique et le processus lui-même s’inscrit dans une inépuisable entreprise d’autogénération. Il fonctionne sans ce principe de réalité que représente le spectacle. La pédagogie-processus touche là à ses limites. Et en même temps affirme ses ressources utopiques.
La pédagogie-événement
À l’opposé de la première hypothèse, elle se définit par la brièveté de la rencontre et, dans le meilleur des cas, par la nature particulière de l’intervenant : soit artiste d’exception, soit spécialiste d’un domaine peu fréquenté. Cela explique aussi bien la durée limitée que la valeur exemplaire de ce type de pratique intensive. Ici l’évolution de même que la maturation propres à la pédagogie-processus seront sacrifiées au profit de la rapidité et de l’étonnement. Cette accélération s’accompagne de la surprise, toutes deux également indissociables dans ce type d’approche pédagogique. Cette conjonction légitime, voire même assure la réussite d’un stage, d’un atelier ou d’un chantier. Ils n’ont de raison d’être que dans la mesure où ils se constituent comme modèles pratiques d’une pédagogie autre, pédagogie de l’événement.
L’événement éveille un désir, découvre un territoire, révèle une pratique, mais, en même temps, par sa nature même, il reste incompatible avec toute activité progressive : pour fonctionner il doit éblouir et, ensuite, laisser une trace dans l’élève qui en a subi l’attrait et qui peut poursuivre le travail sur lui-même à partir de cette rencontre inhabituelle. Ici tout dépend de la force d’impact de l’événement proposé comme de la capacité de résonner du disciple convié. Pédagogie météoritique. Pédagogie qui se réclame des vertus de la pensée fragmentaire de même que la pédagogie-processus se réclame des vertus de la pensée systématique. Deux modes d’être, deux modes d’enseigner …
La pédagogie météoritique a été imposée en France, de manière polémique, par Antoine Vitez qui se rebellait ainsi contre l’autorité traditionnelle de la pédagogieprocessus (pédagogie à son époque simplement généraliste et institutionnelle car dispensée par des sociétaires de la Comédie-Française). À l’unité évolutionniste des programmes il a opposé la dislocation fragmentaire, principe qui régissait aussi bien son approche de jeu que sa pratique pédagogique. L’événement comme expérience pédagogique sans répit en mouvement, voici l’esprit de la pédagogie vitézienne.
Ce principe fut développé ensuite par bon nombre d’écoles qui proposent aux élèves une pluralité d’événements. Ceux-ci sont censés les mettre en contact avec des personnalités et des domaines peu visités. Mais l’option adoptée se justifie aussi par la surcharge de travail de certains metteurs en scène sollicités qui ne disposent que de plages horaires réduites de même que par des motivations économiques. Peu importe les raisons, ce type de pédagogie permet aux élèves de participer à une rencontre qui brise le cours prévu de l’enseignement et parfois ouvre un horizon inattendu.
Dans la pédagogie-événement tout travail sur la croissance organique est absent, car elle entend opérer plutôt par chocs à même de se constituer en exemples autant qu’en interrogations pour l’élève qui en profite. De la confiance faite à l’éducation par la pédagogieprocessus l’accent se déplace vers la confiance faite à la réception du jeune participant. Si le danger d’imprégnation s’avère alors peu menaçant, il y a par contre le danger d’illusion qui se dessine : l’élève qui a travaillé avec le maître pour un court laps de temps se croit capable d’intégrer un grand ensemble professionnel. Le stage peut produire cet effet de trompe‑1′ oeil auquel succèdent les désillusions les plus cruelles. Malgré cela, nous pouvons reconnaître que cette pédagogie remplace la lenteur sécurisante du processus par la vitesse de l’aventure, avec tout ce qu’elle comporte d’unique et d’irrépétable.
Pareille approche convient aux metteurs en scène pour qui le travail pédagogique ne peut être qu’ épisodique. Kantor, Grüber, plus récemment Chéreau … Ils se dérobent à l’enseignement dans la continuité et ne peuvent s’y impliquer que de manière discontinue. Le stage comme événement les concerne, eux, autant que les élèves. Ils s’exercent ainsi à la pédagogie comme à une expérience ponctuelle. Et aussi à un dialogue fulgurant avec les générations à venir. Ils aiment le baiser rapide et non pas l’étreinte prolongée.
À ce type d’évenement, lié à une identité d’exception, peuvent s’en ajouter d’autres qui permettent de découvrir des pratiques peu communes, des domaines rarement visités : la danse bhutô, le passage de la parole aux chants, les techniques du conteur ou du cirque. Pareilles initiatives se justifient aujourd’hui en raison même d’un débordement des frontières du théâtre et la pédagogie ne peut rester indifférente à une telle mutation. Le théâtredanse, le passage du théâtre à l’opéra, le nouveau cirque, le théâtre de proximité — toutes ces pratiques réclament un élargissement de la pédagogie théâtrale. À un théâtre sans frontières doit répondre une pédagogie sans frontières : il est indispensable que cet accord se fasse sous peine que la pédagogie perde le contact avec la réalité dynamique, en mouvement, du spectacle vivant. Cette fois-ci le recours à l’événement ne se justifie plus par la présence d’une figure d’exception, mais par la volonté de procéder à la démultiplication des pratiques théâtrales hétérogènes. Les stages qui familiarisent l’élève avec les nouvelles approches l’aident à élargir la connaissance des possibles mais, ensuite, s’il en éprouve l’envie c’est à lui de poursuivre sur la voie amorcée. La pédagogie ouvre le chemin, mais seul le disciple peut voyager.
Cette pédagogie-là se présente comme le versant opposé de la pédagogie-processus : elle découvre une multitude de possibilités là où l’élève ne se familiarisait qu’avec une seule, elle apporte la vitesse là où l’on privilégiait le mûrissement, elle cultive la discontinuité là où jadis la continuité régnait. Mais cela peut conduire à l’errance et à l’atomisation car, dispersée, cette pratique mise sur l’aptitude de l’élève à assembler ensuite en lui-même cet éventail d’hypothèses. Finalement, si cette pédagogie ne s’adresse pas à des élèves particulièrement avancés, elle peut échouer dans un insupportable zapping où le désordre l’emporte et aucune direction ne se précise. La pédagogie de l’événement encourt le risque de l’éclatement donjuanesque tandis que la pédagogie-processus encourt le risque de la monotonie d’une relation excessivement prolongée. La pédagogie-processus se légitime par la caution d’une présence d’artiste à identité forte qui assure la transmission de son savoir, tandis que la pédagogie-évenement propose une approche fédéraliste en raison même de l’absence d’un pareil centre. Tout se joue entre un trop plein de présence et un manque.
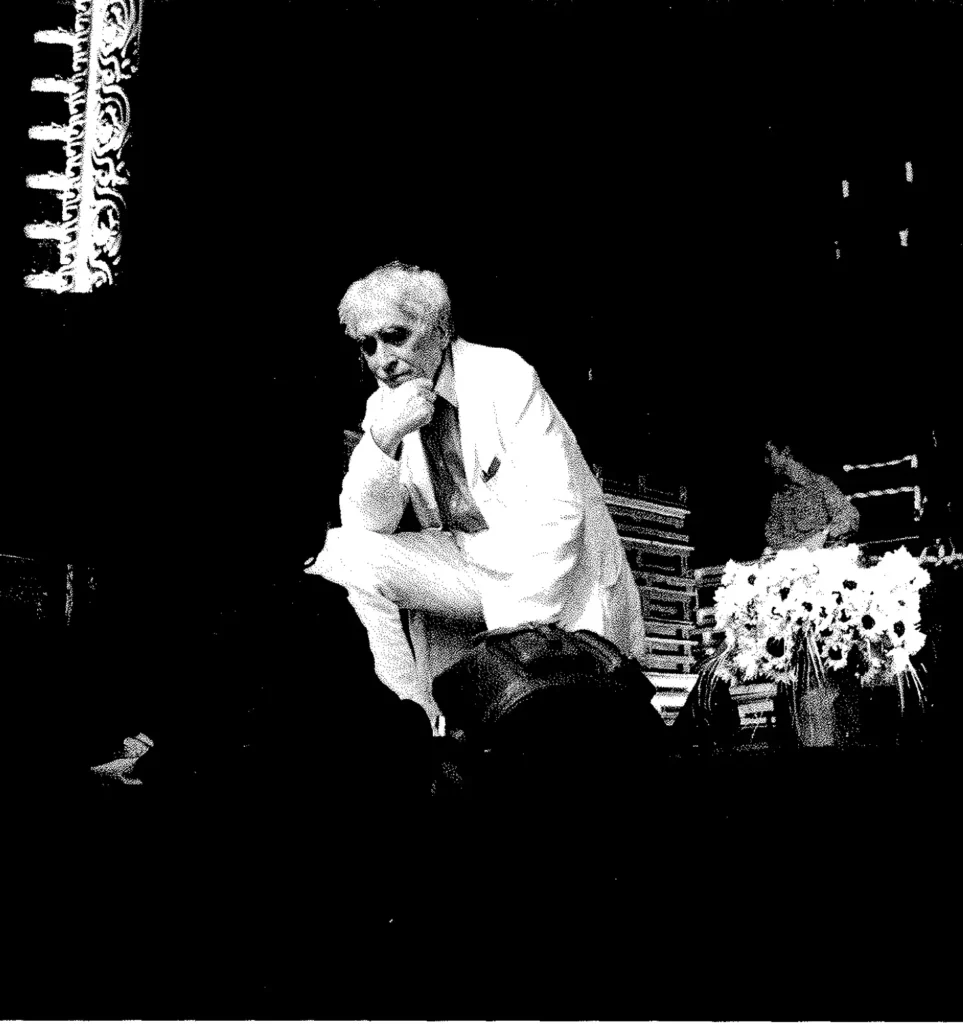
La pédagogie alternée
Cette pédagogie-là ne porte pas avec évidence la signature d’un grand maître, mais elle échappe aussi aux dangers d’égarement qui menacent la pédagogie-événement. Certes, la pédagogie alternée pèche par un déficit de radicalité, mais elle possède des vertus qui méritent d’être évoquées.
Cette pédagogie tresse le processus pris en charge par un artiste artistiquement convenable, mais pas suffisamment riche pour assurer la longévité d’une relation pédagogique étendue dans le temps. Alors, stratégie pertinente, le désir de renouvellement sera satisfait par la présence cyclique des invités qui relancent la vie du groupe grâce à des événements pédagogiques. Ainsi sur l’unité assurée par le pédagogue peuvent se greffer des actions qui garantissent une alternance bien utile à la dynamique d’une classe. Par là l’attention subsiste sans que la dispersion s’instaure.
Le risque de la pédagogie alternée concerne surtout le retour au processus après avoir éprouvé la force de l’événement : comment faire pour que cela ne soit pas vécu sur le mode du désenchantement, mais bien au contraire sur celui du désir de retrouvailles avec la matrice communautaire ? Idéalement, la pédagogie alternée s’emploie à sauvegarder l’unité sans l’ériger en loi : elle cherche seulement à l’enrichir, à la mettre à l’épreuve par le recours à l’événement. Car si l’unité dispose d’un vraie force elle parvient à résister … et d’ailleurs les événements ne trouvent de raison d’être que par rapport à cette ligne qui leur préexiste et qu’ils doivent, un instant seulement, briser. Ils apportent l’air frais d’une liberté provisoire. Celle d’une expédition hors du cadre. La pédagogie alternée sauvegarde la vitalité d’une pédagogie qui, faute de grand maître, risque de devenir abusivement personnalisée ou, dans l’autre cas, excessivement éclatée.
Nous sommes ici, en Roumanie, dans le pays de Brancusi, et sa célèbre Colonne de l’infini peut fournir la représentation concrète de la pédagogie alternée. Les rhombes qui s’accumulent sur la verticale, pareils aux événements pédagogiques, ne tiennent ensembe que grâce au poteau secret qui les relie : fiançailles du mouvement et de l’unité. Elles coexistent par cette alternance de la dilatation et du retour à soi, par cette pulsation de la cohérence et de la diversité. Dans La Colonne de l’infini nous pouvons reconnaître le modèle visuel de la pédagogie alternée qui allie dans une tension inassouvie la pédagogie-processus et la pédagogie-événement.