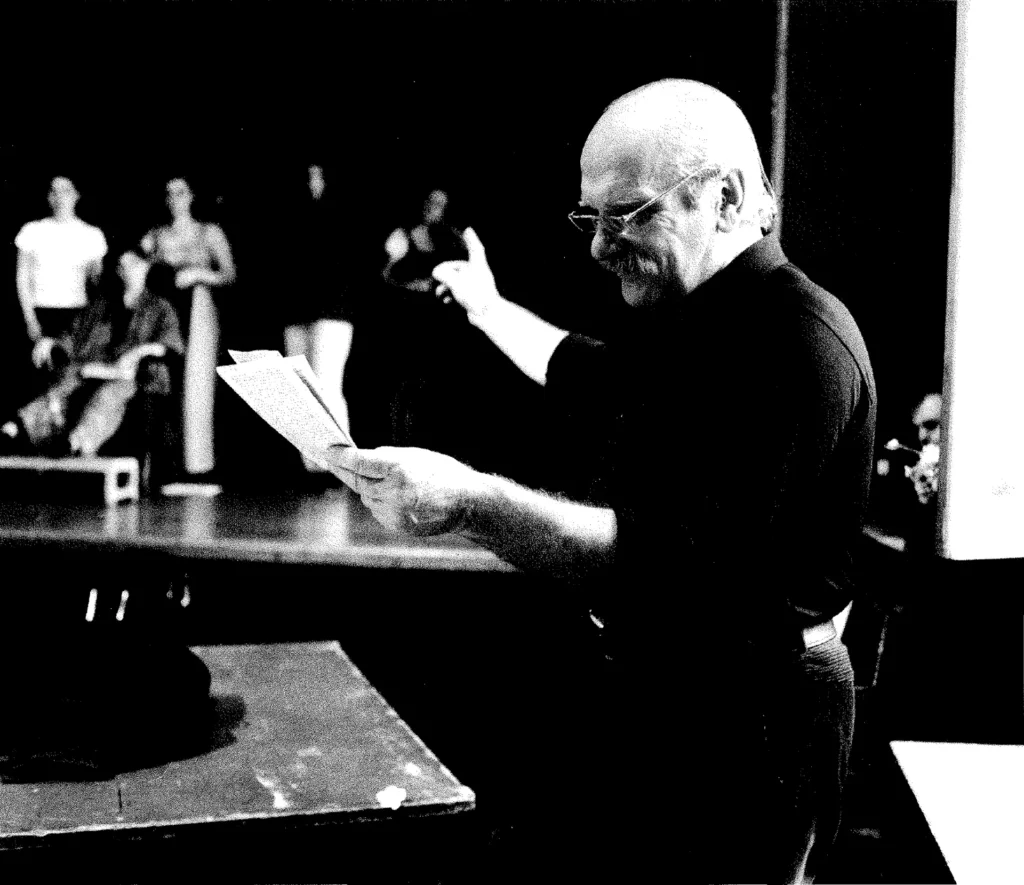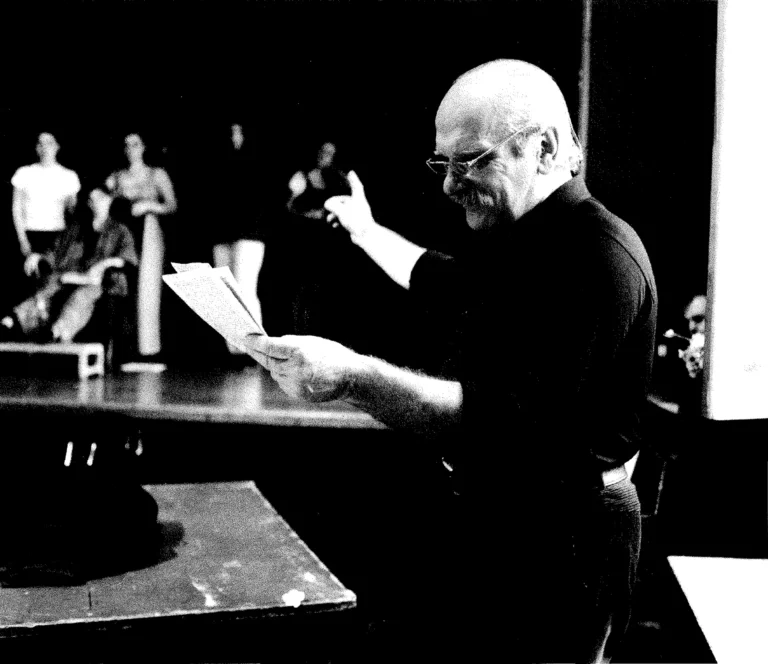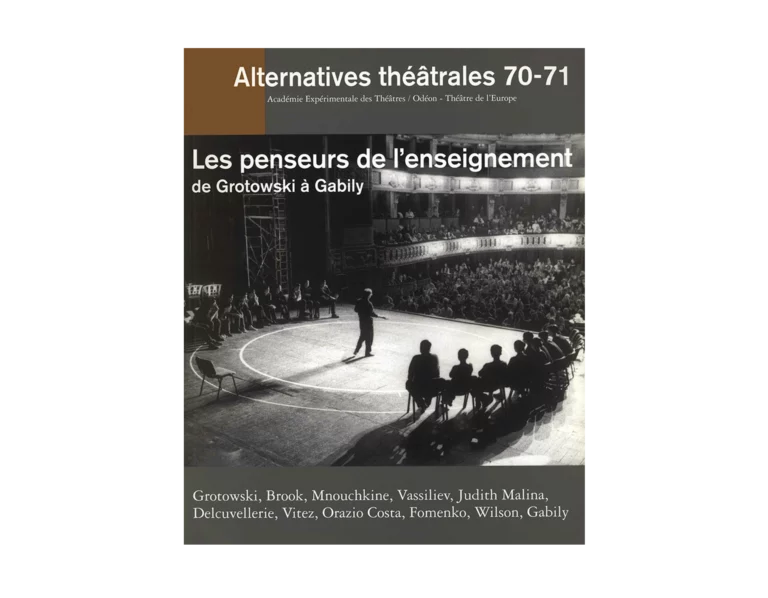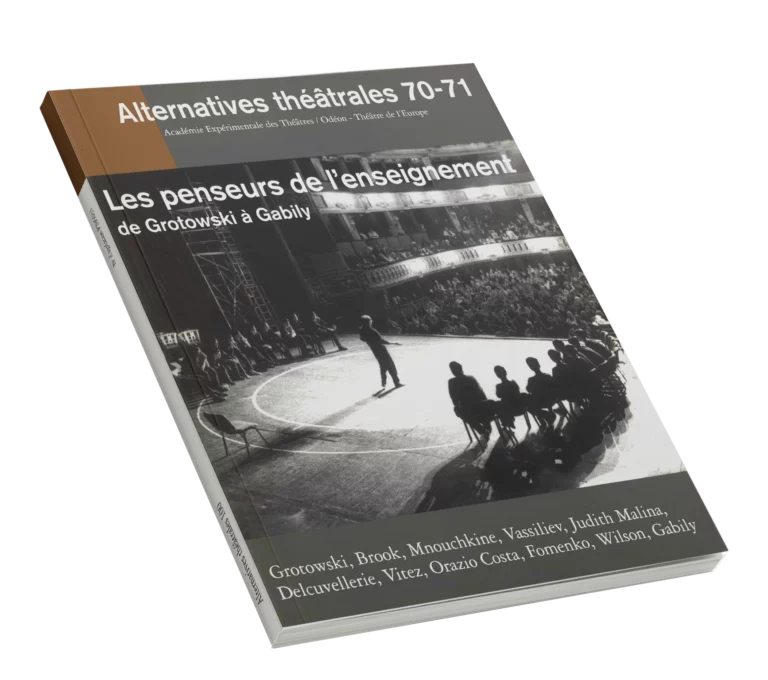EN ÉTÉ 1988 a eu lieu, à l’Académie d’Art Théâtral de Russie (l’ancien GITIS) l’audition annuelle des élèves acteurs. C’est le metteur en scène Piotr Fomenko qui sélectionnait le groupe. Je ne sais pourquoi cette année, les astres étaient favorables à cet éternel vagabond et proscrit du théâtre soviétique qui avait quitté en 1981 le théâtre de répertoire et de l’alternance pour la pédagogie. Un jour Fomenko avoua : « sans le GITIS je n’aurais pas survécu au théâtre, et si je n’avais pas survécu au théâtre, je n’aurais pas survécu … » En 1988 le destin a voulu offrir à Fomenko une chance de créer sa propre Famille ainsi que le chantier de sa propre Maison. Cinq années plus tard, en automne 1992 la ville de Moscou a officiellement enregistré la naissance du nouveau théâtre, l’Atelier Piotr Fomenko. Le nom de ce théâtre s’est imposé tout seul. Le mot atelier, qui désigne aujourd’hui tout groupe d’un maître, devint tout simplement le nom du théâtre.
Mais un nom n’est pas simplement un mot utilisé pour appeler ou nommer. Les anciens croyaient fermement que le nom prédétermine le destin. Ce n’est pas un hasard si les moines, se mettant au service de Dieu, renonçaient à leurs noms séculiers et recevaient un nouveau baptême. Une autre vie, un autre homme, un autre nom.
Dans le cas du théâtre de Piotr Fomenko, il est inutile de se casser la tête pour entrevoir un sens caché à ce nom, il est évident. C’est tout d’abord un rappel (et à soi-même en premier lieu) que la formation ne s’achève pas en dehors de l’Académie.
Que l’âme ne s’endurcisse pas. Qu’on ne se laisse pas entraîner par la routine quotidienne. Qu’on ne désapprenne pas à apprendre. Qu’on n’ait pas peur de regarder en arrière tout en avançant… Voilà quelques-uns des postulats de l’Évangile théâtral selon St. Foma.
Comment l’Atelier Piotr Fomenko arrive-t-il (et y arrive-t-il vraiment ?) à vivre selon ces lois tout en restant le théâtre de l’alternance (c’est-à-dire jouer les spectacles et faire des créations, partir en tournée) ? Pour essayer de comprendre les particularités de la méthodologie pédagogique de Fomenko citons quelques exemples de la vie quotidienne de son théâtre. Car, à notre avis, il est impossible de parler de Fomenko, le maître, et d’ignorer Fomenko, le metteur en scène. Pédagogie et mise en scène, ces mots ont la même racine pour lui.
Le point de rencontre le plus évident de ces deux cheminements est le GITIS. Ici, on apprend l’abc : le système Stanislavski, exercices, analyse, travaux d’élèves… Mais avant de communier aux sacrements du métier théâtral les futurs élèves doivent passer par toute une série d’auditions, épreuves, examens… Le travail du pédagogue commence déjà à cette étape : capter la personnalité dans ce flot humain ; deviner derrière une apparence maladroite un futur héros ; ne pas avoir peur de prendre les risques et accepter dans son groupe une personne sans aptitudes évidentes d’acteur mais qui est intelligente et sensible. Travail difficile et responsabilité énorme. Mais, et c’est le plus important, en formant son groupe il ne faut pas rassembler un simple bouquet de personnalités où chacun existe à part, mais un ensemble uni, bien orchestré. C’est rarement réussi. Avec la promotion de 1988 cela a marché.
Le metteur en scène dit qu’il n’a pas de « modèle » particulier du groupe d’élèves qu’il doit constituer. « J’essaye de m’adapter à ceux qui viennent ici. C’est le mouvement de rencontre — d’eux vers moi et de moi vers eux ». Il est très important, en observant l’inconnu, de voir l’essentiel, d’écarter tout ce qui est superflu et de ne pas effacer son passé. Selon l’intime conviction de Fomenko, il est impossible de construire une vie nouvelle en démolissant les anciens fondements. C’est son idée la plus chère, la pierre angulaire de sa foi théâtrale (retrouver ses racines, ses sources — il en parle presque à chaque répétition). Son Atelier repose, en grande partie sur ces principes, l’Atelier, où par les caprices du destin se sont retrouvés des écoliers d’hier et des gens adultes avec leur expérience artistique et humaine. « Impossible de revoir, briser, réapprendre. L’homme continue à vivre, son destin est justement le matériau de construction ».
Afin de comprendre à partir de quelles « briques » a été construit le bâtiment de L’Atelier de Piotr Fomenko, je vais raconter quelques petites histoires…
Avant d’entrer au GITIS, Karen Badalov a fait ses études à l’Institut d’Acier et d’Alliages de Moscou. Tout en apprenant le métier d’ingénieur il fréquentait le Studio de Théâtre sous la direction de G. Matskiavichus. Aujourd’hui, pour Karen les obstacles physiques n’existent presque plus. Il a un corps docile et intelligent. Fomenko ressent un plaisir presque enfantin à travailler avec cet acteur car il conjugue brillamment une incroyable finesse de perception (Karen ressent l’espace du plateau comme un serpent, avec sa peau) avec une sensibilité qui lui permet de comprendre le metteur en scène à demi-mot. Demi-nuance. Et enfin, il dispose d’une intelligence aiguisée par la formation technique.
Roustem Yuskaev, lui aussi, a une Grande École à son actif : le département de psychologie de la faculté de biologie de l’Université de Saratov. Mieux encore, Roustem a travaillé en tant que psychologue dans une usine militaire pendant deux ans. Quand il s’est présenté au concours du GITIS, l’idée qu’il se faisait du métier d’acteur était assez éloignée de la réalité. Mais Fomenko a perçu l’essentiel chez Roustem — sa capacité à comprendre la psychologie humaine, à sentir et à percevoir les motivations du comportement. Roustem est passé maître en « analyse scénique ».
La biographie de Taguir Rakhimov contient des pages de toutes sortes : il a fait ses études à l’École Maritime de Nahodka, a travaillé comme gardien, comme employé de chaufferie, mécanicien, ainsi que sur un bateau de pêche, il a construit des chemins de fer, il a été marionnettiste dans un théâtre de marionnette. Tout le monde voyait bien que Taguir était un acteur né, mais … dans le système d’éducation supérieure de Russie, il existe une interdiction liée à la « limite d’age » et la personne qui franchit cette limite ne peut plus espérer la possibilité d’une autre formation. Mais Fomenko a pris le risque, violé les règles, en fermant les yeux sur les données de son passeport. Tous les deux ont été gagnants.
Superbe et énigmatique comme des visages de saints sur les icônes orthodoxes, intelligente et intellectuelle Galina Tunina a participé au concours du GITIS alors qu’elle était déjà comédienne au Théâtre Drama de Saratov. Elle a pris la décision de poursuivre sa formation d’actrice à Moscou parce qu’elle a compris : « à Saratov je n’apprendrai pas grand chose. Le théâtre prenait beaucoup mais donnait très peu en échange ». Pour quelqu’un qui aspirait à quitter l’école le plus vite possible (« Après le collège, je me suis dit : ça suffit »), il est assez étonnant qu’elle ne se soit pas lassée du travail quotidien de perfectionnement personnel, dans son métier autant que dans la vie. Au théâtre, Galina est une des actrices qui lit et réfléchit le plus.
Et non sans raison. Sans doute, nulle part ailleurs à Moscou les comédiens ne lisent et ne réfléchissent autant qu’à l’Atelier (apparemment, avec cette phrase de Boris Pasternak en mémoire : « l’âme se doit de travailler… »). Ce sont les femmes qui mènent la recherche dans le domaine littéraire. Les hommes, aussi étrange que cela puisse paraître, se tournent plutôt vers cet art si sensible qu’est la musique.
L’âme musicale du théâtre, le seul « fils adoptif » de l’Atelier, c’est Kiril Pirogov qui a fait ses études à l’École Théâtrale Schukine (dans la promotion de V.V. Ivanov). Son oreille absolue le rend profondément sensible à la parole : personne n’entend aussi bien que lui les moindres nuances de l’intonation. Quand Kiril joue dans les spectacles, c’est comme s’il improvisait une interminable variation de jazz : il essaye sans cesse, cherche, vérifie, chaque fois modulant un tout petit peu différemment la mélodie du rôle …
Donc, en été 1988, la Providence a rassemblé les gens tout à fait différents, complexes et très intéressants. Une fois le groupe formé, vint l’heure d’approcher les secrets de la profession. La première année fur consacrée à la technique, au métier. Durant cette première étape Fomenko ne travaille presque pas avec ses élèves, les livrant entre les mains des autres pédagogues.
Cette promotion, qui a donné la naissance à l’Atelier, était unique aussi parce qu’à l’époque, à côté de Fomenko, travaillaient de formidables metteurs en scène : Sergueï Jenovatch et Evgueni Kamenkovitch. Très différents de tempéraments, avec une manière de répéter presque contraire, comme on dit « le feu et la glace ». En dépit de leur travail dans des « grands » théâtres, tous les deux vivaient les problèmes des élèves : ils participaient à l’entraînement, aidaient les étudiants dans leurs travaux, montaient les spectacles. Grâce à leurs efforts au sein du groupe on cultivait une ambiance très amicale, presque familiale, où tout le monde vivait les problèmes des autres. La perception de soi-même en tant que partie d’une unité, le sentiment de son appartenance à la famille théâtrale ont servi à créer le ciment qui aujourd’hui encore consolide l’édifice de l’Atelier. « Soyez attentifs les uns aux autres, rappelle constamment Fomenko à ses acteurs, le secret d’un théâtre vivant repose au sein d’autrui, pas en soi-même ».
Piotr Fomenko, lui, définissait la direction du groupe : il surveillait la préparation des travaux d’élèves, approuvait (ou pas) les oeuvres qu’ils choisissaient, analysait les textes, conseillait, aidait… Comme par exemple Ivan Popovski, un de ses élèves-metteurs en scène, venu de Macédoine. À peine avait-il appris le russe, qu’il osa affronter l’AVENTURE de Marina Tsveraeva, une poétesse presque douloureusement sensible aux mots. « Tsvetaeva ? » s’étonna Fomenko, et après une longue et terrible pause devenue déjà célèbre, il ajouta : « bon, ce ne serait pas honteux de tomber d’un tel sommet… » Et il s’est mis, avec Popovski, à faire l’analyse de la poésie : « Fomenko est un maître de la partition musicale du texte. D’abord il me semblait que c’était de la pure technique : le mètre, les mesures, pourquoi faire une pause. Mais bientôt j’ai commencé à comprendre à quel point ce travail de metteur en scène était fin et précis », se souvient Ivan.
L’essentiel pour Fomenko est non seulement de former (c’est-à-dire transmettre la somme de certains acquis du métier) mais aussi d’élever (c’est-à-dire former le caractère, convertir à sa foi, si on veut.) Lui, c’est vrai, il préfère un autre mot : « cultiver ». Ce processus, long et imprévisible est pour Fomenko, l’oeuvre la plus compliquée et la plus passionnante, car pour lui, former un acteur signifie former une personnalité. Dans cette situation, professionnelle et humaine, il y a sans doute, une bonne partie d’un sain égoïsme. Fomenko essaye de s’entourer de gens qui le passionnent, travailler avec de simples interprètes l’ennuie. « Bien sûr, souvent il faut construire quelque chose pour un acteur, mais après il est important de ne pas rater le moment où il faut le libérer ».
Fomenko préfère définitivement l’esprit au corps. Il ne se lasse pas de rappeler aux acteurs qu’il faut soigner leur « outil de travail » ( corps, visage, voix), le maintenir en bon état, il s’inquiète, se fâche, s’indigne si quelqu’un tombe malade… mais il continue à travailler les âmes, oubliant la chair.
C’est pourquoi, les « fomenki » comme les appelle le monde théâtral moscovite, sont des gens non seulement intéressants mais aussi curieux. En voici juste un exemple. Le travail sur la pièce de B. Freel, DANSES À LA FÊTE DE LA MOISSON, qu’a effectué Priit Pedayas un metteur en scène estonien invité, a eu lieu en même temps, que la Troisième Olympiade Mondiale de Théâtre à Moscou. Ce festin d’impressions théâtrales qui a submergé Moscou n’a pas pu laisser indifférents les acteurs de Fomenko. En dépit de la situation difficile dans laquelle se trouvait le théâtre ( tout d’abord un délai très réduit de création) et la fatigue quotidienne, ils faisaient tout leur possible pour ne pas rater ne serait-ce qu’un seul chef-d’oeuvre de mise en scène, présenté à Moscou. Chaque répétition matinale commençait par la discussion du spectacle vu la veille. Essayer de reprendre un des trucs de l’Arlequin de Ferruccio Soleri, trouver un thème musical pour l’OTHELLO de Nekroscins, partager les émotions…
C’est cette curiosité professionnelle aiguë, cette attention et le goût de la vie qui leur sont propres grâce, en grande partie, à Piotr Fomenko, et à ses fréquences discussions quasi philosophiques. Pendant qu’on parle d’une répétition ou d’un spectacle il laisse échapper, comme par hasard une citation ; ou bien il glisse en douce un conseil où aller, quoi voir, quoi lire… Il arrive que la trajectoire de l’analyse après une répétition se mette à dessiner des arabesques inimaginables. Une comparaison venue à l’esprit mène à raconter une histoire. Fomenko partage non seulement les faits de sa propre biographie (il ne parle pas souvent de lui-même), il enseigne à trouver les fils qui lient le passé au futur. Ces liaisons sont si fantasques que Fomenko, parfois, se laisse prendre lui-même dans la dentelle de ses propres paroles. Alors il est obligé de « marcher sur la gorge de sa propre chanson » (N.D.T citation de Maïakovski) pour que le flot de souvenirs ne l’entraîne pas dans des abîmes sans fond (soudain ils s’arrête à mi-mot, jette un regard fâché ou méfiant : est-ce qu’on l’écoute ? Il fronce les sourcils et : « C’est tout pour aujourd’hui … au revoir. ») Ces discussions et entretiens sont pris différemment par les comédiens de la troupe. Certains sont sincèrement intéressés, d’autres arrivent à peine à cacher leur impatience (Rentrer ! Vite chez soi !) Mais comme on dit, qui a des oreilles, entendra. Comprenant très bien qu’on ne force pas à aimer, Fomenko n’abuse pas de gestes impératifs ou d’ordres péremptoires. La dictature n’est pas dans son caractère. On ne peut pas forcer un homme à réfléchir, mais on peut l’intéresser, l’intriguer, le passionner…
Un des « bacilles » que Fomenko ne se lasse pas d’inoculer à ses élèves — c’est l’amour fanatique de la parole. Dans une de ses récentes interviews Fomenko a dit : « Pour moi, le théâtre c’est le verbe. C’est l’acte suprême, c’est l’essentiel, c’est divin. Au commencement fut le verbe… Pour moi c’est aussi la fin… » Cette attitude s’est forgée aussi grâce aux années passées à la Faculté des lettres de l’Institut Pédagogique et à sa formation inachevée à l’École de Théâtre d’Art de Moscou. (Ici Fomenko a connu les délices et les périls des modulations du texte, du jeu avec consonnes et voyelles, racines et terminaisons.) Même la formation musicale que le metteur en scène a reçue à l’École Gnessine et à l’École Ippolicov-lvanov dans la classe de violon, lui a servi. Fomenko est très sensible à la musique du texte c’est pourquoi tous ses spectacles semblent être crées selon les lois capricieuses de l’harmonie musicale.
C’est cette ouïe particulière, théâtrale, le don de percevoir la musique d’un texte de toute nature (prosaïque, théâtral , poétique) que Fomenko essaye pertinemment de développer chez ses élèves. Encore étudiants, ils ont frappé la critique non seulement par la virtuosité accomplie de leur jeu mais aussi par leur manière d’exister, naturellement et librement sur le « terrain » d’auteurs aussi différents que Shakespeare et Ostrovski, Faulkner et Tsvecaeva, Gogol et Blok… Devenu théâtre, l’Atelier ne cesse d’étonner : après la mise en scène de deux pièces du répertoire habituel — DE L’IMPORTANCE D’ÊTRE SÉRIEUX de Oscar Wilde (mise en scène de E. Kamenkovitch) et d’UN MOIS À LA CAMPAGNE de I. Tourgeniev (mise en scène de S. Jenovatch) — on s’est penché sur la restauration des pages brûlées de la deuxième partie du poème de Gogol LES ÂMES MORTES (mise en scène de P. Fomenko). La mise en scène de la pièce LES BARBARES de Gorki a été suivie par trois oeuvres basées sur les textes en prose. UN VILLAGE PARFAITEMENT HEUREUX tiré du récit de Boris Vakhtine, LE BONHEUR FAMILIAL, basé sur un roman de jeunesse de Tolstoï et, enfin, l’œuvre majeure du même Léon Nikolaevitvch, GUERRE ET PAIX. Toutes ces oeuvres ont été lues par les acteurs de l’Atelier avec leur Maître.
Regrettant l’art de la lecture lente qui se perd si rapidement aujourd’hui, Fomenko tente d’éviter les soi-disant « adaptations » dans son travail sur la prose. Sans se presser, minutieusement, revenant sans cesse en arrière, réfléchissant, précisant, se plongeant dans les profondeurs des entrecroisements astucieux des lettres, Fomenko concocte sa sorcellerie avec le texte. « Pénétrer dans un mot, derrière le mot, chercher du sens entre les mots » voilà où réside pour lui ce jeu divin et étrange qu’on appelle Théâtre.
C’est probablement grâce à cet amour ardent pour la parole russe que Fomenko éprouve une si grande difficulté dans une autre langue — en 40 ans de création dans différents théâtres russes, ses expériences de travail avec des comédiens étrangers sont rares. Fomenko traite cela avec l’humour imagé et mordant qui lui est propre en disant qu’il s’agit alors de « baiser à travers la vitre ».
Fomenko ne lit à ses élèves aucun cours théorique sur la spontanéité de la perception. On ne peut apprendre cette immersion dans l’univers d’un auteur, cette fusion sans réserve, qu’au cours du processus vivant des répétitions, dans le contact direct avec la parole. C’est comme en musique : le chemin vers la maîtrise passe par un travail quotidien et assidu, un entraînement permanent et des exercices inlassables.
Le spectacle UN VILLAGE ABSOLUMENT HEUREUX était né de la lecture commune, réfléchie et passionnée, de la prose de Vakhtine. Écoutant les paroles, pénétrant dans la logique particulière du texte ( mi-conte, mi-parabole) les acteurs, avec le Maître, entraient dans la réalité de la fiction créée par Vakhtine. L’action du récit se passe dans un village soviétique typique (au premier regard) des années 30 – 50 du XXe siècle. Mais à côté des personnages tout à fait familiers, ordinaires qu’on peut voir aux quatre coins de la Russie (comme le président du kolkhoze très « idéologique » ou bien un gai luron badineur) habitent ici un Droit de vote, un Épouvantail, un Puits, une Chèvre noire, une Vache… Pour les rendre vivants, en chair et en os, il fallait surtout trouver une voix personnelle à chacun, une tonalité unique en son genre. Au début, pendant les répétitions, ces recherches correspondaient à une sorte de jeu avec les mots : les pétrir, les goùter, les tourner dans tous les sens, les jeter dans l’air et les rattraper sur la paume ouverte, et enfin, les rapprocher et les observer, étonnés. Dans ce travail, l’expérience des travaux d’élèves a beaucoup aidé : se rappelant la première année de leurs études, ils jouaient des petites scènes en ranimant les animaux et les objets. Cette méthode, devenue un procédé de style, est restée dans le spectacle et redonne à la conversation sur la vie et la mort une sorte de pureté, de naïveté…
Si UN VILLAGE… fut un coup de foudre (on répétait le spectacle d’un seul élan émotionnel), GUERRE ET PAIX est un exemple de longues relations avec le texte, parfois compliquées et même douloureuses. Environ sept ans ont séparé les premières lectures de la création. Fomenko se mettait au travail à plusieurs reprises, le reportait, recommençait à penser et à parler du roman et reculait de nouveau devant cette masse romanesque, trop lourde, de l’oeuvre de Tolstoï. Les répétions étaient difficiles, pénibles, le texte résistait, ne se pliait pas, ne se laissait pas entendre.
Cette fois, le principe du travail était autre que dans UN VILLAGE : ce n’était pas le jeu qui permettrait d’approcher le personnage, mais la lecture lente et profonde. Chapitre après chapitre, scène après scène, ils s’avançaient lentement, en « feuilletant » le texte à rebours s’il fallait. Les acteurs essayaient de s’imprégner de l’esprit et de l’arôme de l’époque, comprendre le mode de vie et la logique de pensée des gens des temps napoléoniens. Les oeuvres consacrées à la vie quotidienne de la noblesse du début du XIXe siècle leur ont été d’un grand secours. L’image de chaque personnage (manière de se conduire, de parler) ils la cherchaient en partant de leur savoir. Par exemple Lise, la femme du prince Andreï, roule légèrement le « r » influencée par l’habitude de l’aristocratie russe de parler plus souvent le français que le russe. Là où la logique s’avérait impuissante, le caractère paradoxal de la pensée de Fomenko venait en aide. Ainsi est apparu le mouvement circulaire de la jambe raide de Anna Scherer qui dessine d’incroyables courbes en surmontant avec élégance toutes sortes d’obstacles, une tête par exemple… Cette trouvaille est inexplicable : pourquoi, d’où ça vient ? Je suppose que Fomenko aurait du mal à répondre à cette question.
En général, l’attitude de Fomenko par rapport au mouvement scénique et à l’espace fait l’objet d’une vaste discussion à part. Cette fois on voudrait souligner l’essentiel : il ne faut surtout pas croire que Fomenko « prêche » le théâtre littéraire « sans action ». « Pour un acteur, le mouvement — ce sont des notes selon lesquelles il joue sa partie ». En proposant à chaque acteur sa propre partition, le metteur en scène attend et demande une improvisation dans le cadre d’une forme strictement définie. Ainsi naissent les dentelles d’acier des spectacles de Fomenko. Mais c’est l’ambiance qui compte le plus pour lui : sans cette « perception émotionnelle de l’ambiance » aucune scène, même la plus virtuose, ne se remplira jamais de vie, ne respirera pas d’un souffle léger.
En parlant des principes pédagogiques de Fomenko on glisse, sans le vouloir, vers le récit de sa « cuisine » de répétitions. Ce qui n’est pas étonnant. On a commencé ainsi cet article : les mots pédagogie et mise en scène ont la même racine pour lui. Chacun de ses spectacles est une école. À ses répétitions on apprend comment, à partir d’un rien (légers demi-tours, gestes suspendus, intonations, regards, soupirs), naît le dessin du spectacle. On apprend l’art d’entendre (la parole de l’auteur, le souffle de son partenaire, le silence tout simplement) ainsi que l’art de parler (sans colorer les mots avec une intonation trop marquée, mais en cherchant lentement une nuance peut-être à peine perceptible mais la seule possible), on apprend l’art de vivre sur scène sans faire des petits mouvements agités, sans geste banals. C’est l’école de l’existence pratique dans le métier. Tout nouveau travail est une leçon en soi.
« Il n’existe rien de plus terrible que de s’installer dans sa gloire. On est vivant tant qu’on répète de nouveaux spectacles », répète souvent Fomenko. C’est sans doute, le credo essentiel de son « évangile » théâtral.
Traduit du russe par Macha Zonina.