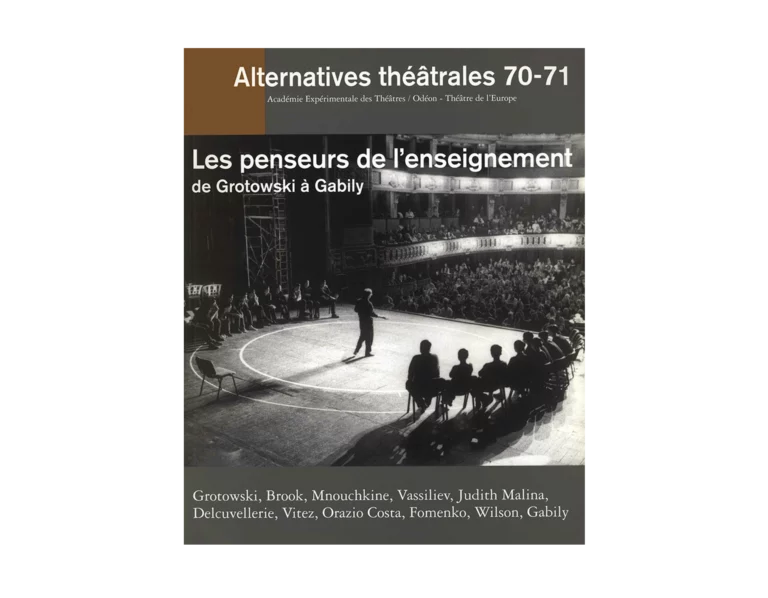J’AIME TOUJOURS PARTIR de ce que l’élève apporte lui-même de la vie. Ce qui compte au début c’est de lui apprendre la portée de ce matériau et, surtout, la nécessité de l’explorer.
Je n’aime pas le stanislavskisme comme esthétique, je n’aime pas ses spectacles, mais j’aime sa manière de penser le théâtre, non pas comme un art, mais comme un métier d’art.
Le point de départ ne peut être que le concret. Partir de là, du connu vers l’inconnu. La vérité ne peut être que concrète. Mais, il ne faut surtout pas se tromper : concret ne veut pas dire forcément réaliste.
Si nous parlons de pédagogie nous devons savoir à qui s’adresse cette pédagogie. Cela explique pourquoi la première question est celle de la sélection. À Malmö nous nous sommes longtemps heurtés à cet écueil. Le concours d’entrée consistait il y a une dizaine d’années dans une sélection sur la base de petites scènes ou monologues « réussis » (combien de fois n’ai-je pas découvert avec tristesse que la scène « réussie » était déjà le sommet de l’acteur que le jeune candidat voulait devenir). Ce type de sélection pousse les candidats à montrer à quel point ils sont acteurs, déjà acteurs. Et, dans une école, nous devons chercher à faire entrer des sujets potentiels pour un travail à venir. l’acteur doit naître, il n’est pas déjà là. C’est pourquoi, depuis un certain temps, nous n’avons plus fait qu’une première sélection sur la base de « scènes » afin de retenir un très important nombre de candidats avec lesquels, ensuite, les enseignants de l’école et les élèves qui terminent leurs études travaillent spécifiquement deux semaines. Après cette période nous retenons douze élèves avec lesquels nous démarrons le travail pédagogique. Il est important de rappeler cela car la pédagogie porte l’empreinte de ceux auxquels elle s’adresse. La relation entre l’élève et le pédagogue définit aussi bien l’un comme l’autre.
L’école est un espace de liberté. Au principe de la communication théâtrale triangulaire l’école enlève un terme : le public. On l’oublie afin de parvenir d’abord à une vérité de l’élève, car celle-ci, au début, peut ne pas être visible pour quelqu’un de l’extérieur. Et je préfère ne pas le pousser à lui donner une forme… et ceci est possible seulement en raison de l’absence de tout spectateur. Dans notre école, les examens de lère année ne sont pas ouverts même pas aux élèves des classes supérieures. Pour qu’il n’y ait aucun regard extérieur. Le régime du début ne peut être qu’un régime de liberté absolue sur fond de la plus stricte intimité.
Un jour, à ses débuts, je dis à un élève « laisse tomber le théâtre ». Il ne comprend pas, lui, qui est venu pour faire du théâtre. Pour faire du théâtre il faut d’abord l’oublier.
Dans les universités américaines j’ai rencontré des étudiants qui étaient déjà spécialisés. En un certain sens ils étaient formés, il s’agissait pour moi de leur apprendre le désapprendre. Ils étaient « spécialistes » avant la lettre.
Ce contre quoi je me bats dans les premiers temps c’est le désir de faire des images. C’est le principal danger.
Chaque idée de jeu a la valeur de l’acte. Quelqu’un me propose un jour de jouer un personnage épisodique en aveugle. À priori je n’ai pas refusé, mais je lui ai dit « fais-le ! ». Plusieurs jours plus tard il est revenu mûr de l’expérience quotidienne d’un aveugle qui venait habiter ses mouvements. Alors l’idée est devenue acte. Et ceci confirme ma conviction qu’au théâtre on ne peut avoir des idées, mais des engagements.
Apprendre à trouver les motivations qui expliquent un comportement. Les déterrer par une approche souterraine du noyau de l’acte. Par exemple, essayer de saisir les raisons de l’abandon de l’enfant dans LE CERCLE DE CRAIE. Ou, dans TARTUFFE, s’interroger sur les agissements de Tartuffe, sur les stratégies de Mme Pernelle … trouver toujours ce qui détermine un acte. Comment il s’élabore et se construit, ensuite seulement viennent les alexandrins, la diction …
Je travaille avec des exercices, mais, j’en suis certain, moi seul peux les rendre féconds, actifs, porteurs. Ceux qui copient les exercices se trompent. La valeur d’un exercice dépend de celui qui le dirige, de la manière dont il l’anime et le commente. Autrement il reste une simple donnée inerte. l’exercice n’est pas un outil, il est un matériau.
Nous travaillons d’abord sur des microséquences et ce n’est qu’ensuite que nous passons à des travaux sur le récit. Je crois que l’on ne peut bien avancer que pas à pas. C’est pourquoi les élèves se confrontent au début avec des pièces plus simples, d’une approche, disons familière, et dans un second temps ils passent aux grands textes. Alors ils commencent à travailler sur la durée et l’évolution.
Moi, je propose, mais je ne sais pas ce qu’on trouve.
À un moment de ma vie l’enseignement de la mise en scène a cessé de m’intéresser. Enseigner la mise en scène c’est leur apprendre comment prendre le pouvoir.
Tu me parles de l’exercice de Peter Brook avec le passage du bâton et de l’interdiction d’arrêter le mouvement alors que le partenaire a fait une faute, ceci afin d’intégrer précisément la faute dans la fluidité de l’acte. Oui, cela me semble d’autant plus juste car la faute n’incombe pas uniquement à la maladresse de celui qui vous a précédé, elle remonte plus loin, en amont, elle concerne plusieurs membres du groupe. Et parce que collective c’est collectivement que nous devons la surmonter. La faute, comme le succès, est collective. D’ailleurs le bâton qui vole de l’un à l’autre qu’est-il sinon justement la concrétisation de la tâche collective que le groupe assume ensemble.
Une consigne, toujours reprise : « Ne marquez pas ! ». Pour l’élève la vérité de l’acte compte plus que ce que l’on pourrait appeler la qualité de la performance. Comme au saut en hauteur, dans un premier temps, la justesse des pas l’emporte sur la hauteur franchie. Je demande aux élèves le don absolu et ils finissent par comprendre ainsi qu’il n’y a pas de différence dans les degrés du don. Les acteurs qui « marquent » m’exaspèrent plus que les acteurs mauvais.
Dès le premier jour j’explique aux élèves, comme disait Grotowski, que l’acteur doit admettre qu’il a une « tâche héroïque » à accomplir. Une fois que l’on s’accomode à cette idée, l’acteur doit ensuite s’appliquer à apprendre comment la résoudre. Cela implique une adaptation à la tâche, ce qui suppose savoir faire ce qu’il faut pour ne pas contredire les besoins de la mission. Les conditions sont définies, mais non pas la modalité de les accomplir.
Je suis convaincu que la préparation est plus importante que la course. C’est ce qui explique mon retrait de la mise en scène au profit de l’enseignement. Ici j’ai le sentiment d’oeuvrer à la mise en place correcte de la rampe de lancement, ensuite c’est à l’élève de voler seul. Et j’aime cette relation entre la dépendance intitiale et l’autonomie finale.
Nous commençons, dans notre école, par une première phase individuelle qui refuse toute obligation envers les autres. L’élève n’a aucun devoir, même envers le texte. Ce qui compte c’est de se focaliser sur la justesse de la relation avec la tâche proposée en se nourissant de la recherche de soi-même, de ses moyens propres. À ce niveau, au risque de surprendre, on peut dire que le but consiste à se servir de Shakespeare pour trouver son authenticité.
À mi-parcours du cycle d’enseignement, les élèves quittent l’école pour six mois de travail dans les théâtres. À priori cela doit les mettre en contact avec la pratique dans le contexte des institutions théâtrales. Mais, le plus souvent, ils éprouvent le plaisir de retourner à l’école conscients de ce qui leur manque encore et en même temps munis de l’expérience dans les théâtres dont ils fournissent des analyses d’une lucidité étonnante.
Après cet intervalle s’engage la deuxième phase. Elle concerne le travail sur la situation comme matériau. La situation doit être « la brique » claire pour la construction à venir. Pour cela nous faisons appel d’abord à des textes simples, proches de l’expérience quotidienne, ensuite nous passons au travail sur des scènes en apparence marginales, scènes-liens empruntées à Ibsen, à Wedekind. Ces derniers temps je travaille plutôt sur les petites scènes qui servent de jointure, de lien entre les grands moments. Cela me permet de faire jouer aux éléves les moments de vérité intermédiaires (comme par exemple, dans MADEMOISELLE JULIE, Jean à la cuisine) et non pas directement la conclusion.
Un exercice particulièrement stimulant consiste à fournir aux élèves une grande quantité de petites scènes, (comme par exemple celle de Groucha avec son aimé à la rivière) qu’ils sont obligés de travailler vite afin de les présenter après un ou deux jours. C’est un entraînement qui produit des surprises et oblige les élèves à prendre des décisions dans l’urgence.
Au début l’élève doit jouer la situation bien précise, sans tenir compte de la biographie du personnage qui ne se révèle qu’ensuite.Je sais que Brecht disait le contraire, mais, lui, il faut le préciser, parlait de comédiens, tandis que moi, je parle des élèves pour qui il s’agit d’abord de se former et ensuite de jouer dans le sens strict du terme.
J’aime beacoup le terme de Barba : « l’acteur c’est l’homme dilaté ». C’est ce que l’élève est appelé à comprendre : l’acteur fait ce que n’importe qui peut faire, mais à un niveau supérieur d’énergie et de concentration.
Puis, progressivement, nous approchons des classiques pour découvrir comment, par-dessous la forme, c’est toujours ls situation qui domine.
À ce moment du processus de formation nous invitons une personnalité étrangère qui vient animer un projet, disons « alternatif ». Comme, par exemple Mario Gonzalez plusieurs fois convié pour travailler sur les masques et la commedia dell’Arte. L’invité ne parle pas, dans le sens figuré du terme, « la langue de l’école ». Il élargit le champ de l’investigation et ouvre des possibilités autres.
Enfin, selon une suite logique qui va du singulier vers le pluriel, les élèves passent à l’étape des projets collectifs. Si auparavant la responsabilité envers soi-même prévalait, ils doivent à présent éprouver et travailler avec la conscience de la responsabilité envers le projet.
La dernière étape consiste dans la préparation de deux spectacles. Afin d’écarter toute compétitivité implicite dès qu’il y a un travail de deux équipes sur deux projets distincts, nous procédons à des distributions croisées : quelqu’un qui joue le protagoniste dans un spectacle peut faire de la figuration dans l’autre. Chacun se sent impliqué et ne se désolidarise d’aucun projet.
Nous défendons l’idée d’un processus qui se charge d’assurer une compétence à l’élève pour l’étape suivante. Car au fond ce dont il s’agit au théâtre c’est de préparer un élève pour lui-même autant que pour les autres.
Nous sommes en route. Le processus compte plus que le produit.
L’école, l’espace de toutes les libertés si on sait les atteindre. Si on dompte les élèves on les fait singer un modèle et ils finissent dans une prison.
Je n’aime pas l’art qui s’inspire de l’art. Je demande toujours « d’où vient cela ? ». C’est pourquoi il ne s’agit pas de découvrir le style grec en général, mais de le saisir dans un contexte bien précis. On ne peut apprendre le style en dehors d’une vérité de la situation. Il faut savoir admettre qu’il n’y a jamais ni préalable, ni modèle.
La culture ne m’intéresse que dans la mesure où elle est acquise pour élargir l’horizon et surtout si elle est liée à un projet.
Un jour j’amène mes élèves au Musée d’Art Moderne où nous regardons un immense tableau blanc. En nous rapprochant nous découvrons à quel point ce blanc est le résultat d’un incroyable nombre de combinaisons chromatiques. Alors je leur ai dit, ce qui est un de mes principes, « n’oubliez jamais qu’une idée, il faut la construire ! Il ne suffit pas de la déclarer ». J’aime que l’on construise quinze, vingt sens autour d’une situation quitte à choisir ensuite. De la vient sans doute l’obligation d’analyser les circonstances, de formuler des questions ; il faut explorer une situation dans toute sa complexité.
Je m’emploie à convaincre les élèves d’éliminer ce qu’ils considèrent comme étant « artistique ». Ce qui importe c’est d’admettre que l’on travaille avec des matériaux a priori non artistiques… Cette leçon initiale est décisive.
L’oeuvre est un assemblage de trivialités (paroles, mouvements, rythmes, couleurs) de même que la Chapelle Sixtine est une accumulation de pierres, briques, chaux etc. Rien n’est plus ennuyeux au théâtre que l’acteur « artistique », qui fait état d’un savoir-faire « artistique ». Jean Gabin n’était jamais « artistique », certains acteurs de la Comédie-Française le sont parfois.
Souvent je cite l’exemple de l’expert en piano qui explique l’art de jouer sur une boîte sans clavier. Ou même quand il s’agit du piano il ne touche pas le clavier et, sans produire les sons, il indique seulement les mouvements qui les produisent.
Le personnage est la somme des réponses données aux situations. Le personnage agit, il ne reproduit pas.
Le but ne consiste pas à jouer l’oeuvre comme si elle était finie. Pour reprendre une phrase de Brook je dirais que l’acteur doit refaire le processus de la création afin de donner des réponses non pas littéraires, mais de jeu. Réécrire l’oeuvre comme acteur. Pour cela il faut partir d’une vérité pour arriver à une autre vérité. La situation s’inscrit dans un développement, et l’élève doit analyser le moment qui précède afin de suivre la dynamique de l’oeuvre.
Un conseil : d’abord trouve ta vérité et ensuite cherche celle du personnage. Le jeu consiste à réaliser l’équilibre entre les deux à trouver leur rapport juste.
Construire les événements qui mènent aux sentiments. Au théâtre, la réalité est toujours physique.
La qualité provient toujours de la qualité du rapport de l’acteur avec son activité.
Le travail sur la concentration est essentiel. Il suffit de voir les acteurs de kathakali qui, pendant des heures, se maquillent. La concentration se construit progressivement. Elle implique la focalisation intensifiée sur une image, la capacité d’attente, la précison d’une tâche etc. La concentration est toujours active, elle suppose une présence maximale ici et maintenant. L’élève doit apprendre que la concentration appelle à une perte de l’extérieur et à un repli sur soi jusqu’au moment où l’on est prêt. Ceci pour réaliser la meilleure relation entre le groupe et la personne car la concentration seule permet d’être en contact avec soi-même dans un contexte collectif. On peut accueillir l’imprévu seulement en oubliant l’extérieur. Avant de reconnaître la présence du spectateur il faut apprendre à l’exclure.
Il est important de trouver la solution de l’exercice, mais sans la figer. Savoir garder l’esprit des exercices dans le mouvement du processus… alors il est tout aussi important de faire et de ne pas oublier ce qu’on a fait.
La maîtrise rend seul. On cesse d’être partenaire.
Ce qui compte c’est ta présence maximale ici et maintenant.
Je ne peux enseigner si je ne m’inscris pas dans un processus, si je ne laisse pas un instant les élèves aller ailleurs pour mieux les retrouver. Je travaille dans une durée interrompue par d’autres rencontres auxquelles les élèves sont conviés. Les stages fermés sur eux-mêmes, sans suite ni communication, ne m’intéressent pas. Je me pense comme un relais et il m’est impossible de me présenter toute une période comme le créateur d’un monde.
Cela explique pourquoi j’ai toujours enseigné dans une école, et j’ai détesté l’autonomie d’une pédagogie close, fermée sur elle-même. Comme un de mes anciens élèves, dans les propos duquel je me suis reconnu, je ne peux travailler que dans le contexte de l’appartenance et nullement en tant que free lance.
Qu’est-ce qui te légitime pour dire un texte ? Seule la préparation te donne le droit d’approcher un personnage. Et à son tour celui-ci te légitime comme acteur.
Par rapport à l’opéra ou à d’autres théâtres traditionnels, notre théâtre ne dispose pas d’une préforme qui se laisse appréhender, qui constitue un appui préalable.
La voix doit s’engager dans la direction du mouvement. Elle doit avoir une direction dans l’espace afin que le son et le geste se dirigent vers le même point.
Aider l’acteur à découvrir sa voix. Une fois j’ai vécu l’émotion éprouvée par une jeune fille que j’ai accompagnée pour explorer son corps au point de libérer sa voix. De l’entendre et l’éprouver. Mais pour moi ce fut aussi éprouvant que pour elle et, depuis, j’ai cessé ces recherches.
Chercher le son d’avant les mots.
L’improvisation est un mot malade. Elle est trompeuse si l’on propose à l’élève une situation à laquelle il ne peut répondre que par une réaction attendue : si on lui dit qu’il se trouve en danger, forcément il criera et alors on obtient ce que l’on souhaitait car les comédiens, comme les enfants, sont démagogues. Ils offrent ce qu’ils devinent qu’on leur demande. Avec une telle improvisation le comédien et le metteur en scène finissent par se tromper l’un l’autre.
L’improvisation m’intéresse dans la mesure où elle aide à l’élargissement de la situation, où elle permet à l’élève de dépasser le dialogue pour parvenir à l’événement. Celui-ci ne s’exprime pas par des mots, mais par des actes. Les événements que l’on trouve forment la terre sur laquelle pousse l’herbe du dialogue.
L’improvisation est une activité qui t’accorde le droit de te tromper. Elle n’est ni un objectif, ni un but.
Un moyen seulement. Il doit libérér de l’inconnu.
L’improvisation s’accomplit lorsqu’elle mobilise la totalité de l’être, l’intellect et le corps. Elle n’intéresse que dans la mesure où elle produit un comportement réussi.
Pour l’improvisation tout passe par le concret et le professeur doit veiller à la mise en place correcte des évenements concrets. Ainsi il participe à la préparation de l’acte qui, lui, n’est pas sous son contrôle. Il s’en dérobe. Il peut intervenir par contre pour enlever les obstacles rencontrés en chemin et uniquement après ce travail passer, comme disait Grotowski, à l’élaboration de la partition.
Comment apprivoiser une situation ? En la faisant nous-mêmes.
Travailler sur l’action et tout autant sur la réaction.
Ce qui importe c’est de mettre en équation. Si ce travail initial est bien fait, le processus peut s’amorcer correctement.
Je prends par exemple la scène de lady Anne avec Richard III et j’analyse argument par argument afin de découvrir l’art de Richard de retourner une situation, de stimuler une sexualité, d’établir un contact par le crachat qu’il reçoit en pleine figure ou l’épée qu’il fixe lui-même contre sa poitrine. Je débute par une division en fragments afin d’obtenir des vérités partielles à partir desquelles il est possible de passer au stade ultérieur, celui du lien et de la construction.
Oui, ce que je cherche toujours c’est ce qui permet à l’acteur de « répéter » un acte tout en restant aux aguets : la vérité de la situation. Cela suppose une vérité ici et maintenant. Une vérité immédiate.
Jouer un personnage c’est trouver la vérité du jeu.
En tant que pédagogue je cherche la vérité de l’élève et je me désintéresse du spectateur. Le spectacle réclame un effort pour rendre visible le résultat du travail et ceci risque de cacher la vérité de l’élève à peine perceptible au début.
Je n’aime avancer que par petits pas.
La pédagogie consiste à accompagner quelqu’un pour découvrir sa vérité. Au fond la position du soi-disant « maître » est dans ce sens flatteuse.
J’aime cette histoire du maître chez qui vient un élève et chaque fois qu’il frappe à la porte en disant son nom le maître ne le fait pas entrer jusqu’au moment où à la question « Qui est là ? » il répond « Personne ».
Quelqu’un m’a dit un jour et cela m’a servi : « Ne censure pas tes rêves par souci d’applicabilité. Ça c’est le travail d’un autre ».
J’ai proposé une fois une improvisation qui a été particulièrement riche. Je travaillais sur une nouvelle pièce anglaise CRI AU-DELÀ DU FLEUVE de Poliakoff. La situation est la suivante : une adolescente rebelle est renvoyée de l’école à cause d’actes d’indiscipline spectaculaires et odieux. Dans la première scène le proviseur informe la mère qui est consternée, effarée, impuisante et, de surcroît, habitée par un sentiment de culpabilité dû aux accusations qu’elle vient d’entendre. Dans la seconde scène, la scène sur laquelle nous travaillions, la fille rentre tout en sachant que la mère a été convoquée par le proviseur et elle attend la confrontation. Pendant ce temps-là elle découpe avec des ciseaux toutes les revues que la mère avait gardées depuis longtemps. La mère rentre et voit, de dos, la fille qui déchire les revues. Comment amorcer la communication ? Quelle est l’intensité de l’attente de l’une à l’égard de l’autre ? J’ai proposé à l’élève qui jouait la mère de s’agiter dans la pièce en accomplissant toutes sortes d’actions, plutôt minuscules. L’élève qui jouait la fille restait assise, continuait à découper les revues et, sans la voir, parce que la mère se trouvait dans son dos, elle racontait toutes les actions que celle-ci effectuait. Le récit a été particulièrement exact et précis. Ceci s’explique par la qualité extraordinaire de l’attention ainsi que de la présence ici et maintenant des deux élèves.
Un autre exemple : quelqu’un se met dans le coin d’une pièce dont il a bien étudié le plan et ensuite il doit placer dans l’espace les partenaires qui lui envoient des sons. Il réagit et en même temps organise les stimuli reçus.
La devise de tout travail d’improvisation authentique est de ne pas faire semblant d’avoir découvert quelque chose.
Quand on travaille sur un projet de groupe celui-ci a ses lois. Tout dépend alors de la collaboration avec les autres.
Si tu n’as pas ta vérité tu ne parviendras pas à la vérité de l’autre.
Si tu pars du mensonge c’est au mensonge que tu arrives.
Au théâtre ce qui compte c’est d’atteindre la vérité au coeur du mensonge unaniment accepté.
Les pas doivent être vrais, même si la convention générale ne l’est pas. C’est pourquoi j’aime diviser en fragments, fragments petits et simples qui conduisent au projet qui les inclut. La vérité se trouve dans la transition. Il faut savoir saisir où la situation change.
Il est impossible de jouer l’abstrait, il faut sans cesse chercher des racines dans le concret.
On se doit de trouver des règles de vérité.
Ne reste pas indifférent à ce qui se passe autour de toi. Sois présent. Intègre tout ce qui arrive ! Tiens compte de la présence de l’assistance.
Par rapport à l’élève, l’acteur doit savoir et le metteur en scène au fond se contente de le « mettre en page ».
Le processus consiste à passer de la vérité non artistique à la vérité artistique.
Le style doit être libéré, il est toujours un résultat.
Nous pouvons recréer la vérité, pas les alexandrins.
Le but consiste à sauver la vérité sans perdre le style.
Ne pas se préoccuper du style, il doit ressortir après. D’abord la vie, l’art ensuite.
Découvrir ce qui peut aider quelqu’un dans le travail. Comment rendre crédible un élève qui jamais ne doit s’ériger en délégué artistique de Molière.
Ce qui aide le jeu ce n’est pas de juger un personnage, mais de le défendre. Le meilleur exemple, Tartuffe.
Les grandes vérités tuent la dialectique du comédien. Ce qui compte c’est la vérité en mouvement, la manière dont tu combats pour accomplir le but. Au fond, il ne faut pas oublier que la mission change constamment.
Le jeu est aléatoire, il est toujours en train de se faire. Cela maintient le comédien en état d’éveil.
Je me souviens d’une admirable improvisation proposée par Lee Strasberg aux jeunes qui jouaient la grande scène des retrouvailles de Nina et Kostia du quatrième acte de LA MOUETTE. Strasberg a demandé au jeune homme de faire des brouillons, d’écrire de la prose ou de la poésie. Le comédien a répliqué en précisant qu’il ne pouvait pas faire de la littérature. Strasberg lui a demandé de s’appliquer et, s’il ne réussissait pas, de jeter par terre les feuilles de papier qui lui déplaisaient. Le comédien a essayé, s’est emballé, mais à la fin il n’y avait qu’un tapis de papiers froissées qui recouvrait la scène. À cet instant-là Strasberg a invité la jeune comédienne à entrer et constater que l’échec de la vie de Kostia n’était plus une donnée subjective, mais une situation concrète, visible, menaçante. Strasberg commente : « on sentait qu’un malheur s’était mis en route ».
Il faut que vous trouviez votre vérité dans le mouvement de l’eau.
Moi, j’aime former les élèves et ensuite les libérer. Ce qui me plaît c’est non pas qu’ils restent, mais, bien au contraire, qu’ils aillent ailleurs… chez les autres. Ce qui me réjouit c’est de les voir revenir. Oui, j’aime quand ils reviennent.
Notes prises par Georges Banuu lors du séjour de Radu Penciulescu à La Bachellerie de Davignac ( 19 — 24 août 2000).