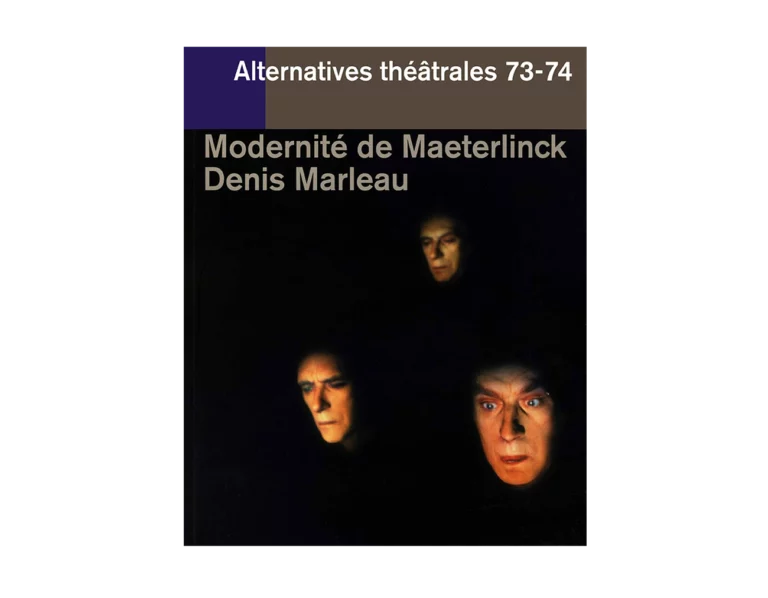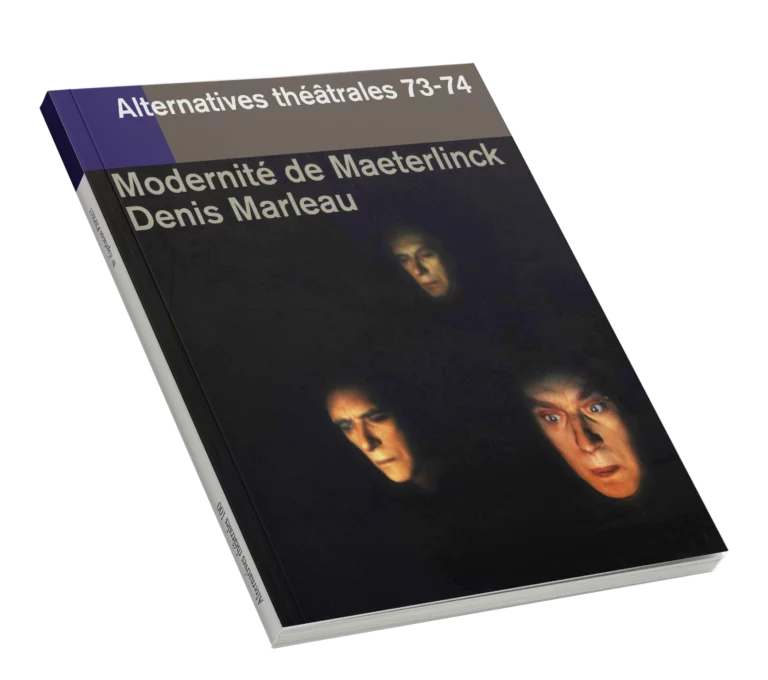LES DIFFICULTÉS de faire ressortir la spécificité du fait théâtral, tantôt identifié avec la réalisation scénique, tantôt avec le texte écrit prononcé par un acteur, ne datent pas d’aujourd’hui. On pourrait résumer cette alternance dans le long parcours où se tissent les relations entre l’image et la parole (du moins selon les paramètres utilisés dans la culture occidentale qui est la nôtre). Depuis « ut pictura poesis » de Horace, l’histoire de la critique d’art a éte ponctuée par des positions contradictoires donnant la primauté tantôt à la peinture, au voir et au montrer, tantôt à la parole, au dire. On notera au passage combien il pourrait être enrichissant d’intégrer de plus en plus l’histoire du théâtre à l’histoire de l’art et de considérer de manière plus systématique les rapports entre le dire et le voir, entre la peinture et l’écriture, entre l’image et la parole.
L’enjeu du théâtre consiste à montrer ce qui est indicible et à dire ce qui est invisible. Sur ces deux négations, impliquant chacune l’impossibilité, mais aussi la nécessité de dépasser leurs propres limites, naît le geste théâtral, trouvant sa place sur un terrain instable, nécessité de boucher les vides, les trous, les béances laissées ouvertes par l’un des deux langages utilisés par les vides, les trous, les béances laissées ouvertes par l’autre. Le texte dramatique a été perçu tantôt sous l’angle exclusif de la forme littéraire ou de son contenu narratif, tantôt comme le prétexte à la réalisation d’un autre texte sous-jacent, non écrit. La querelle entre théâtre de texte et théâtre d’images continue car les nouvelles technologies d’un côté et les nouvelles écritures de l’autre se superposent sans trouver un espace de dialogue qui soit véritablement nouveau.
À ce point de vue le parcours de Denis Marleau (qu’on lui souhaite encore très riche, accidenté et donc fécond) me parait symptomatique des changements intervenus dans la conception du texte théatral et de son utilisation sur la scène, et donc des changements intervenus dans l’idée même de théâtralité de ces vingt dernières années.
Ma connaissance de Denis Marleau remonte au début des années quatre-vingt à l’époque de CŒUR À GAZ, MERZ OPÉRA, OULIPO SHOW et, naturellement, d’UBU CYCLE, où Marleau affichait son esthétique du collage. Ce qui m’avait frappée surtout chez lui c’était le choix des textes, sa recherche d’auteurs radicalement d’avant-garde, porteurs d’une conception de l’art résolument moderne.
Notre terrain de rencontre, à ce moment-là, se trouvait dans les théories et dans l’écriture théâtrale et littéraire de Jarry, ou plutôt dans une certaine conception de l’art comme fragmentation, comme signification instable, provisoire, continuellement renouvelée par le jeu déconcertant des perspectives contradictoires superposées.