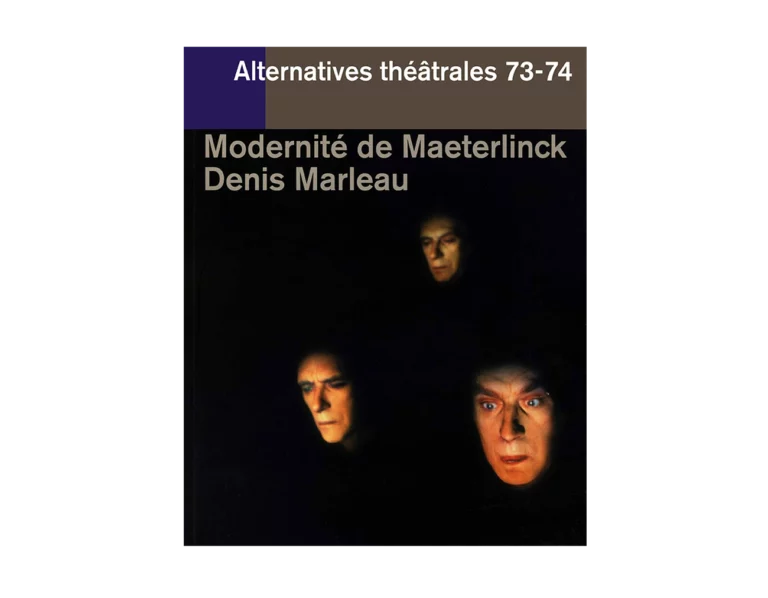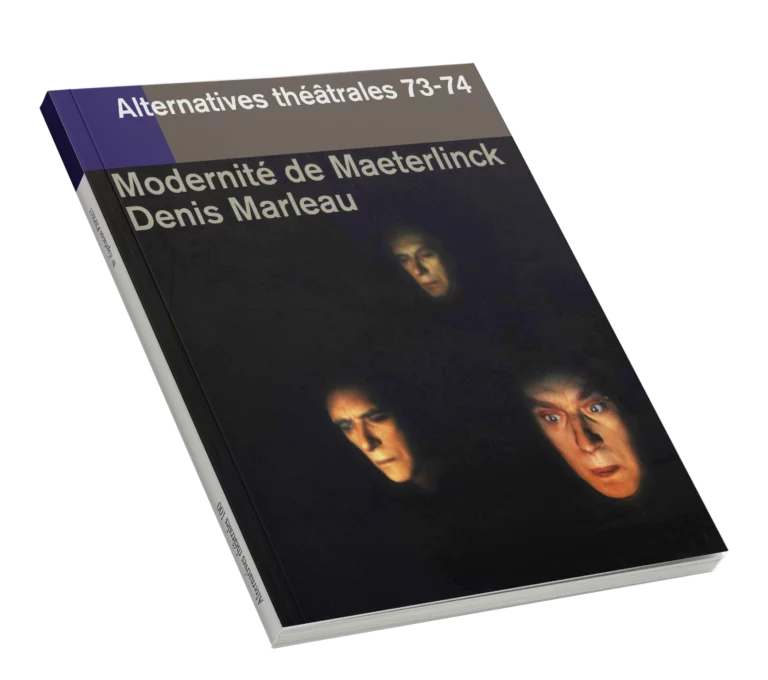PROLOGUE de l’URFAUST. Un chien nous regarde. L’objet fait chien immobile devant les spectateurs présente deux points lumineux qui ont la forme et l’aspect d’un regard mobile, vivant. Ces yeux aux contours humains se détachent du fond noir de la scène, contre lequel le regard de ce chien-là prend tout son relief. Gardien immobile et figuré de l’Hadès ; esprit mobile de Méphistophélès qui s’adresse à nous, nous regarde, nous inquiète. Mais qu’est-ce qui inquiète exactement ? La ruse, la machination, par laquelle cet objet-chien fabriqué – l’artefact infernal – va être habité d’une lueur troublante, celle qui fait la vie de l’esprit, le propre de l’humain et non de l’inanimé. Et cette lueur semble vouloir se jouer de nous, se servir de notre passive complicité de spectateurs pour activer une autre machine : le doute, face à cette absence ressentie derrière la trop grande présence du regard. L’image enregistrée et projetée de l’œil humain sur ce chien me fait entrevoir ce qui échappe du regard vivant. Chaque apparition vidéographique chez Ubu (les bustes qui s’animent soudainement, qui sont animés d’un regard) me posera, inlassablement, la même question, provoquant le même malaise : qu’y a‑t-il derrière le regard humain ? Rien, justement, qu’une sorte d’étendue neutre à laquelle nous (le regardant) conférons une humanité.
Ce que révèlent certaines des plus récentes créations de Denis Marleau1 qui travaille à partir de l’installation et de la vidéo, dans la lenteur, la pénombre et parfois le silence, réside, me semble-t-il, autour de cette représentation du sujet comme le lieu d’une absence. Mais ce sujet comme absence (ou, conséquemment, l’absence faite sujet2, j’y reviendrai) est auréolé, paradoxalement, d’une forte présence scénique. Prenons le cas des TROIS DERNIERS JOURS DE FERNANDO PESSOA, où ce sont les identités rêvées et créées par Pessoa (seul personnage en scène) qui viennent le visiter au seuil de sa mort. Alvaro de Campos, Alberto Caeiro, Bernardo Soares Reis, Antonio Mora apparaissent, glissent en scène comme des statues inertes, automates animés d’un visage, figure vivante sur figurine inerte. Il n’y a plus de personnage, mais une installation plastique mobile. Figure qui va être impressionnée, illuminée comme de l’intérieur (mais c’est une illusion), de façon à révéler (à la manière d’un révélateur photographique) une présence. L’effet de présence est essentiellement lié à l’exposition du sujet : le sujet fictif est exposé à la fois comme un corps mort, embaumé (car l’objet est plastique et esthétique), et comme un esprit vivant, autrement dit, non plus personnage mais figure – nature morte – animée (survivant) par le médium vidéographique. Une figure sans profondeur mais dotée d’un rayonnement magnétique qui la rend semblable aux figures en forme d’images mentales qui habitent les souvenirs, (comme Denis Marleau parle « d’écran humain3 » pour décrire les supports statuaires)? Ainsi, l’intériorité, chez Ubu, est-elle toujours un effet de surface et un art de la figure.