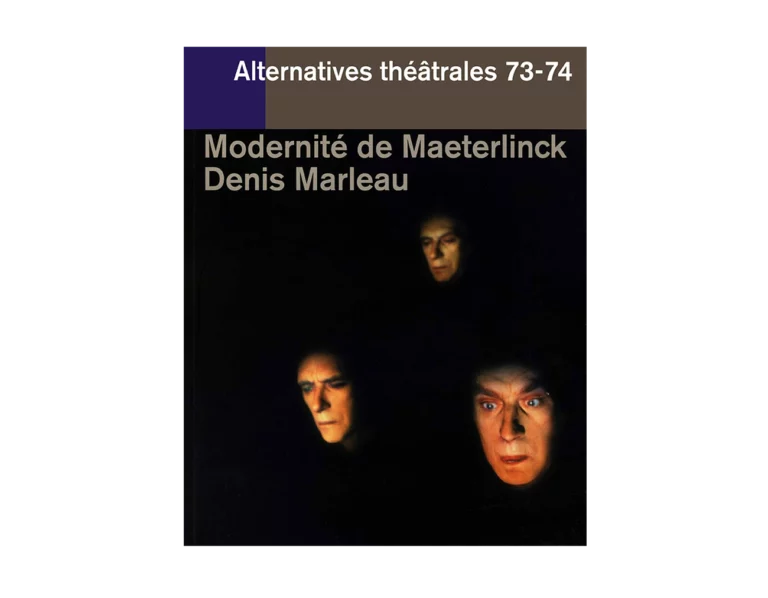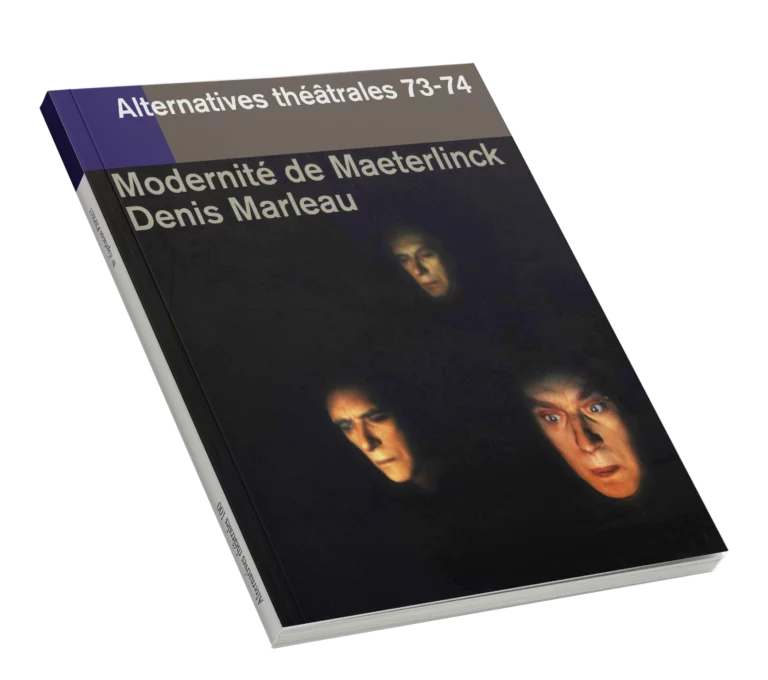On apprend à reconnaître les forces sous-jacentes ; on apprend la préhistoire du visible.
Paul Klee.
On apprend à fouiller les profondeurs, on apprend à mettre à nu.
OUTRE LA CRÉATION de PELLÉAS par Lugné-Poe en 1893 et l’expérience de Meyerhold sur TINTAGILES en 1904, on peut affirmer sans risque d’erreur que la troisième grande date dans l’histoire des représentations du théâtre de Maeterlinck est celle de la mise en scène d’INTÉRIEUR par Claude Régy en 1985 (qui fut suivie dix ans plus tard par LA MORT DE TINTAGILES – dont l’impact fut tout aussi considérable –, et qui aurait dû l’être aussi d’un PELLÉAS ET MÉLISANDE en plusieurs langues – mais le projet ne s’est pas réalisé).
Quand Régy décide de monter INTÉRIEUR, pièce lue à l’adolescence à la suite d’un deuil personnel, et dont la force poétique, imaginaire et dramatique lui était revenue à l’occasion de ses mises en scène de Duras, c’est d’abord la forme même de l’œuvre qui le retient. L’intrigue est inexistante (un vieillard doit porter la nouvelle du suicide d’une jeune fille, et n’ose entrer dans la maison de ses parents), les personnages ne sont que des voix ou des silhouettes, leur domaine est la frontière entre la vie et la mort, la parole et le silence, le mouvement et l’immo bilité ; Régy retrouve obscurément ce qui fonde depuis plusieurs années ses propres recherches : un théâtre qui ne soit ni « théâtral » ni « spectaculaire », qui ne cherche pas à nous leurrer avec le « comme si » d’une « re/présen tation» ; un théâtre qui soit traversé de forces invisibles mais que l’on sait pertinemment présentes, un théâtre qui sache relier les différents points de notre espace intérieur, notre avant et notre après (« notre passé et notre avenir » dit Maeterlinck dans LE TRÉSOR DES HUMBLES ), mais aussi le passé et l’avenir de l’humanité tout entière. Lieu improbable, et pour beaucoup insupportable, où le spectateur doit faire face à ce qui point au cœur de la vie, à ce qui résiste dans la mort même qu’il porte en lui et hors de lui. Non pas un théâtre abstrait, mais un théâtre pour ainsi dire décalé, dans la marge de la visibilité quotidienne – décalé c’est-à-dire aussi qui décolle les représentations habituelles de leur support, comme pour voir ce qu’il y a derrière, et la force qui les anime.
INTÉRIEUR met en scène deux espaces, articulés en un dispositif qui est au cœur de la création maeterlinckienne, mais que Régy avait su réinventer avec Duras en montant notamment L’ÉDEN CINÉMA dix ans plus tôt (1977). Dans PELLÉAS déjà (mais aussi dans les ébauches de LA PRINCESSE MALEINE), existait cette séparation entre l’espace de la chambre (chambre obscure du désir et de la mort, chambre noire de l’inconscient) et l’avant-scène de la parole : c’est lorsque Golaud demande au petit Yniold, juché sur ses épaules, de lui raconter ce qui se passe dans cette chambre inaccessible, où se tiennent à tout jamais immobiles, les yeux ouverts, ne se touchant ni se regardant, les amants qu’aucune étreinte ne pourra jamais désunir. Dans INTÉRIEUR, la séparation s’est étendue à toute la pièce : devant, les personnages qui parlent ; au fond, « dans la maison », la famille, muette pour le public qui ne peut l’entendre, mais muette surtout parce qu’il importe qu’elle soit le réceptacle silencieux de la mort. Des morts et des vivants ? Des ombres et des paroles détachées, elles aussi décollées, de ces ombres, paroles qui flottent et nous reviennent sans qu’on puisse savoir d’où ni comment : Je ne travaille pas sur la voix, ni sur le corps. Je ne le fais jamais. Je ne crois ni au travail vocal ni à l’expression corporelle. Mais quand on emmène les gens là où il faut, à l’intérieur d’eux-mêmes, et dans cette relation d’eux-mêmes avec la totalité de l’univers, alors, à ce moment-là il vient dans le corps une autre manière de bouger et dans la voix une autre voix. On ne sait plus d’où vient la voix. Elle vient d’ailleurs. (ESPACES PERDUS, p. 109).
Là où Maeterlinck indique une maison avec portes et fenêtres, comme Strindberg le demande à la même époque pour l’immeuble d’ORAGE – et avec une optique somme toute assez semblable (c’est-à-dire qui doit beaucoup aux nouvelles images du XIXe siècle et à leur fonctionnement non-discursif1) –, Régy choisit de supprimer toute séparation entre l’extérieur et l’intérieur. La famille n’est plus simplement cadrée par la succession des fenêtres, comme autant de mini-scènes où les person nages feraient leurs apparitions ; elle nous est donnée à voir sans médiation, ni obstacle qui ferait écran à la vision, ce qui rend son silence plus prégnant (il ne s’explique plus par la présence de murs entre elle et nous). Paradoxalement, le metteur en scène renforce ainsi la fonction de projection fantasmatique induite par l’écran de la façade, intériorisant violemment « la distance, la lumière et le voile indécis des fenêtres » dont Maeterlinck souhaitait qu’ils « spiritualisent » les mouvements « graves, lents » et « rares » des personnages. Nous sommes passés, comme le dit ailleurs l’écrivain, « de l’autre côté de la vie », c’est-à-dire derrière l’écran, à l’intérieur de ce qui est, plus que jamais, un espace mental – où le réel s’inscrit non par mimétisme mais, justement, par projection.
Le choix scénographique d’ensemble participe de la même visée : des trois propositions faites par la scénographe2 (Noëlle Ginéfri), Claude Régy retient la troisième, inachevée, comme si l’inachèvement relevait précisément de ce territoire intérieur, sans limites3, qu’il cherche à explorer : d’une part l’espace scénique est considérablement agrandi par son extension jusqu’au cœur de la salle (au point de recouvrir la totalité de l’orchestre lors de la reprise au TNS); d’autre part le plateau ainsi déployé jusque dans l’espace public est recouvert d’un sable qui mange par endroit les murs de la salle, eux-mêmes recouverts par des arcades successives qui prolongent perpendiculairement le cadre de scène. Régy décide de traiter la totalité du théâtre pour en faire l’espace d’une visibilité nouvelle, non pas « en faisant descendre les acteurs au milieu du public pour lui donner de la choucroute »4, mais en créant un espace unique, sans ruptures et sans fioritures (le plateau reste vide), où pourra circuler la matière illimitée de l’œuvre maeterlinckienne, où pourront se déposer les traces de cet imaginaire commun (de vie et de mort) exploré par le dramaturge.


L’utilisation du sable permet d’accentuer étrangement cet aspect du dispositif (« dispositif », c’est-à-dire non pas tant manière de représenter que manière de disposer la réalité pour faire advenir le Réel5). Il participe de la « spiritualisation » des mouvements réclamée par l’auteur et déjà évoquée. La rareté et la lenteur des déplacements, voire l’immobilité des personnages, se combinent avec l’empreinte laissée irrémédiablement par chaque traversée de l’espace. Présence et absence, visible et invisible, se conjuguent ainsi très simplement, donnant à INTÉRIEUR sa dimension de passage continu entre deux mondes :